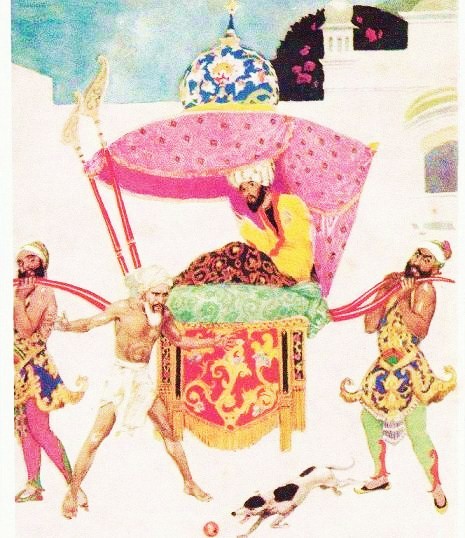Contes Floraux du Jardin des Elfes
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2 
 Contes Floraux du Jardin des Elfes
Contes Floraux du Jardin des Elfes
CONTES FLORAUX DU JARDIN DES ELFES
Mes remerciements vont à Madame Nathanaëlle COURT,
pour avoir mis à ma disposition les dessins et les toiles des artistes-peintres de sa galerie,
pour illustrer mes contes.
L’auteurpour avoir mis à ma disposition les dessins et les toiles des artistes-peintres de sa galerie,
pour illustrer mes contes.
LE LILAS
En Perse, on raconte l'histoire de ce riche marchand dont le palais s'élevait au coin d'un vaste parc. Il était le commerçant le plus célèbre du pays et ses caravanes alimentaient les marchés et les ports les plus lointains. Les marchandises qu'il récoltait au cours de ces voyages étaient choisies avec le plus grand soin et vendues de même. Dans sa luxueuse demeure, les objets les plus beaux étaient mis en valeur et pouvaient être admirés par ses hôtes. Le parc était entouré d'une haute muraille blanche et devant le portail, deux Africains géants montaient la garde.
Il y avait déjà des heures que le marchand suivait une ancienne piste à la tête de ses chameaux quand il arriva enfin sur un plateau hanté de papillons bleus. Il avait arrêté son cheval pour regarder en bas, à ses pieds, la ville avec ses toits, ses remparts, son caravansérail, les coupoles bleues et or de sa mosquée. Sous le pesant soleil, l'air vibrait d'insectes et notre homme poussa sa monture vers l'ombre d'un vieux mur pour éponger quelque peu la sueur de son front. Du revers de sa manche il essuyait ses yeux quand un vieil homme, haut et droit surgit devant lui. Le soleil faisait bruire les insectes au point qu'il ne l'avait pas entendu venir. Le gros marchand avait eu un sursaut mais il s'était rassuré aussitôt et s'apprêtait à poursuivre sa route, quand le vieillard l'arrêta. De la main il lui fit signe d'entrer dans son jardin par une porte entrouverte. Poussé autant par la curiosité que par la soif, le gros marchand se glissa à travers l'embrasure et la porte se referma.
Le vieil homme le reçut fort courtoisement. Il était vêtu de façon étrange. Sur un pantalon de soie rose pâle, il portait une tunique couleur sable boutonnée sur la poitrine et une ceinture écarlate assortie à la couleur de ses babouches sanglait ses reins. L'expression de son visage était sereine.
Etait-ce une illusion ? L'air du jardin était plus frais et, les narines dilatées, le marchand le respirait ; les odeurs les plus suaves l'emplissaient. Sous le portique extérieur de la demeure, on lui apporta de l'eau parfumée pour se rafraîchir le visage et les mains, puis le thé avec des gâteaux au miel et au safran.
Le vieil homme - un ancien ministre - avait coutume de recevoir une fois durant leur passage les plus grands chefs caravaniers dans l'espoir de trouver à leur acheter quelque plante rare. Il aimait passionnément les fleurs et son jardin précieux. Il en avait grand soin et passait chaque jour de longues heures le front penché sur la fragilité de leurs calices qui étaient pour lui autant de vivants et souriants visages.
Ebloui par tant de beauté, le marchand lui demanda à visiter le merveilleux jardin.
Ensemble, les deux hommes se promenaient sous les odorantes grappes pendantes des glycines bleu-mauve et les pruniers du Japon. Mais plus ils s'enfonçaient sous la pourpre des pruniers, plus une odeur étrange, pénétrante, se mêlait au doux parfum des pivoines de Chine ; et plus l'odeur était envahissante, plus le marchand se troublait.
- Vénérable ami, dit tout à coup le caravanier, quelle est donc cette fleur extraordinaire qui de ses émanations suaves embaume pareillement l'air de votre jardin ?
Le vieil homme se contenta de sourire et conduisit le marchand jusqu'à une grotte creusée dans un énorme rocher et devant laquelle poussait de petits arbustes sur lesquels s'épanouissaient des fleurs violettes disposées en cônes serrés. Sa main longue et lente déterra une petite racine de l'un de ces arbustes et la tendit au marchand avec ces mots :
- Prenez cette petite racine et ayez-en grand soin. Veillez à son bien-être, vous en serez grandement récompensé. Mais je ne veux point d'argent. C'est un cadeau que je vous fais. Ainsi, votre caravane ramènera-t-elle tout de même une plante !
Les mains avides du marchand, crispées sur son ventre à rondeur de courge, s'en emparèrent aussitôt. Dans son visage gras, ses yeux à moitié cachés sous des plis épais, brillaient de satisfaction. Il venait de faire une bonne affaire, car si le vieil homme disait vrai, ce dont il ne doutait pas, il pourrait bientôt vendre à prix d'or des boutures de cette plante unique au monde.
Le marchand, après avoir chaleureusement remercié l'ancien ministre, prit le chemin du retour. Il avait regagné sa demeure aux sols tendus de tapis de soie. C'était le soir et les ombres envahissaient le jardin. Au pied de l'escalier le marchand s'était arrêté brusquement. Il hésitait, ayant cru entendre le murmure d'une voix douce. N'était-ce pas plutôt le frôlement des plumes éclatantes de son paon, cet oiseau merveilleux rapporté lors d'un précédent voyage et qui venait lui demander quelque friandise ? Non, ce n'était pas lui. Alors était-ce le grésillement de le lanterne en filigrane d'or dont l'huile parfumée à l'iris aurait éloigné quelque mauvais esprit ? Il hésitait encore quand la voix fluette du lilas chuchota à nouveau :
- Laisse-moi prendre racine dans un endroit à la fois frais et ensoleillé, et chaque jour donne-moi à boire un peu d'eau fraîche. Tu verras, tu n'auras pas à le regretter, je réaliserai tes souhaits.

Quelle ne fut pas la déception du lilas quand il vit le gros marchand lui creuser un trou dans un endroit que les rayons du soleil n'atteignaient jamais. Il en laissa pendre tristement les rameaux.
- A présent, dit le commerçant, tu as une place agréable où tu peux grandir et prospérer. Je n'oublierai pas de te rendre visite journellement et de t'apporter de l'eau. J'ai fait tout mon possible pour toi, et en retour, j'attends que toi aussi tu fasses rapidement de ton mieux !
Habituée à la courtoisie parfaite de l'ancien ministre, la petite plante répondit :
- Avec tous mes remerciements. J'essaierai.
Le lendemain, comme promis, le marchand lui apporta de l'eau fraîche en disant :
- Ne me déçois pas petite, grandis vite !
Et la petite racine répéta :
- J'essaierai !
Elle faisait de son mieux pour grandir, en dépit d'un sol pauvre, d'un manque d'ensoleillement et de la dureté des paroles du marchand.
Quelques jours plus tard, le caravanier lui rendit à nouveau visite et se répandit en invectives contre elle :
- Paresseuse ! Ne veux-tu vraiment pas grandir ?
- Je ne le puis, gémit la petite racine, il n'y a pas de soleil ici !
Courroucé, le marchand s'emporta et jura :
- Comment ? Il n'y pas de soleil ici ? Je t'ai offert la meilleure place de mon parc, apporté personnellement chaque jour de l'eau fraîche, donné de mon temps si précieux, et toi tu en demandes toujours davantage ! Le vieillard m'a dit que tu étais une plante merveilleuse. Il me semble qu'il m'a menti, trompé ! Et furieux, le marchand lui tourna le dos.
Le lendemain, le voyant venir de loin, la racine lui cria :
- Cher ami, je meurs de soif ! Je t'en prie, donne-moi vite à boire !
- Cher ami, répéta le commerçant en riant, quelle belle formule ! Mais moi je ne te rendrai pas la politesse en te disant "chère amie" car, premièrement tu n'es pas devenue plus chère, plus précieuse puisque tu m'as été donnée, et deuxièmement tu es une chose absolument sans valeur. Et puis, qu'as-tu à réclamer si fort de l'eau fraîche ? N'es-tu pas debout au milieu d'une petite flaque ?
- Ce ne sont que mes larmes, et de mes propres pleurs je ne puis ni me désaltérer, ni grandir !
- Ce n'est pas que tu ne "peux" pas grandir, mais que tu ne "veux" pas. Franchement dit, on m'a pris pour un imbécile. Ce vieillard - ancien ministre - n'est qu'un gredin !
En entendant ces méchantes paroles, la petite plante faillit mourir d'effroi.

A peu de temps de là, un ami du marchand, un bon vieux garçon, grand amateur de fleurs, parcourait à ses côtés le jardin pour choisir quelques plantons. Quand il aperçut le pauvre petit lilas, debout au milieu de ses larmes, il éprouva une grande pitié. Une petite voix lui chuchota à l'oreille :
- Ceci est une plante merveilleuse, achète-la !
S'adressant à son ami il demanda :
- Veux-tu me vendre cette petite plante ?
- Tu veux acheter cette chose-là ? répondit en riant le marchand. Soit ! Mais j'ai dépensé beaucoup d'argent pour elle. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance, la plante se meurt. Maintenant, si vraiment tu la veux, je te la donne volontiers.
Le vieux garçon connaissait fort bien le marchand, ne voulant ni se laisser berner, ni recevoir de cadeau, lui remit cinq pièces d'or pour la plante. Il l'emballa ensuite soigneusement dans du papier de soie et la porta chez lui. Là, la petite plante lui dit plaintivement :
- Je t'en prie, laisse-moi vivre dans un endroit frais et pourtant ensoleillé et donne-moi chaque jour un peu d'eau fraîche, tu verras, je ne te décevrai point.
Le vieux garçon hocha la tête.
- Je te donnerai tout ce que tu me demandes. Bien que tu sois petite, mon espoir est grand, et je sais que tu peux et veux grandir.
Ces bonnes paroles réconfortèrent grandement la petite plante. Consciencieusement, le vieux garçon combla tous les vœux du petit lilas et quelques jours plus tard il eut la joie de le voir développer des feuilles tendres en forme de cœur. Jour après jour, l'arbuste gagna en force et en beauté et un matin il dit à son protecteur :
- A présent, il n'est plus nécessaire que tu m'apportes de l'eau, car vois-tu, j'arrive maintenant à subvenir à mes propres besoins.
Avec le printemps, le jeune lilas qui était devenu un superbe arbuste se couvrit de grappes de fleurs odorantes.
- Tu es plus beau et plus aimable que toutes les fleurs des contes ! lui lança le vieux garçon. Mais dis-moi, pourquoi n'as-tu commencé à croître que chez moi ?
- Parce que ton amour et ta confiance en moi m'ont donnés la force de réaliser mon rêve. En reconnaissance de ton dévouement pour moi, j'ai voulu donner à mes feuilles une forme de cœur, à mes fleurs un doux parfum rappelant la noblesse et la pureté de tes pensées, et à mes racines, plongées dans un sol frais, la vertu de combattre la fièvre en souvenir de tes paroles apaisantes. Comment aurais- je pu réaliser pareilles choses chez le riche marchand qui jamais ne s'est donné vraiment la peine de patienter et de me comprendre ?
Quelque temps plus tard, le marchand rendit visite à son ami et quand il aperçut le magnifique arbuste, il pâlit de jalousie.
- Où as-tu trouvé cette plante rare ? demanda-t-il dissimulant avec beaucoup de peine sa rancune.
- Elle vient de ton jardin, dit simplement le vieux garçon.
- Impossible ! rétorqua le marchand en secouant la tête.
- Quand la foi et l'amour surpassent tout, rien n'est impossible ! répondit son ami.
Irrité, le marchand s'adressa au lilas :
- Pourquoi n'as-tu voulu ni croître ni fleurir chez moi ?
Agitant ses feuilles en forme de cœur, le lilas lui susurra :
- Parce que la patience et l'espérance te font défaut.
Le marchand tout contrit baissa la tête et caressa délicatement les belles grappes violettes. Il venait de comprendre, un peu tard, son erreur.

Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:10, édité 10 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Le Lotus Blanc
Le Lotus Blanc
Lorsque chez nous, les joncs engourdis par les premiers froids présageant l'hiver bruissent mélancoliquement sous de gros nuages noirs s'étirant lourdement au-dessus de nos lacs, les hirondelles vont se réfugier dans un pays bien au-delà de la Mer.
Dans ce pays, tout là-bas, bien loin d'ici, au bord d'un lac bleu, vivait une nymphe. Drapée dans une robe de soie blanche, elle avait coutume d'aller s'asseoir sur l'herbe de la rive, parmi les corolles brillantes des jonquilles et des narcisses. Le soleil amoureux de la délicieuse petite jeune fille, la caressait de ses doux rayons et l'invitait à le suivre. Mais la nymphe faisait la sourde oreille. Comment pouvait-elle accompagner dignement dans sa course diurne, l'astre si brillant, elle si blanche et si frêle qui n'avait pour toute fortune que sa petite robe de soie pâle ? Et, affaissée dans les plis souples de sa robe, elle songeait et soupirait, la tête inclinée vers la poitrine, la nuque comme ployée sous le fardeau de sa longue chevelure dorée et tressée de perles. Alanguis de mélancolie, ses yeux bleus, du bleu des myosotis de mai, fixaient ses bras blancs aux reflets irisés de neige qu'elle tendait vers les rayons transparents. Comme elle se sentait petite et insignifiante auprès de l'astre tout scintillant d'or !

L'air était empli du vibrant bruissement des ailes des abeilles qui, de corolle en corolle, transportaient le pollen de leurs amies, les fleurs. Une idée effleura soudain l'esprit de la petite nymphe qui se mit aussitôt au travail.
A l'instar des abeilles, elle préleva alors, de calice en calice, mais pour la voler, la précieuse poudre d'or des fleurs. Le soir venu, les poches remplies de pollen, la petite nymphe, fatiguée mais heureuse, vint se rasseoir au bord du lac. "Demain", songea-t-elle, "quand le soleil reparaîtra, je pourrai, les mains chargées d'or, l'approcher dignement. Mais en attendant, il me faut le cacher."
Le lac resplendissait dans l'ombre de la nuit, et dans le vent du soir, les roseaux avaient des bruissements étranges. Que s'y passait-il donc ? Intriguée, la lune les éclaira de son halo blanc. Elle aperçut alors la petite nymphe plongeant au fond du lac pour y déposer son trésor. Mais, entraînée par le poids de l'or, elle tomba sur le sol limoneux. Elle chercha désespérément à se défaire de son dangereux et pesant fardeau qui, à chacun de ses mouvements, l'enlisait un peu plus dans le sol vaseux du lac. Retenue par le poids de la précieuse poudre, elle ne réussit pas à se dégager du sol bourbeux pour remonter à la surface de l'eau, et succomba dans les flots.
 La lune qui avait suivi la scène, fut prise d'angoisse lorsqu'elle ne vit pas la nymphe refaire surface. Elle chercha alors à l'atteindre de ses rayons transparents. Mais, ce fut en vain que de ses rais de lumière elle balaya le fond du lac et fouilla les flots. Elle ne la trouva pas. Mais, déesse des rêves bleus, elle possédait le pouvoir de réaliser les vœux les plus désespérés...
La lune qui avait suivi la scène, fut prise d'angoisse lorsqu'elle ne vit pas la nymphe refaire surface. Elle chercha alors à l'atteindre de ses rayons transparents. Mais, ce fut en vain que de ses rais de lumière elle balaya le fond du lac et fouilla les flots. Elle ne la trouva pas. Mais, déesse des rêves bleus, elle possédait le pouvoir de réaliser les vœux les plus désespérés...
Le lendemain matin, les rayons de l'astre lumineux dansèrent amoureusement sur l'eau et les rives du lac à la recherche de la délicieuse nymphe. Ils ne la trouvèrent pas. Jamais plus, le soleil ne la revit ni ne l'entendit. Mais à la surface de l'onde apparut une grande feuille charnue en forme de coeur, au milieu de laquelle, deux petites mains d'une blancheur de cire délièrent lentement leurs doigts effilés pour s'entrouvrir comme une rose, et dans le creux de leur paume, le soleil vit étinceler un peu de cette poudre d'or qui reposait désormais au plus profond des eaux.
Et c'est ainsi que de nos jours encore, on peut voir danser au creux des vagues des lotus blancs, et leurs pétales qui ont gardé la transparence nacrée des mains de la nymphe, s'ouvrir sous les doux rayons de l'arc lumineux de l'aurore, pour offrir au soleil l'or de la gracieuse jeune fille.
Mais lorsque le soleil s'en va sous l'horizon, et que la lune émergeant de la brume crépusculaire, passe derrière le sommet des montagnes et la crête des arbres, la petite nymphe referme ses mains. Et, parmi les grandes feuilles charnues en forme de cœur, les lotus blancs portés par les vagues se reposent et rêvent, les pétales resserrés sur l'or volé et caché dans leur calice. Et la lune regarde les fleurs et sourit à leurs songes légers.
Dans ce pays, tout là-bas, bien loin d'ici, au bord d'un lac bleu, vivait une nymphe. Drapée dans une robe de soie blanche, elle avait coutume d'aller s'asseoir sur l'herbe de la rive, parmi les corolles brillantes des jonquilles et des narcisses. Le soleil amoureux de la délicieuse petite jeune fille, la caressait de ses doux rayons et l'invitait à le suivre. Mais la nymphe faisait la sourde oreille. Comment pouvait-elle accompagner dignement dans sa course diurne, l'astre si brillant, elle si blanche et si frêle qui n'avait pour toute fortune que sa petite robe de soie pâle ? Et, affaissée dans les plis souples de sa robe, elle songeait et soupirait, la tête inclinée vers la poitrine, la nuque comme ployée sous le fardeau de sa longue chevelure dorée et tressée de perles. Alanguis de mélancolie, ses yeux bleus, du bleu des myosotis de mai, fixaient ses bras blancs aux reflets irisés de neige qu'elle tendait vers les rayons transparents. Comme elle se sentait petite et insignifiante auprès de l'astre tout scintillant d'or !

L'air était empli du vibrant bruissement des ailes des abeilles qui, de corolle en corolle, transportaient le pollen de leurs amies, les fleurs. Une idée effleura soudain l'esprit de la petite nymphe qui se mit aussitôt au travail.
A l'instar des abeilles, elle préleva alors, de calice en calice, mais pour la voler, la précieuse poudre d'or des fleurs. Le soir venu, les poches remplies de pollen, la petite nymphe, fatiguée mais heureuse, vint se rasseoir au bord du lac. "Demain", songea-t-elle, "quand le soleil reparaîtra, je pourrai, les mains chargées d'or, l'approcher dignement. Mais en attendant, il me faut le cacher."
Le lac resplendissait dans l'ombre de la nuit, et dans le vent du soir, les roseaux avaient des bruissements étranges. Que s'y passait-il donc ? Intriguée, la lune les éclaira de son halo blanc. Elle aperçut alors la petite nymphe plongeant au fond du lac pour y déposer son trésor. Mais, entraînée par le poids de l'or, elle tomba sur le sol limoneux. Elle chercha désespérément à se défaire de son dangereux et pesant fardeau qui, à chacun de ses mouvements, l'enlisait un peu plus dans le sol vaseux du lac. Retenue par le poids de la précieuse poudre, elle ne réussit pas à se dégager du sol bourbeux pour remonter à la surface de l'eau, et succomba dans les flots.

Le lendemain matin, les rayons de l'astre lumineux dansèrent amoureusement sur l'eau et les rives du lac à la recherche de la délicieuse nymphe. Ils ne la trouvèrent pas. Jamais plus, le soleil ne la revit ni ne l'entendit. Mais à la surface de l'onde apparut une grande feuille charnue en forme de coeur, au milieu de laquelle, deux petites mains d'une blancheur de cire délièrent lentement leurs doigts effilés pour s'entrouvrir comme une rose, et dans le creux de leur paume, le soleil vit étinceler un peu de cette poudre d'or qui reposait désormais au plus profond des eaux.
Et c'est ainsi que de nos jours encore, on peut voir danser au creux des vagues des lotus blancs, et leurs pétales qui ont gardé la transparence nacrée des mains de la nymphe, s'ouvrir sous les doux rayons de l'arc lumineux de l'aurore, pour offrir au soleil l'or de la gracieuse jeune fille.
Mais lorsque le soleil s'en va sous l'horizon, et que la lune émergeant de la brume crépusculaire, passe derrière le sommet des montagnes et la crête des arbres, la petite nymphe referme ses mains. Et, parmi les grandes feuilles charnues en forme de cœur, les lotus blancs portés par les vagues se reposent et rêvent, les pétales resserrés sur l'or volé et caché dans leur calice. Et la lune regarde les fleurs et sourit à leurs songes légers.
Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:12, édité 3 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 L'Iris
L'Iris
Au commencement de toutes choses, disaient les Grecs, la Terre-Mère surgit du Chaos et mit au monde son premier fils : Ouranos dont le nom signifiait "le ciel'. De son union avec Gaïa - la Terre-Mère - naquirent les Titans dont Océanos - la mer - qui à son tour se penchant sur Amphitrite, engendra Iris : l'Arc-en-Ciel.
Iris vivait sur l'Olympe, rêvant, portant des messages pour Héra l'épouse de Zeus, le roi des dieux. Du haut du mont sacré, elle aimait écouter les douces sonorités de la flûte des faunes au crépuscule, et admirer les fleurs qu'elle adorait et convoitait tendrement.
Un matin, alors qu'Apollon livrait à coups de traits bataille à l'ombre, Iris tourna son front vers la terre. Partout où son regard se posait, ce n'était que splendeur. Le matin était serein et la déesse regardait vers l'Occident nébuleux les flots de la mer se déchirer sur les dures échines noires des rochers et les cormorans tour à tour plonger. Elle écoutait la voix cristalline du ruisseau, les soupirs du vent dans la forêt quand, de l'Orient, une comète vint baigner sa chevelure ardente dans les brumes d'un lac. Alors la déesse dirigea ses yeux vers la région où le soleil se promenait toujours éclatant dans un ciel pur où, le soir venu, elle y comptait plus d'étoiles que de perles dans les mers. Elle vit l'Egypte et le tapis vert de la vallée du Nil entre les deux déserts qui la rongent ; la Perse baignée du printemps éternel de ses roses ; et de la Chine les deux lignes nébuleuses avec de frêles arches de pont passant sur des cascades. Assise au haut de l'escalier céleste, Iris frissonnait tant c'était beau.
La déesse était ravissante et probablement l'ignorait. Elle ressemblait à un songe et Zeus, un pied posé sur son aigle, la regardait et n'avait point l'air fâché. Les parties de son corps que la tunique ne voilait pas, luisaient roses et translucides. Sur son dos frémissaient deux ailes bleues et diaphanes. Sa chevelure blonde était radieuse, et son souffle avait la douceur du parfum des roses de Paphos. Elle était toute innocente et sans crainte elle implora le roi des dieux pour connaître le monde auquel menait l'escalier céleste. Elle ressemblait à un songe et Zeus en avait la prunelle éblouie. Subjugué par sa beauté il s'attendrit et lui permit d'effectuer un court séjour sur terre.

Alors sur l'Olympe on vit les dieux se faire signe et s'approcher d'Iris. Hermès, le messager de Zeus lui donna pour ses beaux pieds nus, une paire de souliers ailés ; Héra, l'épouse du roi des dieux, une plume de paon lui permettant de regarder la terre avec mille yeux ; et Aphrodite la déesse de l'amour et de la beauté, sa tunique qui avait la richesse des couleurs du ciel. Quant à Zeus, il lui remit une baguette magique ornée d'une étoile scintillante qui lui permettait de disperser les nuages.
Ainsi parée, Iris attendit la fin d'une ondée printanière pour se laisser glisser le long de cette courbe profonde, jaune-orange-rouge-violette-verte et bleue, arche immense d'un pont reliant le ciel à la terre.
Bien loin au-dessous d'elle, un marais étalait ses eaux glauques. Un faune hantait ses rives, chassant parmi les joncs, poursuivant les elfes et jouant de la flûte. Quand il vit le pont de nacre se poser sur les eaux, il frissonna déconcerté, ne sachant plus s'il était sur terre ou chez les dieux. Il avait fermé les yeux et sa flûte quitté ses lèvres.
- Qui es-tu ? murmura Iris.
Le faune ouvrit d'abord un oeil, puis le second avant de lever son front inquiet vers la déesse :
- Je ne suis qu'un pauvre chèvre-pieds, un proscrit difforme et cornu qui se cache le jour et chante au crépuscule. Mais toi, tu n'es pas comme moi, tu dois être belle car ta voix est si douce. Descends de tes rayons et laisse-moi te regarder.
- L'accent de ta voix ne m'est pas inconnu, lui répondit Iris en souriant.
L'humble sylvain aux poils roux maculés de boue supplia :
- Oh, je t'en prie, ombre légère, descends dans ce ténébreux marais où j'erre, et viens embellir et bénir ces lieux de ta divine présence.
Et Iris portée par ses ailes frêles et transparentes entreprit la visite du marais et de ses alentours. Elle vit un ballet fantastique au-dessus des roseaux et des traits argentés se croiser sur les eaux. C'étaient des elfes et des sylphes qui allaient de fleur en fleur visiter les calices. A leur appel gracieux, leur reine surgit d'un bouquet de lys. Le regard joyeux, elle vint à la rencontre de sa grande soeur du ciel :
- Quel est ton nom dans les cieux ? demanda la souveraine avec un sourire un peu naïf ?
- Iris, la messagère.
Alors la reine des elfes s'écria :
- Venez, accourez tous, et toi aussi le faune. La gracieuse Iris nous honore de sa visite. Préparez-vous à recevoir dignement la messagère des dieux.
- Moi, répliqua le sylvain, je l'accueillerai comme une reine ! Sur la colline je lui ferai un palais. Je le bâtirai jour et nuit. De la base au faîte il sera d'albâtre, comme son âme sans tâche.
Et, les sabots dans la boue, le boiteux se mit à l'oeuvre. Alors les elfes et les sylphes, mais également les grenouilles, les crapauds, les libellules et les scarabées, vinrent par cent chemins divers apporter des fleurs pour embellir les marches et les salles prodigieuses.

Dans sa robe qui avait les nuances du ciel, Iris effleurait à peine le sol de ses pieds chaussés de souliers ailés, pénétra sous les vastes plafonds d'or, mais ce furent les parterres de fleurs qui charmèrent le plus ses regards.
Le soir était venu et les fleurs avaient recueilli dans leurs calices, les elfes et les sylphes, ces enfants diaphanes de la lumière qui avaient peur de la nuit. La lune s'était enfuie derrière le palais blanc d'Iris, les lotus des marais avaient pris des teintes livides et un hibou lança son cri lugubre. Tournoyant dans l'ombre sur les roseaux, les elfes noirs invitaient à leur conseil malfaisant les salamandres, les sangsues, les serpents et les rats d'eau, autres habitants du marais mais cruels ceux-là. Prêtant au marais leurs errantes lueurs rouges, ils dansèrent sous le ciel sombre, invoquant le secours des chevaux de l'orage.
Ce fut alors qu'un vent souffla et que grondant de toutes parts de lourds nuages arrivèrent. Un terrible orage éclata. Mais Iris n'était pas craintive ; elle saisit la baguette magique qui lui avait été donnée par Zeus. L'éclat et le pouvoir de son étoile dispersèrent les nuages et le ciel redevint serein.
La présence d'Iris amena calme et bonheur aux habitants du marais, et le ciel réverbérait loin autour de ses eaux, la beauté de la déesse. Les hommes et les animaux la louaient. Les elfes de la nuit, ces phalènes noires, avaient bien tenté une nouvelle fois de muer en éclairs tous les rayons de soleil d'Iris, en chargeant un nuage d'amasser une tempête. Mais cette fois, l'étoile du sceptre de la déesse transforma les grosses gouttes de pluie en perles et en pierres précieuses qui vinrent éclabousser de leurs feux multicolores les pétales de nénuphars jonchant le sol de son palais.
Alors le faune s'écria :
- Belle Iris, rayon de lumière, de mon marais ténébreux où j'errais tu as fait un jardin d'Eden. Si nulle loi ne le défend, reste parmi nous et couvre pour toujours de ta clarté ce marécage.
- Hélas, lui répondit en soupirant la déesse, je ne le puis. Là-haut, sur l'Olympe, les dieux attendent mon retour.
Le sylvain se mit à gémir :
- Tu es fille du soleil, je suis fils de la terre. Je n'ai rien à t'offrir pour m'ouvrir ton coeur. Mon malheur est irréparable, je ne suis pas un homme et je ne suis même pas beau. J'ai de la fange à mes sabots et ne sais même pas comment je me nomme. Déesse, entends-moi ! Ne nous quitte pas de crainte que l'ombre ne nous reprenne. Regarde-moi, j'ai froid, les ténèbres déjà me glacent !
- Tu exagères ! lui répondit Iris, tes yeux ne sont ouverts qu'à demi. Vois, le soleil, ce flambeau fidèle, te vient en aide. Les ténèbres de la nuit reculent devant lui. Il t'envoie la joie et te rend l'espérance, il est la vie.
- Tes paroles sont réconfortantes, fit le faune, mais nous ne te laisserons pas partir de sitôt.
L'humble sylvain alla s'asseoir sur un rocher. Et prenant sa flûte il ferma les yeux et joua un air léger. Alors les elfes, les sylphes, les nymphes, les génies de la terre et même les nains vinrent danser et chanter une chanson d'amour à l'aimable Iris.
Sur l'Olympe, les dieux épouvantés s'étaient tournés vers Zeus. Des liens solides s'étaient établis entre Iris et les mortels et il était à craindre que la déesse veuille rester sur terre où, tôt ou tard, le mal pourrait l'atteindre. Alors Zeus lui cria :
- Reviens belle enfant, car si tu venais à tomber de ton trône de fleurs, tu serais souillée par la boue de la terre.
- Je ne vois pas de quelle boue tu parles ! répliqua la déesse.
Héra l'épouse de Zeus, se mêla alors à la conversation :
- Emploie donc la plume de paon que je t'ai donnée ! Si avec elle tu avais regardé la terre du haut de l'Olympe, tu aurais pu voir son côté haïssable et jamais plus tu n'aurais souhaité y descendre.
- Reine des cieux, lui répondit Iris, je ne suis entourée que d'êtres aimant la beauté et la pureté. Aurais-je pu mieux tomber ?
Ce fut au tour d'Aphrodite d'intervenir. Par une faille des nuages sa voix se fit entendre :
- Iris, si tu ne reviens pas tout de suite, je reprends ta vaporeuse tunique, car il serait dommage de voir ses belles couleurs chatoyantes ternies par la poussière de la terre.
Amphitrite la mère d'Iris, s'approchant d'Aphrodite, dit alors à Iris d'une voix maternelle :
- Reviens mon enfant. Les dieux ont entendu la prière de tes protégés et souhaitent établir avec eux, par ton intermédiaire, de nombreux contacts.
- Et sous quel aspect me présenterai-je au faune et aux gentils sylphes et elfes ?
- Comme une courbe profonde, étincelante, une arche immense d'un pont allant du ciel à la terre.
A peine Amphitrite eut-elle prononcé ces paroles que Zeus, dont on devinait la pensée irritée à l'ombre qui flottait dans son regard, lança des éclairs et un terrible orage éclata que l'étoile du sceptre d'Iris ne put dissiper. Menacée par l'immense colère, la déesse retourna aussitôt sur l'Olympe.
Tous les dieux étaient présents, mangeant l'ambroisie et buvant le nectar. Zeus était assis à une extrémité de la table et Hermès, son messager à l'autre. Il prit la taille d'Iris passant par là et lui demanda :
- Dis-moi, qu'as-tu trouvé là en bas que tu n'as pas sur l'Olympe ?
- Cher Hermès aux pieds ailés, figure-toi que j'y ai vu un marais aux eaux mortes se transformer en miroir étincelant.
- Ce plaisir tu le dois à ma plume de paon ; expliqua Héra, car elle permet de voir toutes choses sous mille angles différents.
- Non chère épouse, tu te trompes, dit Zeus, ce n'est pas grâce à ton cadeau, mais au mien, la baguette magique, qu'elle le doit. Si Iris n'avait pas eu ce sceptre, son séjour sur terre ne lui aurait pas été aussi agréable.
- Pardonne-moi, Zeus, fit la belle Aphrodite, n'oublie pas que c'est de moi qu'elle tient sa merveilleuse tunique. Si elle n'avait pas été aussi bien vêtue, personne ne l'aurait accueillie aussi aimablement.
Alors Apollon, le dieu du soleil, fils de Zeus parla :
- Je vous en prie, ne vous querellez pas entre vous ! Vous êtes des dieux, non des mortels !
Iris prit ensuite la parole :
- Je vous remercie grands dieux et déesses de m'avoir permis de tout observer sur terre. J'ai vu un marais aux eaux fangeuses et putrides devenir beau et pur, lorsque de ses profondeurs j'ai vu surgir de grands lys , les uns d'un blanc radieux, les autres d'un rouge et d'un bleu vifs. Pour m'honorer, les mortels appelèrent ces belles fleurs nées des eaux glauques du marais : Iris. Aussi, cher Hermès, je te serais reconnaissante de faire savoir aux humains, au cours de ton prochain voyage, que je retournerai les voir quand la lumière de l'espoir déclinera à nouveau.
Zeus songeur caressait sa barbe frisée. Au fond d'un bois au pied de l'Olympe, le faune, ce joyeux compagnon des nymphes dansantes, éternellement amoureux, éternellement repoussé car laid à faire peur, chantait calme et triste. Les dieux riaient et Iris déconcertée ne savait si c'était d'elle ou du pauvre chèvre-pieds. Alors Zeus qui seul ne riait pas, mit un doigt sur sa bouche et dit : Silence ! Le faune qui avait peut-être entendu prit ses pipeaux et se mit à jouer avec virtuosité. Recueillis, les Olympiens écoutaient la mélodie enchanteresse.

Iris vivait sur l'Olympe, rêvant, portant des messages pour Héra l'épouse de Zeus, le roi des dieux. Du haut du mont sacré, elle aimait écouter les douces sonorités de la flûte des faunes au crépuscule, et admirer les fleurs qu'elle adorait et convoitait tendrement.
Un matin, alors qu'Apollon livrait à coups de traits bataille à l'ombre, Iris tourna son front vers la terre. Partout où son regard se posait, ce n'était que splendeur. Le matin était serein et la déesse regardait vers l'Occident nébuleux les flots de la mer se déchirer sur les dures échines noires des rochers et les cormorans tour à tour plonger. Elle écoutait la voix cristalline du ruisseau, les soupirs du vent dans la forêt quand, de l'Orient, une comète vint baigner sa chevelure ardente dans les brumes d'un lac. Alors la déesse dirigea ses yeux vers la région où le soleil se promenait toujours éclatant dans un ciel pur où, le soir venu, elle y comptait plus d'étoiles que de perles dans les mers. Elle vit l'Egypte et le tapis vert de la vallée du Nil entre les deux déserts qui la rongent ; la Perse baignée du printemps éternel de ses roses ; et de la Chine les deux lignes nébuleuses avec de frêles arches de pont passant sur des cascades. Assise au haut de l'escalier céleste, Iris frissonnait tant c'était beau.
La déesse était ravissante et probablement l'ignorait. Elle ressemblait à un songe et Zeus, un pied posé sur son aigle, la regardait et n'avait point l'air fâché. Les parties de son corps que la tunique ne voilait pas, luisaient roses et translucides. Sur son dos frémissaient deux ailes bleues et diaphanes. Sa chevelure blonde était radieuse, et son souffle avait la douceur du parfum des roses de Paphos. Elle était toute innocente et sans crainte elle implora le roi des dieux pour connaître le monde auquel menait l'escalier céleste. Elle ressemblait à un songe et Zeus en avait la prunelle éblouie. Subjugué par sa beauté il s'attendrit et lui permit d'effectuer un court séjour sur terre.

Alors sur l'Olympe on vit les dieux se faire signe et s'approcher d'Iris. Hermès, le messager de Zeus lui donna pour ses beaux pieds nus, une paire de souliers ailés ; Héra, l'épouse du roi des dieux, une plume de paon lui permettant de regarder la terre avec mille yeux ; et Aphrodite la déesse de l'amour et de la beauté, sa tunique qui avait la richesse des couleurs du ciel. Quant à Zeus, il lui remit une baguette magique ornée d'une étoile scintillante qui lui permettait de disperser les nuages.
Ainsi parée, Iris attendit la fin d'une ondée printanière pour se laisser glisser le long de cette courbe profonde, jaune-orange-rouge-violette-verte et bleue, arche immense d'un pont reliant le ciel à la terre.
Bien loin au-dessous d'elle, un marais étalait ses eaux glauques. Un faune hantait ses rives, chassant parmi les joncs, poursuivant les elfes et jouant de la flûte. Quand il vit le pont de nacre se poser sur les eaux, il frissonna déconcerté, ne sachant plus s'il était sur terre ou chez les dieux. Il avait fermé les yeux et sa flûte quitté ses lèvres.
- Qui es-tu ? murmura Iris.
Le faune ouvrit d'abord un oeil, puis le second avant de lever son front inquiet vers la déesse :
- Je ne suis qu'un pauvre chèvre-pieds, un proscrit difforme et cornu qui se cache le jour et chante au crépuscule. Mais toi, tu n'es pas comme moi, tu dois être belle car ta voix est si douce. Descends de tes rayons et laisse-moi te regarder.
- L'accent de ta voix ne m'est pas inconnu, lui répondit Iris en souriant.
L'humble sylvain aux poils roux maculés de boue supplia :
- Oh, je t'en prie, ombre légère, descends dans ce ténébreux marais où j'erre, et viens embellir et bénir ces lieux de ta divine présence.
Et Iris portée par ses ailes frêles et transparentes entreprit la visite du marais et de ses alentours. Elle vit un ballet fantastique au-dessus des roseaux et des traits argentés se croiser sur les eaux. C'étaient des elfes et des sylphes qui allaient de fleur en fleur visiter les calices. A leur appel gracieux, leur reine surgit d'un bouquet de lys. Le regard joyeux, elle vint à la rencontre de sa grande soeur du ciel :
- Quel est ton nom dans les cieux ? demanda la souveraine avec un sourire un peu naïf ?
- Iris, la messagère.
Alors la reine des elfes s'écria :
- Venez, accourez tous, et toi aussi le faune. La gracieuse Iris nous honore de sa visite. Préparez-vous à recevoir dignement la messagère des dieux.
- Moi, répliqua le sylvain, je l'accueillerai comme une reine ! Sur la colline je lui ferai un palais. Je le bâtirai jour et nuit. De la base au faîte il sera d'albâtre, comme son âme sans tâche.
Et, les sabots dans la boue, le boiteux se mit à l'oeuvre. Alors les elfes et les sylphes, mais également les grenouilles, les crapauds, les libellules et les scarabées, vinrent par cent chemins divers apporter des fleurs pour embellir les marches et les salles prodigieuses.

Dans sa robe qui avait les nuances du ciel, Iris effleurait à peine le sol de ses pieds chaussés de souliers ailés, pénétra sous les vastes plafonds d'or, mais ce furent les parterres de fleurs qui charmèrent le plus ses regards.
Le soir était venu et les fleurs avaient recueilli dans leurs calices, les elfes et les sylphes, ces enfants diaphanes de la lumière qui avaient peur de la nuit. La lune s'était enfuie derrière le palais blanc d'Iris, les lotus des marais avaient pris des teintes livides et un hibou lança son cri lugubre. Tournoyant dans l'ombre sur les roseaux, les elfes noirs invitaient à leur conseil malfaisant les salamandres, les sangsues, les serpents et les rats d'eau, autres habitants du marais mais cruels ceux-là. Prêtant au marais leurs errantes lueurs rouges, ils dansèrent sous le ciel sombre, invoquant le secours des chevaux de l'orage.
Ce fut alors qu'un vent souffla et que grondant de toutes parts de lourds nuages arrivèrent. Un terrible orage éclata. Mais Iris n'était pas craintive ; elle saisit la baguette magique qui lui avait été donnée par Zeus. L'éclat et le pouvoir de son étoile dispersèrent les nuages et le ciel redevint serein.
La présence d'Iris amena calme et bonheur aux habitants du marais, et le ciel réverbérait loin autour de ses eaux, la beauté de la déesse. Les hommes et les animaux la louaient. Les elfes de la nuit, ces phalènes noires, avaient bien tenté une nouvelle fois de muer en éclairs tous les rayons de soleil d'Iris, en chargeant un nuage d'amasser une tempête. Mais cette fois, l'étoile du sceptre de la déesse transforma les grosses gouttes de pluie en perles et en pierres précieuses qui vinrent éclabousser de leurs feux multicolores les pétales de nénuphars jonchant le sol de son palais.
Alors le faune s'écria :
- Belle Iris, rayon de lumière, de mon marais ténébreux où j'errais tu as fait un jardin d'Eden. Si nulle loi ne le défend, reste parmi nous et couvre pour toujours de ta clarté ce marécage.
- Hélas, lui répondit en soupirant la déesse, je ne le puis. Là-haut, sur l'Olympe, les dieux attendent mon retour.
Le sylvain se mit à gémir :
- Tu es fille du soleil, je suis fils de la terre. Je n'ai rien à t'offrir pour m'ouvrir ton coeur. Mon malheur est irréparable, je ne suis pas un homme et je ne suis même pas beau. J'ai de la fange à mes sabots et ne sais même pas comment je me nomme. Déesse, entends-moi ! Ne nous quitte pas de crainte que l'ombre ne nous reprenne. Regarde-moi, j'ai froid, les ténèbres déjà me glacent !
- Tu exagères ! lui répondit Iris, tes yeux ne sont ouverts qu'à demi. Vois, le soleil, ce flambeau fidèle, te vient en aide. Les ténèbres de la nuit reculent devant lui. Il t'envoie la joie et te rend l'espérance, il est la vie.
- Tes paroles sont réconfortantes, fit le faune, mais nous ne te laisserons pas partir de sitôt.
L'humble sylvain alla s'asseoir sur un rocher. Et prenant sa flûte il ferma les yeux et joua un air léger. Alors les elfes, les sylphes, les nymphes, les génies de la terre et même les nains vinrent danser et chanter une chanson d'amour à l'aimable Iris.
Sur l'Olympe, les dieux épouvantés s'étaient tournés vers Zeus. Des liens solides s'étaient établis entre Iris et les mortels et il était à craindre que la déesse veuille rester sur terre où, tôt ou tard, le mal pourrait l'atteindre. Alors Zeus lui cria :
- Reviens belle enfant, car si tu venais à tomber de ton trône de fleurs, tu serais souillée par la boue de la terre.
- Je ne vois pas de quelle boue tu parles ! répliqua la déesse.
Héra l'épouse de Zeus, se mêla alors à la conversation :
- Emploie donc la plume de paon que je t'ai donnée ! Si avec elle tu avais regardé la terre du haut de l'Olympe, tu aurais pu voir son côté haïssable et jamais plus tu n'aurais souhaité y descendre.
- Reine des cieux, lui répondit Iris, je ne suis entourée que d'êtres aimant la beauté et la pureté. Aurais-je pu mieux tomber ?
Ce fut au tour d'Aphrodite d'intervenir. Par une faille des nuages sa voix se fit entendre :
- Iris, si tu ne reviens pas tout de suite, je reprends ta vaporeuse tunique, car il serait dommage de voir ses belles couleurs chatoyantes ternies par la poussière de la terre.
Amphitrite la mère d'Iris, s'approchant d'Aphrodite, dit alors à Iris d'une voix maternelle :
- Reviens mon enfant. Les dieux ont entendu la prière de tes protégés et souhaitent établir avec eux, par ton intermédiaire, de nombreux contacts.
- Et sous quel aspect me présenterai-je au faune et aux gentils sylphes et elfes ?
- Comme une courbe profonde, étincelante, une arche immense d'un pont allant du ciel à la terre.
A peine Amphitrite eut-elle prononcé ces paroles que Zeus, dont on devinait la pensée irritée à l'ombre qui flottait dans son regard, lança des éclairs et un terrible orage éclata que l'étoile du sceptre d'Iris ne put dissiper. Menacée par l'immense colère, la déesse retourna aussitôt sur l'Olympe.
Tous les dieux étaient présents, mangeant l'ambroisie et buvant le nectar. Zeus était assis à une extrémité de la table et Hermès, son messager à l'autre. Il prit la taille d'Iris passant par là et lui demanda :
- Dis-moi, qu'as-tu trouvé là en bas que tu n'as pas sur l'Olympe ?
- Cher Hermès aux pieds ailés, figure-toi que j'y ai vu un marais aux eaux mortes se transformer en miroir étincelant.
- Ce plaisir tu le dois à ma plume de paon ; expliqua Héra, car elle permet de voir toutes choses sous mille angles différents.
- Non chère épouse, tu te trompes, dit Zeus, ce n'est pas grâce à ton cadeau, mais au mien, la baguette magique, qu'elle le doit. Si Iris n'avait pas eu ce sceptre, son séjour sur terre ne lui aurait pas été aussi agréable.
- Pardonne-moi, Zeus, fit la belle Aphrodite, n'oublie pas que c'est de moi qu'elle tient sa merveilleuse tunique. Si elle n'avait pas été aussi bien vêtue, personne ne l'aurait accueillie aussi aimablement.
Alors Apollon, le dieu du soleil, fils de Zeus parla :
- Je vous en prie, ne vous querellez pas entre vous ! Vous êtes des dieux, non des mortels !
Iris prit ensuite la parole :
- Je vous remercie grands dieux et déesses de m'avoir permis de tout observer sur terre. J'ai vu un marais aux eaux fangeuses et putrides devenir beau et pur, lorsque de ses profondeurs j'ai vu surgir de grands lys , les uns d'un blanc radieux, les autres d'un rouge et d'un bleu vifs. Pour m'honorer, les mortels appelèrent ces belles fleurs nées des eaux glauques du marais : Iris. Aussi, cher Hermès, je te serais reconnaissante de faire savoir aux humains, au cours de ton prochain voyage, que je retournerai les voir quand la lumière de l'espoir déclinera à nouveau.
Zeus songeur caressait sa barbe frisée. Au fond d'un bois au pied de l'Olympe, le faune, ce joyeux compagnon des nymphes dansantes, éternellement amoureux, éternellement repoussé car laid à faire peur, chantait calme et triste. Les dieux riaient et Iris déconcertée ne savait si c'était d'elle ou du pauvre chèvre-pieds. Alors Zeus qui seul ne riait pas, mit un doigt sur sa bouche et dit : Silence ! Le faune qui avait peut-être entendu prit ses pipeaux et se mit à jouer avec virtuosité. Recueillis, les Olympiens écoutaient la mélodie enchanteresse.

Dernière édition par Freya le Mer 17 Avr 2013 - 16:20, édité 4 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 La Rose de France
La Rose de France
C'était aux premiers temps de la terre, à l'heure où Aquilon attelait les ardents chevaux du soleil au quadrige radieux. Impatients, les fougueux animaux piaffaient et se cabraient. Enfin, les battants de la porte du ciel s'ouvrirent et derrière leur poitrail blanc dressé apparut l'orbe d'or du char céleste. Secouant leurs crinières ils firent tomber de leurs naseaux fumants des gouttes de rosée sur la nature.
Ce jour de printemps que les chevaux de l'aurore versaient sur l'univers était plus beau encore. Les feuillages des arbres bruissaient de mouvements plus doux et les rayons du soleil tombaient plus caressants sur les fleurs humides de rosée, car le dieu Apollon, menant d'une main son attelage et de l'autre jetant mille baisers dans les fleurs, semait l'amour. Autour de leurs corolles ce n'était qu'un affolement d'ailes transparentes ; les abeilles, ces petites amoureuses des frais myosotis, des pervenches et des jasmins, allaient, venaient, s'en allaient, revenaient. Le dieu Zeus contemplait l'univers apaisé, mélodieux et son regard tomba sur leurs essaims. Qu'avaient donc, ce matin, ces petits insectes surprenants ? Les abeilles s'agitaient autour d'une fleur inconnue, nouvellement épanouie, sortie toute rose et embaumée de son urne verte. La première rose venait de s'ouvrir et faisait rayonner sa splendide fraîcheur. Dans le doux vent du soir tiédi par les rayons d'or, elle envoyait ses baisers odorants dont le parfum s'envola vers Apollon en murmurant : Je t'aime.
Quand Zeus accoudé à son trône d'airain, vit grandir les ombres et monter les premières constellations, il cueillit la rose et lui dit :
- Pauvre fleur, va, là où le soleil vermeil, les voiles et les nuages s'en vont : sur la mer, cet abîme profond. Fane-toi sur les vagues où palpite la vie. Apollon mon fils t'a créée pour la mer. Moi, je te donne à l'amour.
Alors un tumultueux zéphyr effleura les nuages, d'un coup d'aile rapide effeuilla la rose dans l'onde et mêla les flots. Et Zeus n'avait plus dans sa main qu'une tige hérissée d'épines. Il se pencha et vit sur l'onde les pétales épars tournoyer et s'en aller de tous les côtés.
Du jour, il ne restait qu'une vague lueur bleuâtre et Zeus était bien un peu triste au fond de sa pensée.

Cette nuit-là, comme pour un mystère, la lune s'était voilée. Les flots par moments se striaient d'un pâle éclair, c'était le trident de Neptune, dieu de la mer, sorti de l'une de ses grottes de coquillages. Il remontait des fonds mystérieux pour gagner le golfe bleu d'une petite île aux vertes collines qui se miraient dans les flots clairs. Là, noyés et roulés par les vagues aux mille étincelles, gisaient des pétales de la rose. Sous les pas de Neptune, ils s'efforcèrent de s'élever du sable pur mais leurs ailes blessées les firent retomber mollement dans les mains du dieu. Il contempla leur forme et respira leur parfum suave qui lui rappela de douces aventures. L'âme troublée, le dieu se surprit à rêver. Alors dans le sein mystérieux de la mer, il commença un lent travail que lui seul connaissait : avec la fraîcheur et l'écume de la vague qui courait, les rayons de la lune qui traînaient, il fit des échanges dont lui seul avait le secret et transforma les pétales en un grand coquillage qui avait l'éclat des perles d'Orient avec en plus, un chatoiement rose.
Dans l'aube incertaine du lendemain, le reflet lointain d'un mystérieux rayon doré dansait dans les plis des vagues sombres où quelque chose semblait palpiter. Et voilà qu'à travers la brume matinale, montant du fond de la mer insondable, surgit Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Quel éblouissement ce fut jusqu'aux cieux sublimes où les dieux distraits s'étaient penchés pour mieux la voir. Le ciel avait ouvert ses portes et une avalanche d'or se répandit dans l'azur embrasant l'horizon et la terre pleine d'ombres.
Cernée d'un halo pâle et lustré, Aphrodite se tenait assise sur l'énorme coquillage, oeuvre de Neptune. Sa robe légère flottait dans le vent autour de son souple corps rose et translucide comme l'albâtre. Son souffle doux comme le zéphyr embaumait l'air comme une fleur. Ses lèvres d'un vermeil un peu pâle mêlait un tendre sourire à son chant, attirant l'attention des oiseaux qui gazouillaient là-bas sur l'île de Cythère. Les hirondelles, ces amoureuses de l'azur, et les colombes pures qui nous disent que tout est fait pour aimer, s'envolèrent poussées vers le ciel bleu. Elles rencontrèrent la déesse au milieu de la vaste aventure des flots, et l'entourèrent de leurs tendres essaims.


Alors Aphrodite soufflant dans une conque, appela les bons petits génies de la mer. Planant sur les eaux, ils rassemblaient les derniers pétales et en firent un sceptre royal pour leur maîtresse et déesse. La rose était comblée.
Aujourd'hui encore, la Rose de France se réjouit quand un coup de vent l'effeuille, car elle sait que ses pétales en forme de coquillages s'envoleront vers une île de beauté, et que l'un ou l'autre sera choisi pour orner le sceptre de la déesse de l'amour et porter ses ordres.
Chère enfant, en observant bien une Rose de France, tu reconnaîtras sur ses pétales le dessin d'un coquillage. Aimée d'Apollon, elle fait pour lui en son cœur ce parfum si doux, et les fins fils d'or que tu pourras y voir si profondément enfouis, sont en réalité des rayons de soleil.

Ce jour de printemps que les chevaux de l'aurore versaient sur l'univers était plus beau encore. Les feuillages des arbres bruissaient de mouvements plus doux et les rayons du soleil tombaient plus caressants sur les fleurs humides de rosée, car le dieu Apollon, menant d'une main son attelage et de l'autre jetant mille baisers dans les fleurs, semait l'amour. Autour de leurs corolles ce n'était qu'un affolement d'ailes transparentes ; les abeilles, ces petites amoureuses des frais myosotis, des pervenches et des jasmins, allaient, venaient, s'en allaient, revenaient. Le dieu Zeus contemplait l'univers apaisé, mélodieux et son regard tomba sur leurs essaims. Qu'avaient donc, ce matin, ces petits insectes surprenants ? Les abeilles s'agitaient autour d'une fleur inconnue, nouvellement épanouie, sortie toute rose et embaumée de son urne verte. La première rose venait de s'ouvrir et faisait rayonner sa splendide fraîcheur. Dans le doux vent du soir tiédi par les rayons d'or, elle envoyait ses baisers odorants dont le parfum s'envola vers Apollon en murmurant : Je t'aime.
Quand Zeus accoudé à son trône d'airain, vit grandir les ombres et monter les premières constellations, il cueillit la rose et lui dit :
- Pauvre fleur, va, là où le soleil vermeil, les voiles et les nuages s'en vont : sur la mer, cet abîme profond. Fane-toi sur les vagues où palpite la vie. Apollon mon fils t'a créée pour la mer. Moi, je te donne à l'amour.
Alors un tumultueux zéphyr effleura les nuages, d'un coup d'aile rapide effeuilla la rose dans l'onde et mêla les flots. Et Zeus n'avait plus dans sa main qu'une tige hérissée d'épines. Il se pencha et vit sur l'onde les pétales épars tournoyer et s'en aller de tous les côtés.
Du jour, il ne restait qu'une vague lueur bleuâtre et Zeus était bien un peu triste au fond de sa pensée.

Cette nuit-là, comme pour un mystère, la lune s'était voilée. Les flots par moments se striaient d'un pâle éclair, c'était le trident de Neptune, dieu de la mer, sorti de l'une de ses grottes de coquillages. Il remontait des fonds mystérieux pour gagner le golfe bleu d'une petite île aux vertes collines qui se miraient dans les flots clairs. Là, noyés et roulés par les vagues aux mille étincelles, gisaient des pétales de la rose. Sous les pas de Neptune, ils s'efforcèrent de s'élever du sable pur mais leurs ailes blessées les firent retomber mollement dans les mains du dieu. Il contempla leur forme et respira leur parfum suave qui lui rappela de douces aventures. L'âme troublée, le dieu se surprit à rêver. Alors dans le sein mystérieux de la mer, il commença un lent travail que lui seul connaissait : avec la fraîcheur et l'écume de la vague qui courait, les rayons de la lune qui traînaient, il fit des échanges dont lui seul avait le secret et transforma les pétales en un grand coquillage qui avait l'éclat des perles d'Orient avec en plus, un chatoiement rose.
Dans l'aube incertaine du lendemain, le reflet lointain d'un mystérieux rayon doré dansait dans les plis des vagues sombres où quelque chose semblait palpiter. Et voilà qu'à travers la brume matinale, montant du fond de la mer insondable, surgit Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Quel éblouissement ce fut jusqu'aux cieux sublimes où les dieux distraits s'étaient penchés pour mieux la voir. Le ciel avait ouvert ses portes et une avalanche d'or se répandit dans l'azur embrasant l'horizon et la terre pleine d'ombres.
Cernée d'un halo pâle et lustré, Aphrodite se tenait assise sur l'énorme coquillage, oeuvre de Neptune. Sa robe légère flottait dans le vent autour de son souple corps rose et translucide comme l'albâtre. Son souffle doux comme le zéphyr embaumait l'air comme une fleur. Ses lèvres d'un vermeil un peu pâle mêlait un tendre sourire à son chant, attirant l'attention des oiseaux qui gazouillaient là-bas sur l'île de Cythère. Les hirondelles, ces amoureuses de l'azur, et les colombes pures qui nous disent que tout est fait pour aimer, s'envolèrent poussées vers le ciel bleu. Elles rencontrèrent la déesse au milieu de la vaste aventure des flots, et l'entourèrent de leurs tendres essaims.


Aphrodite et les autres Néréides.
Les derniers pétales de la rose tournoyaient sur mille vaguelettes d'or autour de la déesse, et leur parfum se fondait dans les rayons du soleil. Aphrodite se demanda quel était cet encens divin qui montait jusqu'à elle, et dans un de ses mouvements au rythme doux, elle se pencha légèrement en avant et aperçut les pétales qui cherchaient le bout de ses orteils roses avec leurs lèvres mi-closes. Et l'âme de la fleur parla à son cœur de femme.Alors Aphrodite soufflant dans une conque, appela les bons petits génies de la mer. Planant sur les eaux, ils rassemblaient les derniers pétales et en firent un sceptre royal pour leur maîtresse et déesse. La rose était comblée.
Aujourd'hui encore, la Rose de France se réjouit quand un coup de vent l'effeuille, car elle sait que ses pétales en forme de coquillages s'envoleront vers une île de beauté, et que l'un ou l'autre sera choisi pour orner le sceptre de la déesse de l'amour et porter ses ordres.
Chère enfant, en observant bien une Rose de France, tu reconnaîtras sur ses pétales le dessin d'un coquillage. Aimée d'Apollon, elle fait pour lui en son cœur ce parfum si doux, et les fins fils d'or que tu pourras y voir si profondément enfouis, sont en réalité des rayons de soleil.

Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:18, édité 3 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 La pomme de l'immortalité
La pomme de l'immortalité
Aux Indes vivait une fois, il y a bien longtemps, un homme avisé du nom de Saad. Avec sa femme Maya, il habitait une modeste maison faite de briques de boue séchée, au bord d'une épaisse forêt. Il purifiait son cœur par la méditation et la prière, et c'est avec amabilité et serviabilité qu'il accueillait les voyageurs épuisés, assoiffés et affamés.
Sa réputation d'homme sage avait dépassé largement les frontières de son pays, et tout le monde s'accordait à l'estimer heureux, et à l'admirer.
Or un jour, Dieu à qui rien n'échappe, décida de récompenser Saad. Il lui envoya un messager qui se présenta devant notre sage, et lui remit avec ces paroles, une belle pomme rouge :
- Vois, le Dieu du Ciel m'envoie pour te remettre en récompense de tes bienfaits, ce précieux fruit. Si tu manges cette pomme, tu obtiendras la vie éternelle.
Modestement Saad répondit:
- Je ne suis pas digne d'un tel présent.
- N'oublie pas, répéta le messager du ciel, si tu manges cette pomme, tu devras vivre éternellement. Tu n'es pas seulement bon envers les hommes, mais encore plein de compassion pour les animaux de la forêt. Ta vie est digne de cet hommage.
Saad prit la pomme et la porta à ses lèvres lorsque sa femme l'appela :
- Pourquoi, se demanda-t-il soudain, ma femme ne devrait-elle pas partager avec moi ce cadeau divin, elle qui depuis tant d'années partage ma destinée, les instants heureux aussi bien que ceux qui le sont moins ?
Et il rejoignit Maya, lui raconta la visite du messager divin, lui rapporta ses paroles, et finalement, l'invita à consommer la pomme avec lui.
- Tu es fou ! rétorqua Maya. Crois-tu que j'ai envie de vivre éternellement, ici, au bord de cette sombre forêt ?
- Femme ! Interjeta le mari, ne blasphème pas !
- Te sens-tu capable de servir éternellement les dieux en même temps que les hommes que le hasard ou la volonté du ciel amènent ici ? demanda Maya. Veux-tu vraiment vivre perpétuellement à l'ombre de cette vaste forêt ?
- N'avons-nous pas été heureux à l'abri de ces hauts arbres ? répliqua Saad. Il y fait bon vivre. Là, le vent bruissant dans les cimes nous souffle à l'oreille bien des mystères et de doux secrets. Ici, loin de l'humanité haïssante et méprisable, on goûte la paix divine de la nature, et chaque lever de soleil nous redonne force et courage nouveaux. Mais voilà, seulement celui qui sait vivre sans s’abandonner au mal, est capable de passer sa vie dans la forêt.
- Je ne vois pas quel mal il y a à vivre avec d’autres hommes dans une ville, et encore moins quelles fautes on peut y commettre, grommela Maya. J’aimerais connaître d’autres mélodies que l’éternel gazouillis des oiseaux dans les branches. Je souhaiterais une meilleure nourriture que ces légumes fades, ces baies gorgées d’eau, et ces noix si dures que tu m’apportes chaque jour à la cuisine. Et puis, je voudrais dépenser de l’argent, avoir beaucoup d’amis autour de moi, aller au théâtre, visiter des palais, des temples... Car, vois-tu Saad, la symétrie des troncs de ces arbres géants m’effraie et commence même à m’étreindre le cœur. Je veux entendre des éclats de rire, des voix jeunes, des musiques... Ici, au pied des arbres, il n’y a rien de tout cela.
- Pauvre femme, songea à haute voix Saad. Ces grands bois dont l’auguste tranquillité t’effraie, tu les regretteras pourtant encore, et toute ta vie, je le crains. Moi, je ne connais pas de chant plus mélodieux que le gazouillis de l’oiseau, pas de meilleurs amis que les animaux, pas de palais ou de temple plus beau que cette haute, très haute forêt, avec ses fûts d’arbres polis et baignés de lueurs bleuâtres même en plein jour. Je n’ai jamais rien vu de plus éclatant, de plus noble que le lever et le coucher du soleil, que la lumière de la lune et des étoiles, ou encore, que le ruban scintillant du fleuve.
- Oh ! Je suis saturée de tout cela mon ami, répondit Maya, mais crois-moi, vends plutôt cette pomme pour une forte somme d’argent, de façon à ce que nous devenions riches et puissions encore bien profiter de notre vie.
- Mais alors, ce paysage, ce coin de terre que j’aime tant, je devrais l’abandonner ?
- Avec le prix que tu tireras de ce fruit qui donne la vie éternelle, tu pourras t’acheter les plus belles terres et faire construire des temples prestigieux que le peuple, quand il voudra prier Dieu, viendra visiter en pèlerinage. Mais au fait Saad, as-tu une preuve quelconque que cette pomme rouge, d’apparence ordinaire, donnera réellement la vie éternelle à celui qui la croquera ? J’ai des doutes. Mais laisse-le croire aux autres, et profite plutôt de la crédulité du premier venu pour lui demander un bon prix.


Saad réfléchit.
- Que dois-je faire ? se demanda-t-il. J’aime ma femme, mais que sait-elle, la pauvre, de la Sagesse et de l’Ignorance ? Peut-être que mon premier devoir serait de la récompenser pour tout l’amour qu’elle m’a prodigué tout au long de ces nombreuses années écoulées, plutôt que de m’assurer une vie éternelle.
- Cette pomme vaut son pesant d’or, nous réaliserons notre fortune, s’écria Maya. Nous déménagerons dans une grande ville et coulerons des jours heureux. Mais nous ne demeurerons pas les seuls à bénéficier des bienfaits de la vente de cette pomme, car nous assurerons le pain à des milliers de malheureux. Ainsi, plutôt que de vivre indéfiniment ici-bas, sur cette terre de misère, nous nous achèterons une vie éternelle, mais au ciel !
- Tu as raison, dit le brave homme à sa femme.
Ils firent aussitôt leurs préparatifs de départ, et se mirent en route pour la ville la plus proche.
Pendant ce temps, le roi qui régnait alors sur le pays, avait quitté sa capitale pour gagner sa résidence d’été qui s’élevait précisément dans la ville vers laquelle marchaient Saad et Maya.
La réputation de sagesse de Saad était parvenue jusqu’aux oreilles du roi qui désirait vivement le rencontrer. Aussi, à peine fut-il arrivé dans son palais d’été, qu’il envoya ses gardes quérir Saad.
Les cavaliers envahirent la vieille cité. Le Commandant de la Garde coiffé d’un casque de bronze avait pris la tête du détachement.
- C’est bien Saad, le Sage que j’ai présentement devant mes yeux ? demanda-t-il. Le roi veut te voir.
Saad n’eut même pas le temps d’acquiescer que déjà les bras puissants du guerrier le soulevaient de terre, et que son cheval lancé au galop, les emportait par les places et les rues vers la résidence royale.

Les gardes.
Les murs du palais étaient de porcelaine. Dans la cour, Saad vit une armée de serviteurs s’affairer autour d’une centaine d’éléphants, de chameaux, de chevaux racés, tous harnachés de cuirs rutilants avec des selles de soie rouge et or sur le dos... Dans les jardins qui menaient au pavillon privé du roi, des paons, des hérons et des ibis lissaient leurs plumes avec de longs claquements de bec. Puis, les pas des gardes résonnèrent sur les degrés d’un escalier de jade qui menait à la grande salle du palais. Devant le trône, sur le sol parqueté d’écailles nacrées de coquillages où ses pieds nus et poussiéreux marquaient tous leurs pas, Saad se prosterna devant le souverain.
- Seigneur mon roi, dit-il, permet à ton humble serviteur de t’offrir la pomme de l’immortalité.
- La pomme de la vie éternelle ? S’enquit étonné le roi. Non, mon ami, je ne suis pas digne d’un tel cadeau. Mais tu peux, si tu veux, la laisser là. Mon trésorier t’en donnera cinquante bourses d’or.
Le soir vint, et le roi obsédé par l’histoire de la pomme, descendit dans son jardin où il se promena seul. Sur l’eau sombre du lac de son parc, et sur le ciel incandescent du couchant, des vols d’ibis roses apparurent entre les arbres en fleurs. Abîmé dans ses pensées profondes, il n’aperçut pas tout de suite la reine qui l’observait depuis la terrasse.
- Ah ! s’écria soudain le roi en la voyant, tu arrives au bon moment, viens ma douce compagne !
La reine descendit les degrés de l’escalier, et le roi pu contempler sa lourde chevelure noire empourprée d’une pivoine, et sa robe de soie couleur safran brodée de plumes de paon.
- Saad, le Sage de la forêt dont tu as déjà entendu parler, lui dit-il, m’a apporté la pomme de la vie éternelle. Tu dois manger cette pomme, car aucune autre femme n’est digne de ce cadeau divin. Je n’en connais point qui ait une voix aussi cristalline, qui soit aussi belle et noble que toi. Mange ce fruit de l’immortalité afin que ta beauté enchante éternellement le monde.
La reine sourit et se laissa tendrement embrasser sur le front par son époux. Elle prit ensuite la pomme et se retira dans ses appartements privés qu’elle arpenta toute la nuit. Au petit matin, après mûre réflexion, la dame conclut :
- Non, je ne mangerai pas la pomme de la vie éternelle. Je vais en faire cadeau à ma fillette, car elle est encore plus jeune et plus belle que moi. Et la reine fit mander la princesse.
- Mon enfant, lui dit la souveraine, un très grand bonheur t’échoit aujourd’hui. Vois, je t’offre la pomme de la vie éternelle.
- Oh chère maman, lui répondit la princesse, voilà certes un cadeau tout à fait exceptionnel que tu me fais là, mais je me trouve bien jeune et je dois me prouver à moi-même que je mérite ce fruit sacré.
Elle prit la pomme et se retira.
La reine la suivit du regard et sourit.
- Ainsi, songea-t-elle, la beauté pure, l’amabilité de cette toute jeune fille seront conservés à tout jamais à l’humanité.

La reine.
La princesse se rendit dans son pavillon aux murs tendus de soie dans les couleurs les plus tendres de l’eau, et tout dans ses appartements au bord du lac, brillait d’or et d’argent. Mais la princesse ne songeait nullement à la pomme. C’était le beau, l’élégant Commandant de la Garde de son père, qui occupait toutes ses pensées. Chaque matin, depuis sa fenêtre, elle le voyait traverser le parc.
- C’est lui qui doit recevoir la pomme de la vie éternelle se dit-elle, de façon à ce que les soldats de notre cher pays, bénéficient éternellement de l’expérience et de la sagesse de ce vaillant officier, et qu’il demeure pour les nobles dames et princesses de la Cour, un chevalier servant.
Mais le protocole en vigueur à la Cour, ne permettait pas à la princesse d’adresser la parole à un soldat, fût-il le plus grand, le plus nobles des officiers du royaume. Aussi, eut-elle l’idée de lui rédiger une lettre dans laquelle elle emballa la pomme, et que le lendemain matin elle jeta par la fenêtre au moment précis où le Commandant passa sur son cheval. Il eut juste le temps de tendre le casque de bronze qu’il portait sous le bras, pour attraper le message et la pomme. Tout en poursuivant son chemin, il se mit à lire le billet de la princesse. Il dirigea sa monture vers un bosquet en grommelant :
- Ainsi, je devrais éternellement jouer au défenseur de la patrie et faire le joli cœur !... Hum... Ma parole, elle me prend pour un godelureau !... Voilà qui ne me plaît guère et qui me déçoit même de la part de notre princesse !
Irrité, il descendit de cheval et s’assit dans la mousse fraîche au pied d’un arbre. Sur ce, arriva la plus gentille et la plus gracieuse des servantes de la princesse. Elle cueillit une marguerite et se mit à lui arracher un à un les pétales en murmurant :
- Il m’aime... un peu... beaucoup... pas du tout...
- Oh! pensa le jeune Commandant de la Garde, la princesse est certes très jolie, mais pour moi elle est et restera un fruit interdit, tandis que cette simple servante n’est pas une forteresse imprenable, sans compter qu’elle est particulièrement charmante et gentille.
Et, se levant, il s’approcha de la jeune fille et lui dit :
- Belle jeune fille, il y a bien longtemps que j’ai l’intention de te parler. Tu as un corps de nymphe et un visage de petite fée, et je trouve qu’ils sont vraiment faits pour éblouir à jamais. C’est pourquoi je t’offre ce fruit. Si tu le manges, tu vivras éternellement, tout en demeurant jeune et belle.
- Je vous remercie, répondit poliment la jeune fille. Mais avant de mordre dans la pomme et d’exaucer votre vœu, je dois réfléchir. Laissez-moi, je vous prie, un délai de réflexion d’une semaine.
Et elle prit la pomme comme si c’eut été un objet de peu de valeur.

La jeune servante.
Le lendemain matin, alors qu’elle accomplissait son service, le roi et la reine se rendirent chez la princesse. Quand la soubrette se courba révérencieusement en deux devant les souverains, la pomme tomba de sa poche et roula jusqu’aux pieds du roi. Oubliant un instant sa dignité, le roi se baissa et ramassa la pomme.
- Qui t’a donné ce précieux fruit ? demanda-t-il en colère.
- Je l’ai reçu en cadeau, Votre Majesté, murmura la petite servante. Le Commandant de la Garde pour me témoigner son amour m’a fait don du fruit de l’immortalité.
- Original, très original ! grommela le roi. Je le croyais épris de ma fille !
- Père, intervint la princesse, pardonne à cet audacieux. Il est le meilleur et le plus vaillant de tes officiers et des guerriers de tous les pays loin à la ronde. Quel mal y a-t-il à ce qu’il souhaite prendre cette fille pour épouse ? Qu’il ne soit pas l’objet de ta colère.
- Mon enfant, rétorqua le roi, quand on est un homme de son rang et de sa classe, on a également des devoirs. Un homme libre ne peut épouser une esclave, et aucun de mes officiers une servante ! Mais je veux me montrer magnanime, puisque tu défends sa cause. Qu’il épouse, si tel est son désir, cette servante, mais alors qu’il soit banni à jamais de notre royaume.
- Mon métier, répondit l’élégant officier, ne consiste pas à débiter des fadeurs aux dames et demoiselles de la Cour. Je suis un soldat, pas un godelureau !
Et il rendit son épée au roi. Il quitta le pays et alla offrir ses services à un souverain étranger, à l’Empereur de Chine dit-on, qui le tenait en très haute estime. Épousa-t-il la belle soubrette ? Personne dans le royaume ne le sut, et l’histoire ne le révèle pas.
A peu de temps de là, la princesse épousa un grand prince. Le vieux couple royal prit la résolution de finir ses jours en paix, et transmit les pouvoirs à son gendre avant de se retirer de la vie publique.
Entourés d’un faste éblouissant, le roi et la reine quittèrent donc la capitale, pour aller s’installer définitivement dans leur résidence d’été. Et ce fut ainsi, qu’ils rencontrèrent Saad.
Revêtu de vêtements de soie brochée d’or, Saad se déplaçait dans une chaise à porteurs, portée par des esclaves noirs, non moins richement habillés. Lorsque les chaises à porteurs du roi et de Saad furent à la même hauteur, le souverain fit signe aux esclaves de s’arrêter. Il retira alors d’un sac de cuir, la pomme de la vie éternelle et interpella Saad.
- Saint homme, lui dit-il, toi qui m’apparaît aujourd’hui tout cousu d’or comme un grand seigneur, tiens, reprends le fruit de l’immortalité, car personne n’a voulu garder et consommer ce don de Dieu. On m’a rapporté que tu es devenu riche, très riche, que tu as soulagé bien des miséreux, et que tu as fait construire des palais et des temples accessibles aux hommes de toutes les races et de toutes les classes.
Saad ne répondit rien au roi. Il tendit la main vers la pomme pour la consommer avidement, lorsque Maya, sa femme, qui se reposait appuyée sur des coussins à côté de lui, lui dit :
- Sois honnête envers toi-même, Saad. Tu sais bien que dans ce vaste monde ici-bas, nous n’avons pas trouvé ce bonheur dont nous rêvions. Nous avons même perdu celui que nous avons connu jadis.
- Oui, reconnut Saad au plus profond de lui-même, mon âme a le mal du pays, de cette campagne que j’ai perdue par ta faute.
- Non, c’est toi le premier fautif cher époux, moi j’ai été éblouie par une vie plus facile, plus aisée, insensée que j’étais ! C’est pourquoi tu vas manger la moitié de la pomme. L’autre, tu la garderas et me la réserveras pour le moment où j’aurai mérité la vie éternelle, après m’être repentie.
- Ah non ! Loin de moi cette pensée ! Je veux attendre que nous soyons dignes tous les deux dignes de ce don de Dieu.
- Non, ce n’est pas la volonté de Dieu, protesta Maya. Par la merveilleuse providence, tu te retrouves à nouveau en possession de la pomme de la vie éternelle, et à présent, tu DOIS l’accepter.
Saad qui n’avait pas l’habitude de contredire sa femme, porta le fruit à ses lèvres. Mais, à ce moment précis, un porteur éternua, et à la suite de la secousse qu’il provoqua, la pomme s’échappa de la main de Saad et tomba à terre.
Un pauvre chien qui passait justement par-là, happa la pomme et l’avala. Il était bien trop affamé pour se demander s’il s’agissait ou non, d’un cadeau du ciel.
Et depuis lors, on dit en Orient, que le chien erre toujours, éternellement, de village en village, de ville en ville, pour rappeler aux hommes qu’ils ont refusé un jour le don de l’immortalité.
Sa réputation d'homme sage avait dépassé largement les frontières de son pays, et tout le monde s'accordait à l'estimer heureux, et à l'admirer.
Or un jour, Dieu à qui rien n'échappe, décida de récompenser Saad. Il lui envoya un messager qui se présenta devant notre sage, et lui remit avec ces paroles, une belle pomme rouge :
- Vois, le Dieu du Ciel m'envoie pour te remettre en récompense de tes bienfaits, ce précieux fruit. Si tu manges cette pomme, tu obtiendras la vie éternelle.
Modestement Saad répondit:
- Je ne suis pas digne d'un tel présent.
- N'oublie pas, répéta le messager du ciel, si tu manges cette pomme, tu devras vivre éternellement. Tu n'es pas seulement bon envers les hommes, mais encore plein de compassion pour les animaux de la forêt. Ta vie est digne de cet hommage.
Saad prit la pomme et la porta à ses lèvres lorsque sa femme l'appela :
- Pourquoi, se demanda-t-il soudain, ma femme ne devrait-elle pas partager avec moi ce cadeau divin, elle qui depuis tant d'années partage ma destinée, les instants heureux aussi bien que ceux qui le sont moins ?
Et il rejoignit Maya, lui raconta la visite du messager divin, lui rapporta ses paroles, et finalement, l'invita à consommer la pomme avec lui.
- Tu es fou ! rétorqua Maya. Crois-tu que j'ai envie de vivre éternellement, ici, au bord de cette sombre forêt ?
- Femme ! Interjeta le mari, ne blasphème pas !
- Te sens-tu capable de servir éternellement les dieux en même temps que les hommes que le hasard ou la volonté du ciel amènent ici ? demanda Maya. Veux-tu vraiment vivre perpétuellement à l'ombre de cette vaste forêt ?
- N'avons-nous pas été heureux à l'abri de ces hauts arbres ? répliqua Saad. Il y fait bon vivre. Là, le vent bruissant dans les cimes nous souffle à l'oreille bien des mystères et de doux secrets. Ici, loin de l'humanité haïssante et méprisable, on goûte la paix divine de la nature, et chaque lever de soleil nous redonne force et courage nouveaux. Mais voilà, seulement celui qui sait vivre sans s’abandonner au mal, est capable de passer sa vie dans la forêt.
- Je ne vois pas quel mal il y a à vivre avec d’autres hommes dans une ville, et encore moins quelles fautes on peut y commettre, grommela Maya. J’aimerais connaître d’autres mélodies que l’éternel gazouillis des oiseaux dans les branches. Je souhaiterais une meilleure nourriture que ces légumes fades, ces baies gorgées d’eau, et ces noix si dures que tu m’apportes chaque jour à la cuisine. Et puis, je voudrais dépenser de l’argent, avoir beaucoup d’amis autour de moi, aller au théâtre, visiter des palais, des temples... Car, vois-tu Saad, la symétrie des troncs de ces arbres géants m’effraie et commence même à m’étreindre le cœur. Je veux entendre des éclats de rire, des voix jeunes, des musiques... Ici, au pied des arbres, il n’y a rien de tout cela.
- Pauvre femme, songea à haute voix Saad. Ces grands bois dont l’auguste tranquillité t’effraie, tu les regretteras pourtant encore, et toute ta vie, je le crains. Moi, je ne connais pas de chant plus mélodieux que le gazouillis de l’oiseau, pas de meilleurs amis que les animaux, pas de palais ou de temple plus beau que cette haute, très haute forêt, avec ses fûts d’arbres polis et baignés de lueurs bleuâtres même en plein jour. Je n’ai jamais rien vu de plus éclatant, de plus noble que le lever et le coucher du soleil, que la lumière de la lune et des étoiles, ou encore, que le ruban scintillant du fleuve.
- Oh ! Je suis saturée de tout cela mon ami, répondit Maya, mais crois-moi, vends plutôt cette pomme pour une forte somme d’argent, de façon à ce que nous devenions riches et puissions encore bien profiter de notre vie.
- Mais alors, ce paysage, ce coin de terre que j’aime tant, je devrais l’abandonner ?
- Avec le prix que tu tireras de ce fruit qui donne la vie éternelle, tu pourras t’acheter les plus belles terres et faire construire des temples prestigieux que le peuple, quand il voudra prier Dieu, viendra visiter en pèlerinage. Mais au fait Saad, as-tu une preuve quelconque que cette pomme rouge, d’apparence ordinaire, donnera réellement la vie éternelle à celui qui la croquera ? J’ai des doutes. Mais laisse-le croire aux autres, et profite plutôt de la crédulité du premier venu pour lui demander un bon prix.


Saad et Maya.
Saad réfléchit.
- Que dois-je faire ? se demanda-t-il. J’aime ma femme, mais que sait-elle, la pauvre, de la Sagesse et de l’Ignorance ? Peut-être que mon premier devoir serait de la récompenser pour tout l’amour qu’elle m’a prodigué tout au long de ces nombreuses années écoulées, plutôt que de m’assurer une vie éternelle.
- Cette pomme vaut son pesant d’or, nous réaliserons notre fortune, s’écria Maya. Nous déménagerons dans une grande ville et coulerons des jours heureux. Mais nous ne demeurerons pas les seuls à bénéficier des bienfaits de la vente de cette pomme, car nous assurerons le pain à des milliers de malheureux. Ainsi, plutôt que de vivre indéfiniment ici-bas, sur cette terre de misère, nous nous achèterons une vie éternelle, mais au ciel !
- Tu as raison, dit le brave homme à sa femme.
Ils firent aussitôt leurs préparatifs de départ, et se mirent en route pour la ville la plus proche.
Pendant ce temps, le roi qui régnait alors sur le pays, avait quitté sa capitale pour gagner sa résidence d’été qui s’élevait précisément dans la ville vers laquelle marchaient Saad et Maya.
La réputation de sagesse de Saad était parvenue jusqu’aux oreilles du roi qui désirait vivement le rencontrer. Aussi, à peine fut-il arrivé dans son palais d’été, qu’il envoya ses gardes quérir Saad.
Les cavaliers envahirent la vieille cité. Le Commandant de la Garde coiffé d’un casque de bronze avait pris la tête du détachement.
- C’est bien Saad, le Sage que j’ai présentement devant mes yeux ? demanda-t-il. Le roi veut te voir.
Saad n’eut même pas le temps d’acquiescer que déjà les bras puissants du guerrier le soulevaient de terre, et que son cheval lancé au galop, les emportait par les places et les rues vers la résidence royale.

Les gardes.
Les murs du palais étaient de porcelaine. Dans la cour, Saad vit une armée de serviteurs s’affairer autour d’une centaine d’éléphants, de chameaux, de chevaux racés, tous harnachés de cuirs rutilants avec des selles de soie rouge et or sur le dos... Dans les jardins qui menaient au pavillon privé du roi, des paons, des hérons et des ibis lissaient leurs plumes avec de longs claquements de bec. Puis, les pas des gardes résonnèrent sur les degrés d’un escalier de jade qui menait à la grande salle du palais. Devant le trône, sur le sol parqueté d’écailles nacrées de coquillages où ses pieds nus et poussiéreux marquaient tous leurs pas, Saad se prosterna devant le souverain.
- Seigneur mon roi, dit-il, permet à ton humble serviteur de t’offrir la pomme de l’immortalité.
- La pomme de la vie éternelle ? S’enquit étonné le roi. Non, mon ami, je ne suis pas digne d’un tel cadeau. Mais tu peux, si tu veux, la laisser là. Mon trésorier t’en donnera cinquante bourses d’or.
Le soir vint, et le roi obsédé par l’histoire de la pomme, descendit dans son jardin où il se promena seul. Sur l’eau sombre du lac de son parc, et sur le ciel incandescent du couchant, des vols d’ibis roses apparurent entre les arbres en fleurs. Abîmé dans ses pensées profondes, il n’aperçut pas tout de suite la reine qui l’observait depuis la terrasse.
- Ah ! s’écria soudain le roi en la voyant, tu arrives au bon moment, viens ma douce compagne !
La reine descendit les degrés de l’escalier, et le roi pu contempler sa lourde chevelure noire empourprée d’une pivoine, et sa robe de soie couleur safran brodée de plumes de paon.
- Saad, le Sage de la forêt dont tu as déjà entendu parler, lui dit-il, m’a apporté la pomme de la vie éternelle. Tu dois manger cette pomme, car aucune autre femme n’est digne de ce cadeau divin. Je n’en connais point qui ait une voix aussi cristalline, qui soit aussi belle et noble que toi. Mange ce fruit de l’immortalité afin que ta beauté enchante éternellement le monde.
La reine sourit et se laissa tendrement embrasser sur le front par son époux. Elle prit ensuite la pomme et se retira dans ses appartements privés qu’elle arpenta toute la nuit. Au petit matin, après mûre réflexion, la dame conclut :
- Non, je ne mangerai pas la pomme de la vie éternelle. Je vais en faire cadeau à ma fillette, car elle est encore plus jeune et plus belle que moi. Et la reine fit mander la princesse.
- Mon enfant, lui dit la souveraine, un très grand bonheur t’échoit aujourd’hui. Vois, je t’offre la pomme de la vie éternelle.
- Oh chère maman, lui répondit la princesse, voilà certes un cadeau tout à fait exceptionnel que tu me fais là, mais je me trouve bien jeune et je dois me prouver à moi-même que je mérite ce fruit sacré.
Elle prit la pomme et se retira.
La reine la suivit du regard et sourit.
- Ainsi, songea-t-elle, la beauté pure, l’amabilité de cette toute jeune fille seront conservés à tout jamais à l’humanité.

La reine.
La princesse se rendit dans son pavillon aux murs tendus de soie dans les couleurs les plus tendres de l’eau, et tout dans ses appartements au bord du lac, brillait d’or et d’argent. Mais la princesse ne songeait nullement à la pomme. C’était le beau, l’élégant Commandant de la Garde de son père, qui occupait toutes ses pensées. Chaque matin, depuis sa fenêtre, elle le voyait traverser le parc.
- C’est lui qui doit recevoir la pomme de la vie éternelle se dit-elle, de façon à ce que les soldats de notre cher pays, bénéficient éternellement de l’expérience et de la sagesse de ce vaillant officier, et qu’il demeure pour les nobles dames et princesses de la Cour, un chevalier servant.
Mais le protocole en vigueur à la Cour, ne permettait pas à la princesse d’adresser la parole à un soldat, fût-il le plus grand, le plus nobles des officiers du royaume. Aussi, eut-elle l’idée de lui rédiger une lettre dans laquelle elle emballa la pomme, et que le lendemain matin elle jeta par la fenêtre au moment précis où le Commandant passa sur son cheval. Il eut juste le temps de tendre le casque de bronze qu’il portait sous le bras, pour attraper le message et la pomme. Tout en poursuivant son chemin, il se mit à lire le billet de la princesse. Il dirigea sa monture vers un bosquet en grommelant :
- Ainsi, je devrais éternellement jouer au défenseur de la patrie et faire le joli cœur !... Hum... Ma parole, elle me prend pour un godelureau !... Voilà qui ne me plaît guère et qui me déçoit même de la part de notre princesse !
Irrité, il descendit de cheval et s’assit dans la mousse fraîche au pied d’un arbre. Sur ce, arriva la plus gentille et la plus gracieuse des servantes de la princesse. Elle cueillit une marguerite et se mit à lui arracher un à un les pétales en murmurant :
- Il m’aime... un peu... beaucoup... pas du tout...
- Oh! pensa le jeune Commandant de la Garde, la princesse est certes très jolie, mais pour moi elle est et restera un fruit interdit, tandis que cette simple servante n’est pas une forteresse imprenable, sans compter qu’elle est particulièrement charmante et gentille.
Et, se levant, il s’approcha de la jeune fille et lui dit :
- Belle jeune fille, il y a bien longtemps que j’ai l’intention de te parler. Tu as un corps de nymphe et un visage de petite fée, et je trouve qu’ils sont vraiment faits pour éblouir à jamais. C’est pourquoi je t’offre ce fruit. Si tu le manges, tu vivras éternellement, tout en demeurant jeune et belle.
- Je vous remercie, répondit poliment la jeune fille. Mais avant de mordre dans la pomme et d’exaucer votre vœu, je dois réfléchir. Laissez-moi, je vous prie, un délai de réflexion d’une semaine.
Et elle prit la pomme comme si c’eut été un objet de peu de valeur.

La jeune servante.
Le lendemain matin, alors qu’elle accomplissait son service, le roi et la reine se rendirent chez la princesse. Quand la soubrette se courba révérencieusement en deux devant les souverains, la pomme tomba de sa poche et roula jusqu’aux pieds du roi. Oubliant un instant sa dignité, le roi se baissa et ramassa la pomme.
- Qui t’a donné ce précieux fruit ? demanda-t-il en colère.
- Je l’ai reçu en cadeau, Votre Majesté, murmura la petite servante. Le Commandant de la Garde pour me témoigner son amour m’a fait don du fruit de l’immortalité.
- Original, très original ! grommela le roi. Je le croyais épris de ma fille !
- Père, intervint la princesse, pardonne à cet audacieux. Il est le meilleur et le plus vaillant de tes officiers et des guerriers de tous les pays loin à la ronde. Quel mal y a-t-il à ce qu’il souhaite prendre cette fille pour épouse ? Qu’il ne soit pas l’objet de ta colère.
- Mon enfant, rétorqua le roi, quand on est un homme de son rang et de sa classe, on a également des devoirs. Un homme libre ne peut épouser une esclave, et aucun de mes officiers une servante ! Mais je veux me montrer magnanime, puisque tu défends sa cause. Qu’il épouse, si tel est son désir, cette servante, mais alors qu’il soit banni à jamais de notre royaume.
- Mon métier, répondit l’élégant officier, ne consiste pas à débiter des fadeurs aux dames et demoiselles de la Cour. Je suis un soldat, pas un godelureau !
Et il rendit son épée au roi. Il quitta le pays et alla offrir ses services à un souverain étranger, à l’Empereur de Chine dit-on, qui le tenait en très haute estime. Épousa-t-il la belle soubrette ? Personne dans le royaume ne le sut, et l’histoire ne le révèle pas.
A peu de temps de là, la princesse épousa un grand prince. Le vieux couple royal prit la résolution de finir ses jours en paix, et transmit les pouvoirs à son gendre avant de se retirer de la vie publique.
Entourés d’un faste éblouissant, le roi et la reine quittèrent donc la capitale, pour aller s’installer définitivement dans leur résidence d’été. Et ce fut ainsi, qu’ils rencontrèrent Saad.
Revêtu de vêtements de soie brochée d’or, Saad se déplaçait dans une chaise à porteurs, portée par des esclaves noirs, non moins richement habillés. Lorsque les chaises à porteurs du roi et de Saad furent à la même hauteur, le souverain fit signe aux esclaves de s’arrêter. Il retira alors d’un sac de cuir, la pomme de la vie éternelle et interpella Saad.
- Saint homme, lui dit-il, toi qui m’apparaît aujourd’hui tout cousu d’or comme un grand seigneur, tiens, reprends le fruit de l’immortalité, car personne n’a voulu garder et consommer ce don de Dieu. On m’a rapporté que tu es devenu riche, très riche, que tu as soulagé bien des miséreux, et que tu as fait construire des palais et des temples accessibles aux hommes de toutes les races et de toutes les classes.
Saad ne répondit rien au roi. Il tendit la main vers la pomme pour la consommer avidement, lorsque Maya, sa femme, qui se reposait appuyée sur des coussins à côté de lui, lui dit :
- Sois honnête envers toi-même, Saad. Tu sais bien que dans ce vaste monde ici-bas, nous n’avons pas trouvé ce bonheur dont nous rêvions. Nous avons même perdu celui que nous avons connu jadis.
- Oui, reconnut Saad au plus profond de lui-même, mon âme a le mal du pays, de cette campagne que j’ai perdue par ta faute.
- Non, c’est toi le premier fautif cher époux, moi j’ai été éblouie par une vie plus facile, plus aisée, insensée que j’étais ! C’est pourquoi tu vas manger la moitié de la pomme. L’autre, tu la garderas et me la réserveras pour le moment où j’aurai mérité la vie éternelle, après m’être repentie.
- Ah non ! Loin de moi cette pensée ! Je veux attendre que nous soyons dignes tous les deux dignes de ce don de Dieu.
- Non, ce n’est pas la volonté de Dieu, protesta Maya. Par la merveilleuse providence, tu te retrouves à nouveau en possession de la pomme de la vie éternelle, et à présent, tu DOIS l’accepter.
Saad qui n’avait pas l’habitude de contredire sa femme, porta le fruit à ses lèvres. Mais, à ce moment précis, un porteur éternua, et à la suite de la secousse qu’il provoqua, la pomme s’échappa de la main de Saad et tomba à terre.
Un pauvre chien qui passait justement par-là, happa la pomme et l’avala. Il était bien trop affamé pour se demander s’il s’agissait ou non, d’un cadeau du ciel.
Et depuis lors, on dit en Orient, que le chien erre toujours, éternellement, de village en village, de ville en ville, pour rappeler aux hommes qu’ils ont refusé un jour le don de l’immortalité.
Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:20, édité 4 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Le petit perce-neige
Le petit perce-neige
Il y a fort longtemps, à l'époque où la grande Amérique appartenait encore au peuple sage des Hommes Rouges, les Amérindiens, vivait une fille merveilleusement belle. Son père, le plus valeureux des guerriers de la tribu, lui avait donné le nom de Tchi-Tchi-Wata. La tribu voisine était placée sous l'autorité d'un grand chef réputé pour sa sagesse. Cet homme d'un âge respectable avait un fils, Tasolo, jeune et ardent guerrier. Si les deux tribus n'établissaient jamais leurs camps très loin l'un de l'autre, elles s'ignoraient mutuellement et depuis si longtemps qu'aucun de leurs membres ne se souvenait plus de la nature de l'outrage subi, outrage peut-être imaginaire !
Ce printemps-là, les deux tribus avaient dressé leurs campements dans une forêt de pins, non loin de la Rivière Rouge. Le vent courait dans le sommet des hauts pins, la neige des buissons refleuris embaumait l'air, et le soleil rayonnait partout : sur les pointes des flèches des Amérindiens, sur les jeunes pousses des arbres et sur l'eau sauvage de la rivière qui, avec des grondements sourds, se ruait au travers de grands et sombres rochers, pour se précipiter après une longue et folle course dans le puissant Mississippi.
Traversant la rivière dans son canoë, Tasolo, aperçut Tchi-Tchi-Wata allant puiser de l’eau. Leurs regards se rencontrèrent et les jours suivants, leurs yeux exprimèrent à chaque fois, le sentiment profond qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre. Mais, c’est à peine s’ils osèrent échanger deux mots en raison de la mauvaise entente qui régnait entre leurs deux tribus.
Tasolo supplia vainement son père, le grand chef, de l’autoriser à demander la main de Tchi-Tchi-Wata, et la jeune fille pria inutilement ses parents de lui permettre d’accepter les présents de Tasolo : des colliers et des pendeloques faits de dents de serpent, des corbeilles et des mocassins rehaussés de petites perles multicolores. Les anciens ne voulaient rien entendre. Et le soir, assis au coin du feu, Tasolo songeait avec tristesse que si Manitou, le Grand Esprit, Dieu des Amérindiens, ne tenait pas rancœur des fautes commises, les hommes, eux, ne voulaient rien pardonner.


Mais l’amour rend ingénieux et, Tasolo et Tchi-Tchi-Wata trouvèrent le moyen de se rencontrer à l’insu de tous. Dans l’ombre douce de la grande forêt illuminée d’un somnolent clair de lune, ils se jurèrent un amour éternel.
- Tasolo, mon bien-aimé, dit tristement Tchi-Tchi-Wata, ne me demande plus de venir te rejoindre dans la forêt, car je crains pour ta vie. Mon père m’a promise au meilleur jeune guerrier de ma tribu, et celui-ci te tuerait s’il apprenait que je t’ai rencontré en secret. Jamais, jamais plus, m’entends-tu, nous ne devrons nous revoir !
- Tu te méprends, chère Tchi-Tchi-Wata, répondit en souriant Tasolo. Tu veux dire : nous voulons toujours, et toujours nous revoir !
- Non, non ! supplia la jeune fille. Nous n’avons pas le droit. Tu sais bien que nous serions tous deux perdus si nos parents l’apprenaient. Mon père te ferait prisonnier ; il t’attacherait au poteau de torture et enverrait ton âme au pays des chasses éternelles.
- Ne t’inquiète donc pas, ma petite fleur ! dit Tasolo en passant la main sur la chevelure sombre de Tchi-Tchi-Wata. Vois, je t’ai apporté un talisman, une petite pipe magique. Elle a été ciselée dans une écume blanche et pure comme ton âme ; ne laisse jamais une étincelle l’atteindre, sinon elle tomberait en poussière.
Les mains dans les mains, ils se jurèrent à nouveau un amour éternel. Non loin de là, une vieille chouette les regardait de son œil rond, et il leur sembla que d’une voix humaine, elle répétait les paroles de Tasolo : « Je te jure amour et fidélité, ô Tchi-Tchi-Wata, par-delà la mort et par-delà le temps ».
- Ecoute-moi cela, chuchota Tasolo à l’oreille de sa bien-aimée. Vois, la chouette là-bas, celle qui a de si grands yeux, elle a répété mot pour mot le serment que je t’ai fait.

Alors au-dessus de leurs têtes, le vent se mit à bruire dans le faîte des arbres et, au firmament, les nuages s’étirèrent pour passer devant la lune et plonger la forêt dans l’obscurité, comme pour protéger de leur ombre les deux amoureux.
- Oh Tasolo ! soupira Tchi-Tchi-Wata, comme j’aimerais que nous puissions nous envoler très loin d’ici, pour commencer une meilleure vie loin de nos tribus et de nos wigwams où, chaque jour, ne nous apporte que de nouvelles peines.
-Tchi-Tchi-Wata, petite fleur des bords de la Rivière Rouge, j’ai une proposition à te faire. Nous allons creuser sous terre, une galerie qui ira de mon wigwam au tien.
- J’ai peur...
- L’amour ne connaît pas la peur, Tchi-Tchi-Wata. Suis mon conseil.
La jeune Indienne acquiesça en clignant doucement et tristement de ses paupières aux longs cils soyeux.
- Tu peux compter sur moi Tasolo, mais je ne te cacherai pas que j’ai un mauvais pressentiment.
Tasolo embrassa sa bien-aimée sur le front.
- Que de sombres pensées ! Je suis fort ! Lorsque sous la terre nous nous rencontrerons, je saisirai tes longues nattes, je me les enroulerai autour du cou, et te prendrai ainsi pour épouse, selon nos anciennes coutumes, et aucun esprit hostile, aucune force humaine ne pourra plus nous séparer.
Ils se quittèrent tendrement et Tchi-Tchi-Wata emporta le talisman de Tasolo en le serrant précieusement sur son cœur.
Les semaines suivantes, durant de nombreuses nuits, les deux jeunes gens travaillèrent au creusage du couloir qui devait relier leurs wigwams. Mais Tchi-Tchi Wata avait bien pressenti ce qui devait arriver. Les autres membres des deux tribus s’étant douté de quelque chose, se mirent à les surveiller étroitement en silence.
Le travail de Tasolo avançait rapidement et bientôt il fut tout près du wigwam de Tchi-Tchi-Wata. Lorsque dans les profondeurs de la terre ils se rencontrèrent, et qu’ensemble ils voulurent creuser une chambre, leur foyer, les autres membres des deux tribus obstruèrent les issues du couloir souterrain. Tasolo et Tchi-tchi-Wata ne devaient jamais plus en sortir.
Manitou, le Grand Esprit plein de compassion, fut pris de pitié pour le jeune couple. Il exauça son vœu. Il cueillit leurs jeunes âmes mais Il les sauva de la mort en leur frayant un chemin jusqu’à un wigwam tout là-haut sur la lune. Et, si avec foi, chère enfant, tu regardes son disque lumineux, tu apercevras et reconnaîtras peut-être, Tchi-Tchi-Wata et Tasolo.

Mais qu’est-il advenu de la pipe enchantée de Tasolo ? Tchi-Tchi-Wata l’a abandonnée derrière elle, lors de leur départ pour la lune. C’est dans ces forêts obscures et surtout très hautes où les fûts polis des arbres ressemblent à des piliers baignés de lueurs bleuâtres, que sur le sol, dans la mousse, tu pourras parfois voir briller entre deux troncs, fleur de songe éclose là, le talisman de Tasolo, le perce-neige.
Tchi-Tchi-Wata ne l’a pas vraiment oublié. Elle l’a plutôt laissé, afin qu’il rappelle aux hommes la face secrète de l’amour.
Si tu cueilles ce petit joyau du ciel, il ne périra pas comme te le diront les humains, car ce que ces derniers appellent « La Mort », Tasolo et Tchi-Tchi-Wata le nomment « La Vie », et eux le savent bien ! Car la vraie Vie, tout comme l’amour véritable, peut changer de forme, mais jamais ne mourra. Et, quelque part dans l’univers, il existe un royaume éternel, ensoleillé, où l’amour, renouvelle éternellement la Vie, sous quelle forme que ce soit.
Ce printemps-là, les deux tribus avaient dressé leurs campements dans une forêt de pins, non loin de la Rivière Rouge. Le vent courait dans le sommet des hauts pins, la neige des buissons refleuris embaumait l'air, et le soleil rayonnait partout : sur les pointes des flèches des Amérindiens, sur les jeunes pousses des arbres et sur l'eau sauvage de la rivière qui, avec des grondements sourds, se ruait au travers de grands et sombres rochers, pour se précipiter après une longue et folle course dans le puissant Mississippi.
Traversant la rivière dans son canoë, Tasolo, aperçut Tchi-Tchi-Wata allant puiser de l’eau. Leurs regards se rencontrèrent et les jours suivants, leurs yeux exprimèrent à chaque fois, le sentiment profond qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre. Mais, c’est à peine s’ils osèrent échanger deux mots en raison de la mauvaise entente qui régnait entre leurs deux tribus.
Tasolo supplia vainement son père, le grand chef, de l’autoriser à demander la main de Tchi-Tchi-Wata, et la jeune fille pria inutilement ses parents de lui permettre d’accepter les présents de Tasolo : des colliers et des pendeloques faits de dents de serpent, des corbeilles et des mocassins rehaussés de petites perles multicolores. Les anciens ne voulaient rien entendre. Et le soir, assis au coin du feu, Tasolo songeait avec tristesse que si Manitou, le Grand Esprit, Dieu des Amérindiens, ne tenait pas rancœur des fautes commises, les hommes, eux, ne voulaient rien pardonner.


Mais l’amour rend ingénieux et, Tasolo et Tchi-Tchi-Wata trouvèrent le moyen de se rencontrer à l’insu de tous. Dans l’ombre douce de la grande forêt illuminée d’un somnolent clair de lune, ils se jurèrent un amour éternel.
- Tasolo, mon bien-aimé, dit tristement Tchi-Tchi-Wata, ne me demande plus de venir te rejoindre dans la forêt, car je crains pour ta vie. Mon père m’a promise au meilleur jeune guerrier de ma tribu, et celui-ci te tuerait s’il apprenait que je t’ai rencontré en secret. Jamais, jamais plus, m’entends-tu, nous ne devrons nous revoir !
- Tu te méprends, chère Tchi-Tchi-Wata, répondit en souriant Tasolo. Tu veux dire : nous voulons toujours, et toujours nous revoir !
- Non, non ! supplia la jeune fille. Nous n’avons pas le droit. Tu sais bien que nous serions tous deux perdus si nos parents l’apprenaient. Mon père te ferait prisonnier ; il t’attacherait au poteau de torture et enverrait ton âme au pays des chasses éternelles.
- Ne t’inquiète donc pas, ma petite fleur ! dit Tasolo en passant la main sur la chevelure sombre de Tchi-Tchi-Wata. Vois, je t’ai apporté un talisman, une petite pipe magique. Elle a été ciselée dans une écume blanche et pure comme ton âme ; ne laisse jamais une étincelle l’atteindre, sinon elle tomberait en poussière.
Les mains dans les mains, ils se jurèrent à nouveau un amour éternel. Non loin de là, une vieille chouette les regardait de son œil rond, et il leur sembla que d’une voix humaine, elle répétait les paroles de Tasolo : « Je te jure amour et fidélité, ô Tchi-Tchi-Wata, par-delà la mort et par-delà le temps ».
- Ecoute-moi cela, chuchota Tasolo à l’oreille de sa bien-aimée. Vois, la chouette là-bas, celle qui a de si grands yeux, elle a répété mot pour mot le serment que je t’ai fait.

Alors au-dessus de leurs têtes, le vent se mit à bruire dans le faîte des arbres et, au firmament, les nuages s’étirèrent pour passer devant la lune et plonger la forêt dans l’obscurité, comme pour protéger de leur ombre les deux amoureux.
- Oh Tasolo ! soupira Tchi-Tchi-Wata, comme j’aimerais que nous puissions nous envoler très loin d’ici, pour commencer une meilleure vie loin de nos tribus et de nos wigwams où, chaque jour, ne nous apporte que de nouvelles peines.
-Tchi-Tchi-Wata, petite fleur des bords de la Rivière Rouge, j’ai une proposition à te faire. Nous allons creuser sous terre, une galerie qui ira de mon wigwam au tien.
- J’ai peur...
- L’amour ne connaît pas la peur, Tchi-Tchi-Wata. Suis mon conseil.
La jeune Indienne acquiesça en clignant doucement et tristement de ses paupières aux longs cils soyeux.
- Tu peux compter sur moi Tasolo, mais je ne te cacherai pas que j’ai un mauvais pressentiment.
Tasolo embrassa sa bien-aimée sur le front.
- Que de sombres pensées ! Je suis fort ! Lorsque sous la terre nous nous rencontrerons, je saisirai tes longues nattes, je me les enroulerai autour du cou, et te prendrai ainsi pour épouse, selon nos anciennes coutumes, et aucun esprit hostile, aucune force humaine ne pourra plus nous séparer.
Ils se quittèrent tendrement et Tchi-Tchi-Wata emporta le talisman de Tasolo en le serrant précieusement sur son cœur.
Les semaines suivantes, durant de nombreuses nuits, les deux jeunes gens travaillèrent au creusage du couloir qui devait relier leurs wigwams. Mais Tchi-Tchi Wata avait bien pressenti ce qui devait arriver. Les autres membres des deux tribus s’étant douté de quelque chose, se mirent à les surveiller étroitement en silence.
Le travail de Tasolo avançait rapidement et bientôt il fut tout près du wigwam de Tchi-Tchi-Wata. Lorsque dans les profondeurs de la terre ils se rencontrèrent, et qu’ensemble ils voulurent creuser une chambre, leur foyer, les autres membres des deux tribus obstruèrent les issues du couloir souterrain. Tasolo et Tchi-tchi-Wata ne devaient jamais plus en sortir.
Manitou, le Grand Esprit plein de compassion, fut pris de pitié pour le jeune couple. Il exauça son vœu. Il cueillit leurs jeunes âmes mais Il les sauva de la mort en leur frayant un chemin jusqu’à un wigwam tout là-haut sur la lune. Et, si avec foi, chère enfant, tu regardes son disque lumineux, tu apercevras et reconnaîtras peut-être, Tchi-Tchi-Wata et Tasolo.

Mais qu’est-il advenu de la pipe enchantée de Tasolo ? Tchi-Tchi-Wata l’a abandonnée derrière elle, lors de leur départ pour la lune. C’est dans ces forêts obscures et surtout très hautes où les fûts polis des arbres ressemblent à des piliers baignés de lueurs bleuâtres, que sur le sol, dans la mousse, tu pourras parfois voir briller entre deux troncs, fleur de songe éclose là, le talisman de Tasolo, le perce-neige.
Tchi-Tchi-Wata ne l’a pas vraiment oublié. Elle l’a plutôt laissé, afin qu’il rappelle aux hommes la face secrète de l’amour.
Si tu cueilles ce petit joyau du ciel, il ne périra pas comme te le diront les humains, car ce que ces derniers appellent « La Mort », Tasolo et Tchi-Tchi-Wata le nomment « La Vie », et eux le savent bien ! Car la vraie Vie, tout comme l’amour véritable, peut changer de forme, mais jamais ne mourra. Et, quelque part dans l’univers, il existe un royaume éternel, ensoleillé, où l’amour, renouvelle éternellement la Vie, sous quelle forme que ce soit.
Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:23, édité 2 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Le Sabot de Vénus
Le Sabot de Vénus
Le marquis Jasmin ainsi nommé en raison de ses chevaux blancs et des pourpoints de velours invariablement verts qu'il portait, était issu d'une famille de vieille noblesse qui fournit des Templiers au temps des Croisades. Sa mère avait laissé les moines présider à son éducation et ils avaient élevé l'enfant durement, dans la haine de l'amour et de la femme. Plus tard, lorsque les portes du cloître s'étaient ouvertes devant lui, les filles des seigneurs voisins se mirent à le saluer familièrement par son prénom et à l'envelopper de leur ronde légère quand elles le rencontraient. Par leur attitude, leurs regards, leurs voix, elles tentaient de le retenir. Mais le jeune marquis baissait la tête sans trouver une parole. Devant les écuries de son palais, les filles des palefreniers le voyant arriver couraient vers lui pour enguirlander de fleurs la bride de son cheval. Comme le marquis n'articulait jamais une parole, les demoiselles comprenaient vite. Grand chevaucheur, il aimait parcourir la campagne. Sur le seuil des fermes, de robustes filles vêtues de bure riaient et filaient la quenouille. A son approche elles rentraient précipitamment pour ressortir avec une cruche de vin, mais le jeune seigneur demeurait volontairement sourd à leur appel. Le front sombre, il songeait à ces pièges et à ces illusions dont lui avaient parlé les moines.
Il était âgé de cinquante ans, quand il tomba follement amoureux d'une jeune fille de vingt ans, d'une fragile beauté. Née à Florence, elle menait une existence oisive. Eprise de sa délicate petite personne, elle se plaisait à relever sa robe pour admirer ses jolis pieds qui lui inspiraient un respect infini. Elle aimait la musique et la danse, et ce furent des maîtres de Venise qui lui apprirent à régler ses pas. Dès lors, on ne la vit plus que chaussée de minuscules pantoufles de satin rose et marcher à très petits pas, aussi la surnomma-t-on Mademoiselle Trotte-Menu.

Sur le pays régnait alors un roi guerrier chargé d'années. Le soir, son vaste palais n'était empli que du pas cadencé de ses gardes, du cliquetis de leurs épées et des coupes brisées dans leurs longues veillées d'armes. Pour éviter de sombrer, dès la tombée du jour, dans la morne songerie des regrets et des rêves du passé, le vieux seigneur fit venir des musiciens et organiser des comédies et des ballets.
Aucune ballerine du royaume ne pouvait se vanter d'avoir la taille aussi souple que Mademoiselle Trotte-Menu. Elle dansait tel un rayon de lune sur l'eau miroitante d'un lac, et quand elle se produisait devant le roi et sa Cour, on eut dit un elfe ; toute la salle la buvait des yeux et le Marquis Jasmin était subjugué.
 Par une belle soirée de mai, alors que le soleil avait déjà disparu derrière les cimes violettes des arbres, et que la lune émergée d'un petit bois baignait d'argent la demeure de Mademoiselle Trotte-Menu, le Marquis Jasmin se glissa sous une de ses fenêtres. Et là, en extase, il donna une tendre sérénade à la jeune fille aimée. S'étant approchée d'une fenêtre, Mademoiselle Trotte- Menu aperçut le marquis, mais elle ne s'intéressait guère à ce seigneur aux cheveux déjà blancs. Seule sa bourse de velours jaune toujours bien garnie pouvait, peut-être, avoir quelque attrait, car le marquis était l'homme le plus riche du royaume.
Par une belle soirée de mai, alors que le soleil avait déjà disparu derrière les cimes violettes des arbres, et que la lune émergée d'un petit bois baignait d'argent la demeure de Mademoiselle Trotte-Menu, le Marquis Jasmin se glissa sous une de ses fenêtres. Et là, en extase, il donna une tendre sérénade à la jeune fille aimée. S'étant approchée d'une fenêtre, Mademoiselle Trotte- Menu aperçut le marquis, mais elle ne s'intéressait guère à ce seigneur aux cheveux déjà blancs. Seule sa bourse de velours jaune toujours bien garnie pouvait, peut-être, avoir quelque attrait, car le marquis était l'homme le plus riche du royaume.

La nuit suivante, de douces sonorités amenèrent Mademoiselle Trotte-Menu à sa fenêtre. Le marquis était là. Rythmant sur une mandoline une langoureuse chanson, il exhalait des paroles passionnées :
Ecartant de ses bras blancs les rideaux de soie de sa fenêtre, Mademoiselle Trotte-Menu d'une voix cristalline répondit au marquis :
- Bien sûr que la nuit est opportune et l'astre ardent, et que dans le parc la clématite et le jasmin ont fleuri. Mais je suis l'amour et la jeunesse et celui qui me passera la bague au doigt, sera non seulement noble mais encore jeune ! Me chanter des madrigaux ne suffit pas, Marquis !
Tristement, le marquis s'en alla. Mais le lendemain soir il se retrouva presque inconsciemment, sous la fenêtre ouverte de Mademoiselle Trotte-Menu, et cette fois il lui jeta une merveilleuse rose rouge dans la chambre. La jeune fille ferma la fenêtre avec de grands éclats de rire.
Le marquis était tellement épris de Mademoiselle Trotte-Menu qu'il s'imagina qu'elle jouait seulement la coquette dans le but d'aviver sa flamme. Et le soir suivant, il revint sous la fenêtre. Mais cette fois, il s'était muni d'une somptueuse parure de perles et d'un grand nombre de bourses de velours jaunes remplies de pièces d'or. Par la fenêtre ouverte, un rayon de lune pénétrait dans la chambre de l'être aimé et dansait sur le parquet poli. La mandoline du marquis soupira et sa voix tendre se fit plus implorante et persuasive que jamais.
Sur ces paroles, il lança le splendide collier de perles et quelques-unes de ses bourses remplies d'or dans la chambre de la jeune fille. La belle se fâcha. Tirant les rideaux de sa fenêtre, elle cria d'une voix courroucée :
- Marquis ! Je ne vous trouve pas très drôle ce que vous avez fait là. Comment osez-vous, à l'âge que vous avez, m'offrir des perles et de l'or ? Vous n'êtes qu'un vieil homme qui, devrait enfin devenir raisonnable et laisser le plaisir des sérénades et de l'amour aux plus jeunes.
- Excusez-moi Mademoiselle, dit le marquis, je vous jure que je suis sincère. Vous ne pouvez savoir combien j'aurais été aimant, et combien agréable et douce aurait été votre vie à mes côtés...
- Mais combien d'années espérez-vous donc vivre, marquis ? répliqua la jeune fille. Croyez-vous que je vais consacrer ma jeunesse et ma beauté à un vieillard ? Merci !
Le visage pâle, le regard doux et brûlant, le marquis demanda d'une voix résignée :
- Oh, Mademoiselle, Muse de la Danse, vendez-moi une paire de vos pantoufles roses afin que je puisse les embrasser et les presser sur mon cœur !
- Comment ? Vous voulez que je vous cède une paire de mes chaussons de danse ?... Non, marquis ! Jamais, je ne ferai chose semblable ! Mais si vous y tenez vraiment, je vous ferai quand même cadeau d'une paire, mais je vous en prie - gardez votre or et allez-vous en !
Et la jeune fille jeta par la fenêtre toute une série de pantoufles de satin rose. Profondément troublé, le vieux seigneur ramassa les chaussons et rentra chez lui. Mademoiselle Trotte-Menu le suivit quelques instants du regard. Ses cheveux gris argentés, son visage résigné et fier, résumaient la lumière atténuée des belles années qui avaient fui, sans retour, et le souvenir de leur douceur enveloppante.
Le marquis comprit trop tard qu'il avait couru une impossible aventure et qu'il aurait dû vivre sans dédaigner l'amour... Et qu'à présent, il ne fallait plus songer au passé...
Dans le parc de son vieux palais, le marquis enterra les chaussons de satin rose, et à leur côté, déposa ses bourses d'or. Alors il rentra, se coucha et mourut. Bien plus tard, à l'endroit où il avait enfoui les pantoufles et les bourses, poussa une plante que l'on appela le Sabot de Vénus. Les pétales de ses fleurs sont de couleur rose comme les chaussons de Mademoiselle Trotte-Menu, et le grand labelle jaune rappelle par sa forme, la bourse du marquis. Vers la fin de la floraison, lorsque les pièces d'or du vieux seigneur se sont transformées en belles graines brunes, leur enveloppe - le labelle - se déchire pour les jeter sur le sol, et l'année suivante, de chacune de ces graines naît un nouveau Sabot de Vénus.

Il était âgé de cinquante ans, quand il tomba follement amoureux d'une jeune fille de vingt ans, d'une fragile beauté. Née à Florence, elle menait une existence oisive. Eprise de sa délicate petite personne, elle se plaisait à relever sa robe pour admirer ses jolis pieds qui lui inspiraient un respect infini. Elle aimait la musique et la danse, et ce furent des maîtres de Venise qui lui apprirent à régler ses pas. Dès lors, on ne la vit plus que chaussée de minuscules pantoufles de satin rose et marcher à très petits pas, aussi la surnomma-t-on Mademoiselle Trotte-Menu.

Sur le pays régnait alors un roi guerrier chargé d'années. Le soir, son vaste palais n'était empli que du pas cadencé de ses gardes, du cliquetis de leurs épées et des coupes brisées dans leurs longues veillées d'armes. Pour éviter de sombrer, dès la tombée du jour, dans la morne songerie des regrets et des rêves du passé, le vieux seigneur fit venir des musiciens et organiser des comédies et des ballets.
Aucune ballerine du royaume ne pouvait se vanter d'avoir la taille aussi souple que Mademoiselle Trotte-Menu. Elle dansait tel un rayon de lune sur l'eau miroitante d'un lac, et quand elle se produisait devant le roi et sa Cour, on eut dit un elfe ; toute la salle la buvait des yeux et le Marquis Jasmin était subjugué.


La nuit suivante, de douces sonorités amenèrent Mademoiselle Trotte-Menu à sa fenêtre. Le marquis était là. Rythmant sur une mandoline une langoureuse chanson, il exhalait des paroles passionnées :
"Mes cheveux sont blancs mais mon cœur est brûlant.
La nuit est opportune et l'astre ardent,
Dans le parc la clématite et le jasmin ont fleuri,
A l'ombre bleue des cyprès laisse, puisqu'il t'en prie,
Ton seigneur près de toi se pâmer d'émoi."
La nuit est opportune et l'astre ardent,
Dans le parc la clématite et le jasmin ont fleuri,
A l'ombre bleue des cyprès laisse, puisqu'il t'en prie,
Ton seigneur près de toi se pâmer d'émoi."
Ecartant de ses bras blancs les rideaux de soie de sa fenêtre, Mademoiselle Trotte-Menu d'une voix cristalline répondit au marquis :
- Bien sûr que la nuit est opportune et l'astre ardent, et que dans le parc la clématite et le jasmin ont fleuri. Mais je suis l'amour et la jeunesse et celui qui me passera la bague au doigt, sera non seulement noble mais encore jeune ! Me chanter des madrigaux ne suffit pas, Marquis !
Tristement, le marquis s'en alla. Mais le lendemain soir il se retrouva presque inconsciemment, sous la fenêtre ouverte de Mademoiselle Trotte-Menu, et cette fois il lui jeta une merveilleuse rose rouge dans la chambre. La jeune fille ferma la fenêtre avec de grands éclats de rire.
Le marquis était tellement épris de Mademoiselle Trotte-Menu qu'il s'imagina qu'elle jouait seulement la coquette dans le but d'aviver sa flamme. Et le soir suivant, il revint sous la fenêtre. Mais cette fois, il s'était muni d'une somptueuse parure de perles et d'un grand nombre de bourses de velours jaunes remplies de pièces d'or. Par la fenêtre ouverte, un rayon de lune pénétrait dans la chambre de l'être aimé et dansait sur le parquet poli. La mandoline du marquis soupira et sa voix tendre se fit plus implorante et persuasive que jamais.
"Oh laisse ton seigneur t'aimer.
Laisse-le d'or et de perles parer
Ton front de nacre et tes blonds cheveux
Et viens écouter ses tendres aveux."
Laisse-le d'or et de perles parer
Ton front de nacre et tes blonds cheveux
Et viens écouter ses tendres aveux."
Sur ces paroles, il lança le splendide collier de perles et quelques-unes de ses bourses remplies d'or dans la chambre de la jeune fille. La belle se fâcha. Tirant les rideaux de sa fenêtre, elle cria d'une voix courroucée :
- Marquis ! Je ne vous trouve pas très drôle ce que vous avez fait là. Comment osez-vous, à l'âge que vous avez, m'offrir des perles et de l'or ? Vous n'êtes qu'un vieil homme qui, devrait enfin devenir raisonnable et laisser le plaisir des sérénades et de l'amour aux plus jeunes.
- Excusez-moi Mademoiselle, dit le marquis, je vous jure que je suis sincère. Vous ne pouvez savoir combien j'aurais été aimant, et combien agréable et douce aurait été votre vie à mes côtés...
- Mais combien d'années espérez-vous donc vivre, marquis ? répliqua la jeune fille. Croyez-vous que je vais consacrer ma jeunesse et ma beauté à un vieillard ? Merci !
Le visage pâle, le regard doux et brûlant, le marquis demanda d'une voix résignée :
- Oh, Mademoiselle, Muse de la Danse, vendez-moi une paire de vos pantoufles roses afin que je puisse les embrasser et les presser sur mon cœur !
- Comment ? Vous voulez que je vous cède une paire de mes chaussons de danse ?... Non, marquis ! Jamais, je ne ferai chose semblable ! Mais si vous y tenez vraiment, je vous ferai quand même cadeau d'une paire, mais je vous en prie - gardez votre or et allez-vous en !
Et la jeune fille jeta par la fenêtre toute une série de pantoufles de satin rose. Profondément troublé, le vieux seigneur ramassa les chaussons et rentra chez lui. Mademoiselle Trotte-Menu le suivit quelques instants du regard. Ses cheveux gris argentés, son visage résigné et fier, résumaient la lumière atténuée des belles années qui avaient fui, sans retour, et le souvenir de leur douceur enveloppante.
Le marquis comprit trop tard qu'il avait couru une impossible aventure et qu'il aurait dû vivre sans dédaigner l'amour... Et qu'à présent, il ne fallait plus songer au passé...
Dans le parc de son vieux palais, le marquis enterra les chaussons de satin rose, et à leur côté, déposa ses bourses d'or. Alors il rentra, se coucha et mourut. Bien plus tard, à l'endroit où il avait enfoui les pantoufles et les bourses, poussa une plante que l'on appela le Sabot de Vénus. Les pétales de ses fleurs sont de couleur rose comme les chaussons de Mademoiselle Trotte-Menu, et le grand labelle jaune rappelle par sa forme, la bourse du marquis. Vers la fin de la floraison, lorsque les pièces d'or du vieux seigneur se sont transformées en belles graines brunes, leur enveloppe - le labelle - se déchire pour les jeter sur le sol, et l'année suivante, de chacune de ces graines naît un nouveau Sabot de Vénus.

Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:28, édité 5 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Le Lys blanc
Le Lys blanc
On raconte qu'autrefois, un seigneur vieilli et rassasié de gloire, s'était établi en maître en Normandie. Le noble homme avait une jeune épouse fort aimée des pauvres gens qu'elle ne laissait jamais manquer de pain, de vêtements chauds ni de sabots. Mais quelle fut leur douleur quand peu de temps plus tard la bonne dame trépassa.

Le vieux seigneur avait un fils unique. Son visage rappelait la grande beauté de sa mère, brune aux yeux bleus de lin. Son père aurait désiré le marier à une jeune fille de bon lieu, mais il ne fallait pas songer à lui passer l'anneau nuptial. Affligé par la disparition précoce et brutale de sa mère, il n'éprouvait que mépris pour les prétendantes. Bien des jeunes filles passaient sous les hautes murailles du château dans l'espoir que le regard du jeune homme s'arrêterait sur elles, ne serait-ce qu'avec une ombre de complaisance. Mais toutes étaient pour lui comme galets sur la grève.
Jour après jour on le vit s'agenouiller sur la tombe de sa mère et cela brisait le cœur de l'écouter passer des soupirs aux pleurs et des larmes aux lamentations.
Alors le vieux père alla trouver le chapelain et le pria de garder son fils dans sa cellule pendant le temps qu'il lui faudrait pour revenir à la raison.
Le jeune homme commença par se courroucer contre cette décision. Et puis, comme le gros et plaintif moine ne l'importunait guère, il pensa qu'il était plus sage de le suivre aux matines et de servir la messe.
Le printemps arriva. Certains jours la mer était si douce et la lande si belle sous le soleil qu'il en perdait le fil de ses prières et la méditation de la mort finit par lui peser.
Il n'avait pas le cœur à se divertir mais il désira quitter le château familial pour aller au loin, gagner la gloire dans les combats, comme c'était le devoir d'un chevalier.
Après avoir passé sa veillée d'armes dans la chapelle du château, il avait gagné la campagne, ganté et cuirassé, avec sur son écu l'éclair sombre d'une panthère dressée sur ses pattes arrières, l'emblème de sa famille.

C'était un jour de mauvais temps. L'océan avait un air spectral. La brume y était plus épaisse que l'écume du ressac et la lune plus livide que la chair des morts. Le jeune aventurier laissa derrière lui les grèves sonores et les hautes falaises pour piquer droit à travers une campagne de vergers et de pâturages coupés de haies d'aubépine. Perdu dans ses pensées, il chevauchait déjà depuis de longues heures sur un chemin creux quand une très belle jeune fille lui apparut.
Le chevalier s'était arrêté ébloui. Elle se tenait assise sur un banc de marbre blanc dominé par une stèle et flanqué de chaque côté d'un cyprès. Derrière elle, sur un ciel bleu pâle balayé de nuages, s'ouvrait un jardin aux allées symétriques bordées de buis et de lauriers, puis de cyprès et de pins qui menaient à une place dallée de marbre avec en son centre une fontaine ornée de figures de bronze.

Les elfes, disait-on, avaient coutume d'apparaître ainsi, à la fin du jour, aux voyageurs fatigués. Aussi, redoutant quelque piège, se signa-t-il dévotement trois fois. Il voulut réciter en latin un "Pater", mais la jeune fille le regardait intensément. Elle était si belle et si pleine de sortilèges qu'il s'arrêta de respirer. Ses cheveux d'un blond très pâle, couronnés d'un étroit bandeau de perles rouges, flottaient sur ses épaules d'une blancheur d'hostie. Une longue robe d'une étoffe si légère qu'on l'eût crue tissée par les elfes, d'un bleu argenté flottant sur les reins la moulait à la taille. A son cou et à ses bras, des rubis scintillaient limpides et chauds. Chaussés d'escarpins de satin rouge, ses pieds reposaient sur un coussin de fleurs d'une blancheur immaculée.
Subjugué par tant de beauté, le jeune chevalier instinctivement descendit de cheval, mit un genou en terre et baisa les longues mains délicates.
- Princesse de rêve, je te salue ! lui dit-il.
Elle posa sur lui ses yeux d'un azur enivrant et lui répondit :
- Je te souhaite la bienvenue, noble chevalier !
- Vois-tu, ma gracieuse princesse, poursuivit le gentilhomme, j'avais acquis la conviction qu'il n'existait aucune femme aussi aimante, bienveillante et noble que ma défunte mère. Mais à présent que j'ai devant moi son vivant portrait, j'ai le sentiment que des hauteurs célestes elle répand sa bénédiction sur nous. Princesse ou elfe, je t'en prie, laisse-moi te prendre en croupe et mène-moi à ton père afin que je lui demande ta main.
La blonde jeune fille passa ses bras au cou du chevalier qui l'asseyait sur son destrier.
Tournant le dos au splendide portique, ils chevauchèrent vers le château qui érigeait sa masse crénelée et flanquée de hautes tours derrière les cyprès. Les doux rayons du crépuscule faisaient resplendir les briques des créneaux, les toits d'ardoise des donjons et l'or des oriflammes de soie pourpre qui ondulaient au sommet des poivrières. Voici le château de mon auguste père, dit la princesse d'une voix claire et mélodieuse, car il faut que tu saches que malheureusement j'ai perdu ma mère.
Sous sa lourde couronne d'or, son long manteau bordé d'hermine et sa barbe blanche, c'était le roi le plus majestueux que le jeune chevalier eût rencontré. Le vieux seigneur lui réserva bon accueil car il reconnut dans le gentilhomme le fils de son meilleur ami parti au loin depuis d'innombrables années. Le jeune homme obtint sans peine la main de sa fille.

Les noces furent célébrées avec un déploiement de faste. Elles durèrent trois jours, au bout desquels le chevalier dit à sa jeune épouse :
- Mon père est un riche seigneur de haute lignée mais le poids des ans l'a rendu ombrageux et insupportable. Aussi, n'irons-nous pas nous établir chez lui, mais dans un château situé à la pointe d'une très belle anse de sable où le bleu du ciel se confond avec le bleu de la mer et le bleu vert de la mer avec le vert des prairies qui s'étendent à perte de vue au pied des murailles.
- Je te suis volontiers, répondit la jeune femme, mais il faut que tu me promettes que jamais tu ne parleras de plantes toxiques et de mort. Je n'étais alors qu'une toute petite fille lorsque j'entendis ma nourrice dire à une servante : "Pauvre petite princesse. Sa mère a été tuée par des plantes toxiques." Et depuis lors, je les crains et tremble à l'idée que le même sort pourrait m'être réservé.
Le chevalier le va la main droite et jura :
- Sur notre amour éternel, je te jure que jamais par-devant moi je ne parlerai de plantes toxiques ou de mort.
Ils quittèrent le palais royal l'après-midi même, voyageant sans suite et sans écuyer.
Montés sur le même cheval, ils chevauchaient sur un chemin de campagne à l'ombre haute des blés sous le regard profond des fleurs éveillées soudain. Une forêt obscure au sol baigné d'ombres bleuâtres en fermait l'horizon.
Le calme de cette forêt n'était qu'apparent. Des animaux sauvages la sillonnaient dans tous les sens dans de grands bruits de branches cassées ; d'autres combattaient avec une fureur telle que les oiseaux dans les nids s'en effaraient. Des croassements lugubres de corneilles retentirent à travers la forêt faisant dresser l'oreille à la princesse. Puis, ce furent des clameurs de détresse éclatant sporadiquement et vite étouffées qui la remplir d'horreur. Etait-ce bien la sempiternelle querelle des corneilles qui reprenait plus bruyante à chaque fois et qui à la longue l'angoissait ? Ou n'était-ce pas plutôt des commérages de sorcières ?
Elle le sentait bien maintenant. La forêt était sous le charme d'un magicien ; cette atmosphère moite et toutes ces ailes noires qui enténébraient la forêt et le ciel blanc étaient ensorcelées. La princesse se serra craintivement entre les bras de son protecteur.
A la lisière de la forêt, une inquiétante végétation avait jailli du sol ; le chemin en était envahi de toute part. C'étaient des ronces, des grandes ciguës, des digitales pourpres, des jusquiames noires, des stramoines, et toutes s'enchevêtraient, s'étreignaient, envahissaient la mousse et l'herbe.

Le cheval noir refusa d'aller plus avant. Le chevalier le poussa mais il refusa d'obéir et se cabra.
- Hélas ! gémit la princesse, cette haie infranchissable est l'oeuvre de mon terrible oncle !
- Ton terrible oncle ?
- Il en est ainsi, cher époux. Vois-tu, je suis l'unique enfant de mes parents et la légitime héritière du trône. Le frère de mon père en veut à ma vie, afin que sa fille, laide et que l'amour dédaigne, puisse obtenir la couronne royale et ensuite, grâce à sa puissance et à son autorité, un époux.
- L'amour se gagne uniquement par l'amour, non par la richesse et encore moins par la force, répondit le chevalier.
- Ce ne sera pas un gentilhomme qui demandera la main de ma cousine, soupira la princesse, car elle est égoïste, jalouse, d'une humeur exécrable et ne cherche toujours que son propre avantage. Aussi, le bonheur lui file-t-il comme du sable entre les doigts.
- Ne crains rien, dit le chevalier, du tranchant de mon glaive je vais déchirer ce rideau de plantes maléfiques !
Mettant pied à terre, il leva son épée et sous son vol les plantes toxiques se couchaient par gerbes.
Ils poursuivirent leur chemin. Le ciel devint pesant et le cheval, la bouche sèche, se traînait plus qu'il ne marchait. Passant devant une falaise schisteuse, le gentilhomme aperçut l'eau d'une source couler par une faille. Il relâcha la bride pour laisser l'animal se désaltérer.

Le destrier tendit le cou vers l'eau mais recula aussitôt apeuré, car un bruit sifflant s'était fait entendre à l'intérieur du rocher et l'eau se couvrit aussitôt d'écume verte.
La princesse horrifiée passa les bras au cou de son époux et le supplia de quitter immédiatement les lieux.
- Calme-toi, ma chérie, dit-il, nous serons bientôt arrivés chez nous, dans notre château où, derrière ses murs puissants, tu seras à l'abri de tous les maux !
A peine eut-il prononcé ces paroles que tout deux furent saisis de voir surgir brusquement de son antre un dragon monstrueux. Son haleine puante empoisonnait l'herbe tout autour de lui, et sa langue fourchue dardait menaçante.
Blême d'épouvante, la princesse s'évanouit et le chevalier n'eut que le temps de la retenir de son bras gauche et de saisir la lance de la main droite pour transpercer le cou de la terrible bête. Un sang épais et noir éclaboussa le sol. Mortellement atteint, le monstre s'affaissa.

Le reste du voyage s'effectua sans encombre.
Comme leurs caractères s'accordaient et qu'ils s'aimaient, les semaines et les mois passaient vite au château. Toutefois, le chevalier avait le pressentiment que son bonheur était bien trop grand pour durer longtemps.
On était alors en plein été et de longues plates-bandes de lys blancs embaumaient l'air du jardin. Voyant son époux tourmenté par de sombres pensées et connaissant le pouvoir de guérison des fleurs, elle descendit dans le jardin. Elle en cueillit quelques-unes qu'elle alla poser sur le front du chevalier. Alors les elfes écartèrent ses mauvais rêves, les kobolds ses pensées tristes, et ses larmes tarirent comme les gouttes de rosée que le soleil aspire dans les calices des fleurs.


Le méchant oncle de la princesse ne desserrait plus les dents de rage. Il était convaincu que le chevalier normand n'avait épousé la fille du roi que pour ses droits successoraux. Aussi ne songeait-il plus qu'à l'écarter du trône. En la supprimant, il ferait de sa propre fille l'héritière légitime.
A la cour du roi officiait un maître de cérémonie. Avare, avide et sans scrupules, il était l'homme parfait pour exécuter les funestes projets de l'oncle.
L'occasion se présenta lorsque le roi rendit visite à sa fille. Une grande fête en son honneur était prévue au château. L'oncle compta alors dix mille écus d'or au maître de cérémonie qui accepta de dissimuler des plantes toxiques sous la table de fête et de faire chanter par des troubadours une chanson évoquant la mort.
Au château le roi fut reçu avec tous les honneurs qui lui étaient dus. Il y avait force concours de musiciens et vers le milieu du fastueux banquet un étrange troubadour fit son entrée. Il était sanglé dans un étroit justaucorps de velours noir et ses yeux sombres cachés sous d'épais sourcils brillaient d'un éclat étrange, presque menaçant, tandis que l'espace d'un instant sa lèvre supérieure se retroussait en un rictus. Il se courba révérencieusement devant la princesse et entonna une chanson :
Il s'en suivit une terrible agitation. Tirant son épée du fourreau, le chevalier se jeta sur l'infâme chanteur et l'abattit avec ses paroles : "Tiens ! Te voici payé pour ton chant diabolique."
La princesse s'était affaissée sans connaissance. Ses chambrières se précipitèrent à son secours.
Quand le chevalier prit son épouse dans ses bras, son doux corps léthargique devint plus frêle et se transforma de façon étrange. En lieu et place de son épouse, le chevalier maintenant serrait contre lui une grande et merveilleuse fleur de lys blanc.

On était à la veille de Noël. La neige voletait dans les airs, chassée par le vent du nord. Une infinie tristesse planait sur le palais royal. De douleur, le vieux roi avait oublié ses prières. Blotti sous ses fourrures, il était silencieux en tête-à-tête avec le souvenir. Il avait fait jeter son frère dans le plus sombre des cachots et sa fille avait été transformée en corneille.
Le chevalier quant à lui, avait accroché son épée et son bouclier au mur de la salle d'armes de son château. Il s'était occupé ensuite de son vieux père, et à sa mort, il s'était retiré dans un cloître.
L'histoire ne dit pas quand il mourut, mais on peut voir encore sa tombe se couvrir de lys blancs et de myosotis le jour anniversaire de la mort de son épouse.
Du lys blanc, les moines firent le symbole de la chasteté et de l'innocence. Aussi, en ornaient-ils les images saintes.

Le vieux seigneur avait un fils unique. Son visage rappelait la grande beauté de sa mère, brune aux yeux bleus de lin. Son père aurait désiré le marier à une jeune fille de bon lieu, mais il ne fallait pas songer à lui passer l'anneau nuptial. Affligé par la disparition précoce et brutale de sa mère, il n'éprouvait que mépris pour les prétendantes. Bien des jeunes filles passaient sous les hautes murailles du château dans l'espoir que le regard du jeune homme s'arrêterait sur elles, ne serait-ce qu'avec une ombre de complaisance. Mais toutes étaient pour lui comme galets sur la grève.
Jour après jour on le vit s'agenouiller sur la tombe de sa mère et cela brisait le cœur de l'écouter passer des soupirs aux pleurs et des larmes aux lamentations.
Alors le vieux père alla trouver le chapelain et le pria de garder son fils dans sa cellule pendant le temps qu'il lui faudrait pour revenir à la raison.
Le jeune homme commença par se courroucer contre cette décision. Et puis, comme le gros et plaintif moine ne l'importunait guère, il pensa qu'il était plus sage de le suivre aux matines et de servir la messe.
Le printemps arriva. Certains jours la mer était si douce et la lande si belle sous le soleil qu'il en perdait le fil de ses prières et la méditation de la mort finit par lui peser.
Il n'avait pas le cœur à se divertir mais il désira quitter le château familial pour aller au loin, gagner la gloire dans les combats, comme c'était le devoir d'un chevalier.
Après avoir passé sa veillée d'armes dans la chapelle du château, il avait gagné la campagne, ganté et cuirassé, avec sur son écu l'éclair sombre d'une panthère dressée sur ses pattes arrières, l'emblème de sa famille.

C'était un jour de mauvais temps. L'océan avait un air spectral. La brume y était plus épaisse que l'écume du ressac et la lune plus livide que la chair des morts. Le jeune aventurier laissa derrière lui les grèves sonores et les hautes falaises pour piquer droit à travers une campagne de vergers et de pâturages coupés de haies d'aubépine. Perdu dans ses pensées, il chevauchait déjà depuis de longues heures sur un chemin creux quand une très belle jeune fille lui apparut.
Le chevalier s'était arrêté ébloui. Elle se tenait assise sur un banc de marbre blanc dominé par une stèle et flanqué de chaque côté d'un cyprès. Derrière elle, sur un ciel bleu pâle balayé de nuages, s'ouvrait un jardin aux allées symétriques bordées de buis et de lauriers, puis de cyprès et de pins qui menaient à une place dallée de marbre avec en son centre une fontaine ornée de figures de bronze.

Les elfes, disait-on, avaient coutume d'apparaître ainsi, à la fin du jour, aux voyageurs fatigués. Aussi, redoutant quelque piège, se signa-t-il dévotement trois fois. Il voulut réciter en latin un "Pater", mais la jeune fille le regardait intensément. Elle était si belle et si pleine de sortilèges qu'il s'arrêta de respirer. Ses cheveux d'un blond très pâle, couronnés d'un étroit bandeau de perles rouges, flottaient sur ses épaules d'une blancheur d'hostie. Une longue robe d'une étoffe si légère qu'on l'eût crue tissée par les elfes, d'un bleu argenté flottant sur les reins la moulait à la taille. A son cou et à ses bras, des rubis scintillaient limpides et chauds. Chaussés d'escarpins de satin rouge, ses pieds reposaient sur un coussin de fleurs d'une blancheur immaculée.
Subjugué par tant de beauté, le jeune chevalier instinctivement descendit de cheval, mit un genou en terre et baisa les longues mains délicates.
- Princesse de rêve, je te salue ! lui dit-il.
Elle posa sur lui ses yeux d'un azur enivrant et lui répondit :
- Je te souhaite la bienvenue, noble chevalier !
- Vois-tu, ma gracieuse princesse, poursuivit le gentilhomme, j'avais acquis la conviction qu'il n'existait aucune femme aussi aimante, bienveillante et noble que ma défunte mère. Mais à présent que j'ai devant moi son vivant portrait, j'ai le sentiment que des hauteurs célestes elle répand sa bénédiction sur nous. Princesse ou elfe, je t'en prie, laisse-moi te prendre en croupe et mène-moi à ton père afin que je lui demande ta main.
La blonde jeune fille passa ses bras au cou du chevalier qui l'asseyait sur son destrier.
Tournant le dos au splendide portique, ils chevauchèrent vers le château qui érigeait sa masse crénelée et flanquée de hautes tours derrière les cyprès. Les doux rayons du crépuscule faisaient resplendir les briques des créneaux, les toits d'ardoise des donjons et l'or des oriflammes de soie pourpre qui ondulaient au sommet des poivrières. Voici le château de mon auguste père, dit la princesse d'une voix claire et mélodieuse, car il faut que tu saches que malheureusement j'ai perdu ma mère.
Sous sa lourde couronne d'or, son long manteau bordé d'hermine et sa barbe blanche, c'était le roi le plus majestueux que le jeune chevalier eût rencontré. Le vieux seigneur lui réserva bon accueil car il reconnut dans le gentilhomme le fils de son meilleur ami parti au loin depuis d'innombrables années. Le jeune homme obtint sans peine la main de sa fille.

Les noces furent célébrées avec un déploiement de faste. Elles durèrent trois jours, au bout desquels le chevalier dit à sa jeune épouse :
- Mon père est un riche seigneur de haute lignée mais le poids des ans l'a rendu ombrageux et insupportable. Aussi, n'irons-nous pas nous établir chez lui, mais dans un château situé à la pointe d'une très belle anse de sable où le bleu du ciel se confond avec le bleu de la mer et le bleu vert de la mer avec le vert des prairies qui s'étendent à perte de vue au pied des murailles.
- Je te suis volontiers, répondit la jeune femme, mais il faut que tu me promettes que jamais tu ne parleras de plantes toxiques et de mort. Je n'étais alors qu'une toute petite fille lorsque j'entendis ma nourrice dire à une servante : "Pauvre petite princesse. Sa mère a été tuée par des plantes toxiques." Et depuis lors, je les crains et tremble à l'idée que le même sort pourrait m'être réservé.
Le chevalier le va la main droite et jura :
- Sur notre amour éternel, je te jure que jamais par-devant moi je ne parlerai de plantes toxiques ou de mort.
Ils quittèrent le palais royal l'après-midi même, voyageant sans suite et sans écuyer.
Montés sur le même cheval, ils chevauchaient sur un chemin de campagne à l'ombre haute des blés sous le regard profond des fleurs éveillées soudain. Une forêt obscure au sol baigné d'ombres bleuâtres en fermait l'horizon.
Le calme de cette forêt n'était qu'apparent. Des animaux sauvages la sillonnaient dans tous les sens dans de grands bruits de branches cassées ; d'autres combattaient avec une fureur telle que les oiseaux dans les nids s'en effaraient. Des croassements lugubres de corneilles retentirent à travers la forêt faisant dresser l'oreille à la princesse. Puis, ce furent des clameurs de détresse éclatant sporadiquement et vite étouffées qui la remplir d'horreur. Etait-ce bien la sempiternelle querelle des corneilles qui reprenait plus bruyante à chaque fois et qui à la longue l'angoissait ? Ou n'était-ce pas plutôt des commérages de sorcières ?
Elle le sentait bien maintenant. La forêt était sous le charme d'un magicien ; cette atmosphère moite et toutes ces ailes noires qui enténébraient la forêt et le ciel blanc étaient ensorcelées. La princesse se serra craintivement entre les bras de son protecteur.
A la lisière de la forêt, une inquiétante végétation avait jailli du sol ; le chemin en était envahi de toute part. C'étaient des ronces, des grandes ciguës, des digitales pourpres, des jusquiames noires, des stramoines, et toutes s'enchevêtraient, s'étreignaient, envahissaient la mousse et l'herbe.

Le cheval noir refusa d'aller plus avant. Le chevalier le poussa mais il refusa d'obéir et se cabra.
- Hélas ! gémit la princesse, cette haie infranchissable est l'oeuvre de mon terrible oncle !
- Ton terrible oncle ?
- Il en est ainsi, cher époux. Vois-tu, je suis l'unique enfant de mes parents et la légitime héritière du trône. Le frère de mon père en veut à ma vie, afin que sa fille, laide et que l'amour dédaigne, puisse obtenir la couronne royale et ensuite, grâce à sa puissance et à son autorité, un époux.
- L'amour se gagne uniquement par l'amour, non par la richesse et encore moins par la force, répondit le chevalier.
- Ce ne sera pas un gentilhomme qui demandera la main de ma cousine, soupira la princesse, car elle est égoïste, jalouse, d'une humeur exécrable et ne cherche toujours que son propre avantage. Aussi, le bonheur lui file-t-il comme du sable entre les doigts.
- Ne crains rien, dit le chevalier, du tranchant de mon glaive je vais déchirer ce rideau de plantes maléfiques !
Mettant pied à terre, il leva son épée et sous son vol les plantes toxiques se couchaient par gerbes.
Ils poursuivirent leur chemin. Le ciel devint pesant et le cheval, la bouche sèche, se traînait plus qu'il ne marchait. Passant devant une falaise schisteuse, le gentilhomme aperçut l'eau d'une source couler par une faille. Il relâcha la bride pour laisser l'animal se désaltérer.

Le destrier tendit le cou vers l'eau mais recula aussitôt apeuré, car un bruit sifflant s'était fait entendre à l'intérieur du rocher et l'eau se couvrit aussitôt d'écume verte.
La princesse horrifiée passa les bras au cou de son époux et le supplia de quitter immédiatement les lieux.
- Calme-toi, ma chérie, dit-il, nous serons bientôt arrivés chez nous, dans notre château où, derrière ses murs puissants, tu seras à l'abri de tous les maux !
A peine eut-il prononcé ces paroles que tout deux furent saisis de voir surgir brusquement de son antre un dragon monstrueux. Son haleine puante empoisonnait l'herbe tout autour de lui, et sa langue fourchue dardait menaçante.
Blême d'épouvante, la princesse s'évanouit et le chevalier n'eut que le temps de la retenir de son bras gauche et de saisir la lance de la main droite pour transpercer le cou de la terrible bête. Un sang épais et noir éclaboussa le sol. Mortellement atteint, le monstre s'affaissa.

Le reste du voyage s'effectua sans encombre.
Comme leurs caractères s'accordaient et qu'ils s'aimaient, les semaines et les mois passaient vite au château. Toutefois, le chevalier avait le pressentiment que son bonheur était bien trop grand pour durer longtemps.
On était alors en plein été et de longues plates-bandes de lys blancs embaumaient l'air du jardin. Voyant son époux tourmenté par de sombres pensées et connaissant le pouvoir de guérison des fleurs, elle descendit dans le jardin. Elle en cueillit quelques-unes qu'elle alla poser sur le front du chevalier. Alors les elfes écartèrent ses mauvais rêves, les kobolds ses pensées tristes, et ses larmes tarirent comme les gouttes de rosée que le soleil aspire dans les calices des fleurs.


Le méchant oncle de la princesse ne desserrait plus les dents de rage. Il était convaincu que le chevalier normand n'avait épousé la fille du roi que pour ses droits successoraux. Aussi ne songeait-il plus qu'à l'écarter du trône. En la supprimant, il ferait de sa propre fille l'héritière légitime.
A la cour du roi officiait un maître de cérémonie. Avare, avide et sans scrupules, il était l'homme parfait pour exécuter les funestes projets de l'oncle.
L'occasion se présenta lorsque le roi rendit visite à sa fille. Une grande fête en son honneur était prévue au château. L'oncle compta alors dix mille écus d'or au maître de cérémonie qui accepta de dissimuler des plantes toxiques sous la table de fête et de faire chanter par des troubadours une chanson évoquant la mort.
Au château le roi fut reçu avec tous les honneurs qui lui étaient dus. Il y avait force concours de musiciens et vers le milieu du fastueux banquet un étrange troubadour fit son entrée. Il était sanglé dans un étroit justaucorps de velours noir et ses yeux sombres cachés sous d'épais sourcils brillaient d'un éclat étrange, presque menaçant, tandis que l'espace d'un instant sa lèvre supérieure se retroussait en un rictus. Il se courba révérencieusement devant la princesse et entonna une chanson :
"Princesse, la grâce emplit tes dix-neuf ans.
Ton regard dit toute la beauté du printemps
Il semble que ta main tient un lys invisible
C'est donc à toi ma sage muse, fleur sensible
Que j'adresse aujourd'hui ces quelques beaux couplets.
Mai, c'est le mois des fleurs, des bois et des allées,
Tôt vient la saison où se penche la rose.
Tout passe. La vie est une triste chose
Qui ruine et métamorphose toute beauté.
Le sommeil de la mort va bientôt t'enchanter,
Ton trône sera le tombeau, et dans l'ombre
L'oubli retombera sur ton doux front sombre."

Tout en prononçant ces dernières paroles, le troubadour ce suppôt du diable, tira de ses larges manches, deux touffes de plantes toxiques, symboles de la mort et les brandit menaçant.Ton regard dit toute la beauté du printemps
Il semble que ta main tient un lys invisible
C'est donc à toi ma sage muse, fleur sensible
Que j'adresse aujourd'hui ces quelques beaux couplets.
Mai, c'est le mois des fleurs, des bois et des allées,
Tôt vient la saison où se penche la rose.
Tout passe. La vie est une triste chose
Qui ruine et métamorphose toute beauté.
Le sommeil de la mort va bientôt t'enchanter,
Ton trône sera le tombeau, et dans l'ombre
L'oubli retombera sur ton doux front sombre."

Il s'en suivit une terrible agitation. Tirant son épée du fourreau, le chevalier se jeta sur l'infâme chanteur et l'abattit avec ses paroles : "Tiens ! Te voici payé pour ton chant diabolique."
La princesse s'était affaissée sans connaissance. Ses chambrières se précipitèrent à son secours.
Quand le chevalier prit son épouse dans ses bras, son doux corps léthargique devint plus frêle et se transforma de façon étrange. En lieu et place de son épouse, le chevalier maintenant serrait contre lui une grande et merveilleuse fleur de lys blanc.

On était à la veille de Noël. La neige voletait dans les airs, chassée par le vent du nord. Une infinie tristesse planait sur le palais royal. De douleur, le vieux roi avait oublié ses prières. Blotti sous ses fourrures, il était silencieux en tête-à-tête avec le souvenir. Il avait fait jeter son frère dans le plus sombre des cachots et sa fille avait été transformée en corneille.
Le chevalier quant à lui, avait accroché son épée et son bouclier au mur de la salle d'armes de son château. Il s'était occupé ensuite de son vieux père, et à sa mort, il s'était retiré dans un cloître.
L'histoire ne dit pas quand il mourut, mais on peut voir encore sa tombe se couvrir de lys blancs et de myosotis le jour anniversaire de la mort de son épouse.
Du lys blanc, les moines firent le symbole de la chasteté et de l'innocence. Aussi, en ornaient-ils les images saintes.
Dernière édition par Freya le Mer 17 Avr 2013 - 18:12, édité 2 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Le Pois de Senteur
Le Pois de Senteur
Il y a bien quelques six cents ans de cela, une guerre ensanglantait l'Espagne. Il fallait parcourir cinquante lieues de plaines aux villes incendiées et de vallées où se répercutaient les derniers échos des combats, pour atteindre la retraite farouche et sûre des deux filles d'un vieux seigneur qui guerroyait.
Leur maison austère était située à proximité d'une forêt séculaire. Sveltes, grandes, très sérieuses, les cheveux foncés et de très beaux yeux noirs, les deux soeurs vivaient là, à l'abri des regards. Rien, hormis la lumière du soleil n'y pénétrait. Calme, le cœur empli d'une joyeuse espérance, elles attendaient la fin des hostilités et le retour de leurs fiancés. Pensives, elles se promenaient à pas lents dans leur jardin où leurs pieds foulaient un sol fleuri de crocus et de primevères au printemps, jonché de feuilles humides exhalant une odeur triste en automne. Ainsi durant des années. Sous les portraits de leurs fiancés, les roses fanées faisaient des taches de rouille, et de leurs pétales émanait une odeur fade. Cette odeur tendre et triste flottait aussi sur le parc entouré de hauts murs tapissés de mouvantes feuilles de lierre étoilées çà et là, de fleurs de clématites.
Or, dans un ravissant espalier ornant le jardin des deux vieilles demoiselles, vivait Mademoiselle Pois-de-Senteur, une petite fleur très fière, mais si casanière qu'il lui paraissait impossible de relâcher, ne fut-ce qu'un instant, l'étreinte de ses frêles vrilles. En tirant légèrement en arrière ses deux grands pétales bleu-lilas en forme de capuchon, on pouvait apercevoir un petit visage au front recouvert d'une frange de cheveux formés par les étamines.
 Lorsque Mademoiselle Pois-de-Senteur entendit les deux vieilles demoiselles parler du triste roman de leurs cœurs, elle en fut si émue qu'elle tomba dans une profonde mélancolie. Les membres de sa famille se consultèrent et estimèrent que Mademoiselle Pois-de-Senteur était d'âge à se marier. Mais la petite fleur refusa.
Lorsque Mademoiselle Pois-de-Senteur entendit les deux vieilles demoiselles parler du triste roman de leurs cœurs, elle en fut si émue qu'elle tomba dans une profonde mélancolie. Les membres de sa famille se consultèrent et estimèrent que Mademoiselle Pois-de-Senteur était d'âge à se marier. Mais la petite fleur refusa.
Alors Juanita, une vieille pie bavarde qui avait couru le monde et qui nichait à présent dans un arbre du parc, mais qu'on ne pouvait pas toujours croire sur parole, raconta à qui voulut bien l'écouter l'histoire suivante.

Sans faire de longs discours, un jeune bourdon passionné, mais peu discret, se serait empressé de demander Mademoiselle Pois-de-Senteur en mariage, et aurait même déposé à ses pieds, toute sa fortune constituée de poudre d'or. Mais l'audace du jeune bourdon aurait effarouché Mademoiselle Pois-de-Senteur, cette stupide "jeunette", que les deux vieilles sœurs avaient omis d'instruire. Elle était si naïve que le jour où sur un air de danse affecté, une jeune libellule lui soupira de tendres paroles, elle ne saisit pas le sens délicat des mots, et son cœur ne devina pas que c'était là une déclaration d'amour.
Quelques jours plus tard, Mademoiselle Pois-de-Senteur vécut un affreux cauchemar. La belle libellule lui donnait son aubade quotidienne. Tout l'attirait dans ce jeune inconnu : son attitude passionnée, sa sveltesse, ses grands yeux brillants, et jusqu'à ses ailes d'elfe d'une transparence irisée. Sa chanson montait persuasive et tendre, et elle, dont le coeur n'avait pas été initié aux choses de la vie, défaillait de joie à s'entendre requérir d'amour... quand, tout à coup, un orage terrible éclata. La foudre atteignit de plein fouet le pauvre soupirant.


A la suite de cet horrible accident, Mademoiselle Pois-de-Senteur avait caché son visage mélancolique sous un bonnet de veuve qu'elle prenait soin de garder rabattu sur son front. De douleur aveuglée, elle ne laissait plus aucun prétendant l'approcher, et elle resserra davantage l'étreinte de ses frêles vrilles sur l'espalier familial. Et les soirs d'orage, on pouvait la voir se dresser dans les rafales de vent, les flancs battus par les pans de sa robe bleu-lavande, le regard affligé, tourné vers le passé dont l'ombre, parfois, passait dans le miroir de l'eau morte des flaques.
A présent, Mademoiselle Pois-de-Senteur est devenue une vieille dame d'un âge fort respectable. Mais il semble qu'elle pleure toujours son bonheur perdu car, récemment, elle confiait à sa meilleure amie, sous le sceau du secret le plus absolu (et cette amie me l'a répété), à quel point son cœur souffrait encore. Mais, si aujourd'hui, elle porte encore son bonnet démodé de veuve, ce n'est plus uniquement en raison du deuil qui l'a frappée jadis, mais... enfin, cela ne se crie pas sur les toits... elle est devenue chauve ! Mais pour l'amour du ciel, chère enfant, ne va pas répéter à la vieille demoiselle ce que je viens de te révéler ! Elle prendrait fort mal la chose et en tomberait même malade à mourir. Elle est une très vielle dame terriblement pédante. Mais elle s'endort fréquemment, la tête inclinée vers la poitrine. Alors, prudemment, tu pourras peut-être l'approcher, pour constater si je t'ai dit la vérité. Pauvre vieille demoiselle ; pauvre petit Pois-de-Senteur.
Leur maison austère était située à proximité d'une forêt séculaire. Sveltes, grandes, très sérieuses, les cheveux foncés et de très beaux yeux noirs, les deux soeurs vivaient là, à l'abri des regards. Rien, hormis la lumière du soleil n'y pénétrait. Calme, le cœur empli d'une joyeuse espérance, elles attendaient la fin des hostilités et le retour de leurs fiancés. Pensives, elles se promenaient à pas lents dans leur jardin où leurs pieds foulaient un sol fleuri de crocus et de primevères au printemps, jonché de feuilles humides exhalant une odeur triste en automne. Ainsi durant des années. Sous les portraits de leurs fiancés, les roses fanées faisaient des taches de rouille, et de leurs pétales émanait une odeur fade. Cette odeur tendre et triste flottait aussi sur le parc entouré de hauts murs tapissés de mouvantes feuilles de lierre étoilées çà et là, de fleurs de clématites.
Or, dans un ravissant espalier ornant le jardin des deux vieilles demoiselles, vivait Mademoiselle Pois-de-Senteur, une petite fleur très fière, mais si casanière qu'il lui paraissait impossible de relâcher, ne fut-ce qu'un instant, l'étreinte de ses frêles vrilles. En tirant légèrement en arrière ses deux grands pétales bleu-lilas en forme de capuchon, on pouvait apercevoir un petit visage au front recouvert d'une frange de cheveux formés par les étamines.

Alors Juanita, une vieille pie bavarde qui avait couru le monde et qui nichait à présent dans un arbre du parc, mais qu'on ne pouvait pas toujours croire sur parole, raconta à qui voulut bien l'écouter l'histoire suivante.

Sans faire de longs discours, un jeune bourdon passionné, mais peu discret, se serait empressé de demander Mademoiselle Pois-de-Senteur en mariage, et aurait même déposé à ses pieds, toute sa fortune constituée de poudre d'or. Mais l'audace du jeune bourdon aurait effarouché Mademoiselle Pois-de-Senteur, cette stupide "jeunette", que les deux vieilles sœurs avaient omis d'instruire. Elle était si naïve que le jour où sur un air de danse affecté, une jeune libellule lui soupira de tendres paroles, elle ne saisit pas le sens délicat des mots, et son cœur ne devina pas que c'était là une déclaration d'amour.
Quelques jours plus tard, Mademoiselle Pois-de-Senteur vécut un affreux cauchemar. La belle libellule lui donnait son aubade quotidienne. Tout l'attirait dans ce jeune inconnu : son attitude passionnée, sa sveltesse, ses grands yeux brillants, et jusqu'à ses ailes d'elfe d'une transparence irisée. Sa chanson montait persuasive et tendre, et elle, dont le coeur n'avait pas été initié aux choses de la vie, défaillait de joie à s'entendre requérir d'amour... quand, tout à coup, un orage terrible éclata. La foudre atteignit de plein fouet le pauvre soupirant.


A la suite de cet horrible accident, Mademoiselle Pois-de-Senteur avait caché son visage mélancolique sous un bonnet de veuve qu'elle prenait soin de garder rabattu sur son front. De douleur aveuglée, elle ne laissait plus aucun prétendant l'approcher, et elle resserra davantage l'étreinte de ses frêles vrilles sur l'espalier familial. Et les soirs d'orage, on pouvait la voir se dresser dans les rafales de vent, les flancs battus par les pans de sa robe bleu-lavande, le regard affligé, tourné vers le passé dont l'ombre, parfois, passait dans le miroir de l'eau morte des flaques.
A présent, Mademoiselle Pois-de-Senteur est devenue une vieille dame d'un âge fort respectable. Mais il semble qu'elle pleure toujours son bonheur perdu car, récemment, elle confiait à sa meilleure amie, sous le sceau du secret le plus absolu (et cette amie me l'a répété), à quel point son cœur souffrait encore. Mais, si aujourd'hui, elle porte encore son bonnet démodé de veuve, ce n'est plus uniquement en raison du deuil qui l'a frappée jadis, mais... enfin, cela ne se crie pas sur les toits... elle est devenue chauve ! Mais pour l'amour du ciel, chère enfant, ne va pas répéter à la vieille demoiselle ce que je viens de te révéler ! Elle prendrait fort mal la chose et en tomberait même malade à mourir. Elle est une très vielle dame terriblement pédante. Mais elle s'endort fréquemment, la tête inclinée vers la poitrine. Alors, prudemment, tu pourras peut-être l'approcher, pour constater si je t'ai dit la vérité. Pauvre vieille demoiselle ; pauvre petit Pois-de-Senteur.
Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:36, édité 2 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Le Tournesol
Le Tournesol
Cela se passait avant le commencement du Temps. Les ténèbres recouvraient alors le monde, et seul le Tout-Puissant existait dans l'espace infini où tout était vide. Ce fut alors que de Son souffle Il couvrit le ciel de cristal et le sépara de la terre. A Sa parole parut la lumière qu'Il plaça dans le soleil qui commença aussitôt à luire. Avec la première aurore, l'humidité tomba du ciel sur la terre, ce qui permit à une vilaine mais robuste petite plante de percer péniblement l'écorce terrestre pour atteindre la lumière. Avec une ferme volonté de vivre, elle étendit ses feuilles vertes en forme de coeur. Au sommet d'une puissante tige, elle développa un disque de couleur bronze. Chaque matin, elle s'orientait vers le soleil qu'elle suivait dans sa course jusqu'au soir où, fatiguée, elle baissait la tête.
On appela "Cœur de bronze" cette plante qui fut la première à sortir du sein de la Terre-Mère après le chaos, pour saluer le soleil.
Des rayons de soleil elle puisa avidement douceur, lumière, chaleur et joie de vivre. Pour elle, l'astre de vie était la perfection et, en reconnaissance de ses bienfaits, elle lui jura fidélité, amour et obéissance.
Sans se préoccuper de ce qui se passait autour de lui, "Cœur de Bronze" plein d'ardeur et d'enthousiasme, plongea ses racines plus profondément dans le sol.
Mais pour les animaux qui vinrent peupler la terre, "Cœur de Bronze" devint rapidement un sujet de moquerie, et ils la traitèrent même "d'odieuse créature de la Création".
Ces paroles blessantes lui firent l'effet d'un coup de fouet. Il tressaillit mais ne dit mot. Il ne voulait en aucun cas se laisser entraîner dans de basses querelles.
Même le merle siffleur que "Cœur de Bronze" trouvait sympathique, se mit à le railler un jour du sommet d'un buisson voisin, en le traitant de créature égoïste, paresseuse et arrogante.

Non loin de là une taupe qui élevait son tertre cligna des paupières avec mépris et renchérit :
- Je n'ai jamais rien vu d'aussi stupide que ce "Cœur de Bronze" qui passe sa journée à fixer l'aveuglant soleil.
"Cœur de Bronze" resta inébranlable, mais un désespoir envahit soudain son cœur, un désespoir semblable à celui d'un banni délaissé. Le Tout-Puissant qui sait tout, ordonna au soleil d'avoir une attitude particulièrement amicale envers la plante, mais de laisser la crise atteindre son paroxysme avant d'intervenir.
- Odieuse créature ! continuaient les animaux de la prairie en passant près de "Cœur de Bronze" qui gardait la tête toujours tournée vers le soleil, son idéal.
- Comment pourraient-ils me comprendre ? murmura-t-il. Que savent-ils de moi, de mes aspirations secrètes, de mes espoirs ?

Le soleil écouta avec sérénité les douces résonances de cette première douleur. Il avait tout observé, tout entendu. Il n'ignorait rien de la patience, de la persévérance de la plante si méprisée, et de sa confiance en lui. Il forma son jugement et, avec sérénité il lui dit enfin :
- On te traite d'odieuse créature, pauvre plante ?
- De cela et de bien de choses bien pires encore ! Gémit "Cœur de Bronze".
- On te raille comme un fou aveuglé par mes rayons ? Qu'il n'en soit plus ainsi ! Que les mauvaises langues se taisent et regrettent ! Je sais tout. Tu ne t'es laissé aller à aucune vilenie, et comme j'aide tout ambitieux honnête à réaliser ses désirs, tu verras ton espérance fleurir en pétales dorés autour de ton cœur de couleur bronze. Car vois-tu, le feu divin brûle dans tous les cœurs, mais quand il éveille les étincelles de l'exaltation, il flambe et s'élève en flammes claires.
- C'est en toute humilité que je m'incline devant toi pour te remercier, dit "Cœur de Bronze". A présent, je me rends compte que chaque vie peut être belle quand quelqu'un de compréhensif se tient à votre côté, prêt à vous aider.
Et le cœur remplit d'espoir, il agita ses petites feuilles vertes.
- Vois-tu, dit encore le soleil, même moi, je dois obéir à des ordres supérieurs, à Dieu le Père, le Créateur et Seigneur de toute chose. Ecoute-moi bien et saisis le sens de mes paroles. La terre se dessèche, les sources et les rivières tarissent. Tout ce qui verdit et fleurit, les arbres et les buissons, l'herbe et les fleurs, meurent de soif. Afin qu'ils puissent se reprendre, le Tout-Puissant a ordonné que je me cache derrière les nuages jusqu'à ce que la pluie ait revivifié la nature. Mais auparavant, je veux te récompenser pour ton honnêteté, ta confiance et ton zèle. Pour ta foi inébranlable, mes propres rayons te couronneront ; ils encercleront et fleuriront d'or ton cœur de couleur bronze. Ainsi paré, tu pourras tenir haut la tête au-dessus de celles des autres fleurs.
Alors "Cœur de Bronze" baissa ses regards sur sa tige très épaisse et fort disgracieuse et répondit :
- Comment pourrais-je être digne d'un tel honneur ? Ne suis-je pas "l'odieuse créature de la Création" ?
- Mais non ! dit le soleil avec bienveillance. J'ai jugé cette affaire. Aie confiance et laisse-moi appliquer la sentence. Couronné comme un prince, tu pourras, grâce à ta puissante tige, te tenir bien au-dessus des autres fleurs des champs, des forêts et des prairies. Pour te dédommager de tout le mépris et de toutes les moqueries dont la animaux t'ont accablé, mais aussi, pour avoir été mon serviteur de confiance dès la première aube, tu porteras désormais mon nom : Fleur du Soleil ou Tournesol. Jamais plus aucune créature ne te traitera d'égoïste ou de bon à rien, car tu seras une plante des plus utiles et des plus précieuses de la nature. En effet, tes graines pourront servir de nourriture aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Toujours de tes graines, l'homme tirera une huile d'une très grande valeur nutritive, et de tes pétales d'or, une substance pour teindre ses vêtements. Quant à tes racines, elles amélioreront la qualité du sol, car elles absorberont les substances novices à la bonne croissance d'autres plantes utiles.

C'est ainsi que "Cœur de Bronze" fut changé en lumineux et fier "Tournesol" que nous connaissons tous. Noble et généreux, il embellit nos jardins et les champs, et offre les brillantes graines de son cœur à ceux qui la raillèrent et qui lui firent tant de mal autrefois, les oiseaux du ciel et les animaux des champs.
On appela "Cœur de bronze" cette plante qui fut la première à sortir du sein de la Terre-Mère après le chaos, pour saluer le soleil.
Des rayons de soleil elle puisa avidement douceur, lumière, chaleur et joie de vivre. Pour elle, l'astre de vie était la perfection et, en reconnaissance de ses bienfaits, elle lui jura fidélité, amour et obéissance.
Sans se préoccuper de ce qui se passait autour de lui, "Cœur de Bronze" plein d'ardeur et d'enthousiasme, plongea ses racines plus profondément dans le sol.
Mais pour les animaux qui vinrent peupler la terre, "Cœur de Bronze" devint rapidement un sujet de moquerie, et ils la traitèrent même "d'odieuse créature de la Création".
Ces paroles blessantes lui firent l'effet d'un coup de fouet. Il tressaillit mais ne dit mot. Il ne voulait en aucun cas se laisser entraîner dans de basses querelles.
Même le merle siffleur que "Cœur de Bronze" trouvait sympathique, se mit à le railler un jour du sommet d'un buisson voisin, en le traitant de créature égoïste, paresseuse et arrogante.

Non loin de là une taupe qui élevait son tertre cligna des paupières avec mépris et renchérit :
- Je n'ai jamais rien vu d'aussi stupide que ce "Cœur de Bronze" qui passe sa journée à fixer l'aveuglant soleil.
"Cœur de Bronze" resta inébranlable, mais un désespoir envahit soudain son cœur, un désespoir semblable à celui d'un banni délaissé. Le Tout-Puissant qui sait tout, ordonna au soleil d'avoir une attitude particulièrement amicale envers la plante, mais de laisser la crise atteindre son paroxysme avant d'intervenir.
- Odieuse créature ! continuaient les animaux de la prairie en passant près de "Cœur de Bronze" qui gardait la tête toujours tournée vers le soleil, son idéal.
- Comment pourraient-ils me comprendre ? murmura-t-il. Que savent-ils de moi, de mes aspirations secrètes, de mes espoirs ?

Le soleil écouta avec sérénité les douces résonances de cette première douleur. Il avait tout observé, tout entendu. Il n'ignorait rien de la patience, de la persévérance de la plante si méprisée, et de sa confiance en lui. Il forma son jugement et, avec sérénité il lui dit enfin :
- On te traite d'odieuse créature, pauvre plante ?
- De cela et de bien de choses bien pires encore ! Gémit "Cœur de Bronze".
- On te raille comme un fou aveuglé par mes rayons ? Qu'il n'en soit plus ainsi ! Que les mauvaises langues se taisent et regrettent ! Je sais tout. Tu ne t'es laissé aller à aucune vilenie, et comme j'aide tout ambitieux honnête à réaliser ses désirs, tu verras ton espérance fleurir en pétales dorés autour de ton cœur de couleur bronze. Car vois-tu, le feu divin brûle dans tous les cœurs, mais quand il éveille les étincelles de l'exaltation, il flambe et s'élève en flammes claires.
- C'est en toute humilité que je m'incline devant toi pour te remercier, dit "Cœur de Bronze". A présent, je me rends compte que chaque vie peut être belle quand quelqu'un de compréhensif se tient à votre côté, prêt à vous aider.
Et le cœur remplit d'espoir, il agita ses petites feuilles vertes.
- Vois-tu, dit encore le soleil, même moi, je dois obéir à des ordres supérieurs, à Dieu le Père, le Créateur et Seigneur de toute chose. Ecoute-moi bien et saisis le sens de mes paroles. La terre se dessèche, les sources et les rivières tarissent. Tout ce qui verdit et fleurit, les arbres et les buissons, l'herbe et les fleurs, meurent de soif. Afin qu'ils puissent se reprendre, le Tout-Puissant a ordonné que je me cache derrière les nuages jusqu'à ce que la pluie ait revivifié la nature. Mais auparavant, je veux te récompenser pour ton honnêteté, ta confiance et ton zèle. Pour ta foi inébranlable, mes propres rayons te couronneront ; ils encercleront et fleuriront d'or ton cœur de couleur bronze. Ainsi paré, tu pourras tenir haut la tête au-dessus de celles des autres fleurs.
Alors "Cœur de Bronze" baissa ses regards sur sa tige très épaisse et fort disgracieuse et répondit :
- Comment pourrais-je être digne d'un tel honneur ? Ne suis-je pas "l'odieuse créature de la Création" ?
- Mais non ! dit le soleil avec bienveillance. J'ai jugé cette affaire. Aie confiance et laisse-moi appliquer la sentence. Couronné comme un prince, tu pourras, grâce à ta puissante tige, te tenir bien au-dessus des autres fleurs des champs, des forêts et des prairies. Pour te dédommager de tout le mépris et de toutes les moqueries dont la animaux t'ont accablé, mais aussi, pour avoir été mon serviteur de confiance dès la première aube, tu porteras désormais mon nom : Fleur du Soleil ou Tournesol. Jamais plus aucune créature ne te traitera d'égoïste ou de bon à rien, car tu seras une plante des plus utiles et des plus précieuses de la nature. En effet, tes graines pourront servir de nourriture aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Toujours de tes graines, l'homme tirera une huile d'une très grande valeur nutritive, et de tes pétales d'or, une substance pour teindre ses vêtements. Quant à tes racines, elles amélioreront la qualité du sol, car elles absorberont les substances novices à la bonne croissance d'autres plantes utiles.

C'est ainsi que "Cœur de Bronze" fut changé en lumineux et fier "Tournesol" que nous connaissons tous. Noble et généreux, il embellit nos jardins et les champs, et offre les brillantes graines de son cœur à ceux qui la raillèrent et qui lui firent tant de mal autrefois, les oiseaux du ciel et les animaux des champs.
Dernière édition par Freya le Dim 8 Sep 2013 - 10:16, édité 2 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 L'Aster Bleu et la Verge d'Or
L'Aster Bleu et la Verge d'Or
La Verge d'Or et l'Aster Bleu se disputaient à propos de l'endroit le plus favorable pour grandir et fleurir, et l'Aster conseilla à son amie d'aller s'établir à l'écart de la grande route, mais la Verge d'Or n'était pas du tout de cet avis.
- Non, dit-elle, je ne puis suivre ton conseil, car vois-tu, je préfère me tenir en bordure de la grande route, là où l'on peut voir beaucoup de choses et rencontrer des gens intéressants. Je veux grandir et épanouir mes fleurs au bord du chemin. Et là, jour et nuit, aussi longtemps que je le pourrai, je veux tout entendre, tout voir, et tout savoir !
- A présent, dit alors simplement l'Aster, nos chemins se séparent, car je n'ai nulle envie de vivre dans la poussière de la route. Je vais aller m'établir loin d'ici, au milieu des prés verts sous un ciel bleu et riant. Dans les prairies fleuries, là où l'air est pur, je veux aller savourer la douceur de la nature.
- Eh bien, je te souhaite beaucoup de bonheur, dit en riant la Verge d'Or. Mais te doutes-tu seulement de tout ce que tu vas manquer ? Nous allons suivre des chemins bien différents. Tandis que tu vas passer une existence misérable et monotone, je lierai connaissance avec toutes sortes de gens intéressants voyageant sur la grande route et j'apprendrai ainsi beaucoup de choses.
C'est ainsi qu'ils se séparèrent.
Fidèle à sa parole, la Verge d'Or s'établit en observatrice silencieuse au bord de la route, et le soleil fit pousser ses fleurs en forme de grappes dorées.
Beaucoup de gens passèrent devant elle. D'abord, ce fut un bataillon de soldats revenant d'un exercice. Une odeur âpre de cuir trempé de sueur enveloppa la Verge d'Or. Fatigués et couverts de poussière, les hommes avaient pourtant l'air gai puisqu'ils chantaient en cœur une chanson à boire.
Puis, un groupe d'ouvriers apparut. Occupés non loin de là à la construction d'une voie ferrée, ils marchaient d'un pas las dans leurs habits tachés de boue et de graisse, mais aucun chant ne montait de leur poitrine.

Un long moment plus tard, la Verge d'Or perçut des aboiements et des roulements de voiture. C'étaient des nomades, des Gitans couverts de lambeaux. A côté du chariot où ils avaient entassé leur pittoresque fatras, des enfants à moitié nus sautillaient joyeusement. Revêtues d'étoffes chatoyantes, de ceintures et de colliers agrémentés de verroteries et de piécettes d'argent, des femmes se pressaient sur les pas d'une maigre jument attachée à l'arrière de la voiture.
Sous les roues, de gros nuages de poussière se soulevaient et se déposaient en couches grises sur les feuilles vertes et les fleurs de la Verge d'Or.
En fin de journée, la pluie se mit à tomber transformant la route en mare de boue.
Quand le soleil se coucha et que la pluie cessa, les pétarades d'une automobile retentirent, et dans un épais nuage bleu de gaz d'échappement elle passa en trombe, ramenant à la maison les convives d'un mariage.
Éclaboussée par les roues du véhicule, la pauvre Verge d'Or avait l'air d'avoir été traînée dans la boue. Mais elle tenait sa personne en si haute estime qu'elle ne voulait pas reconnaître la répugnance de son aspect.
Quelques jours plus tard, elle rencontra à nouveau l'Aster. D'un bleu clair et pur, la fleur était l'image même du ciel. La Verge d'Or dit dédaigneusement :
- Alors petite, es-tu encore toujours aussi incroyablement naïve ?
- Je suis restée la même, répondit modestement la petite fleur bleue. Mais toi, comme tu es devenue grande et belle ! Malheureusement tu as bien triste mine. La boue et la poussière de la route t'ont privée de tes belles couleurs.
- Qu'importe ! répondit avec fatuité la Verge d'Or. En contrepartie, j'ai eu une vie riche en expériences et enseignements. J'ai vu voyager beaucoup de gens. J'ai entendu leurs appels, leurs rires, leurs chants. J'ai vu leurs souffrances, leurs soucis, leurs douleurs, leurs regrets, mais aussi leur espoir d'un matin triomphant qu'ils ne verront sans doute jamais mais qui ne s'éteindra jamais dans leurs cœurs.
- Soit, je n'ai pas vécu ton expérience, répondit l'Aster, mais je suis resté frais et dispos, et toi, te voilà toute rouée, brisée et souillée ! Viens, suis-moi dans les prés, la nature t'y procurera aussi des plaisirs, différents certes, mais tout de même grands et doux. Tu pourras y admirer le travail de l'araignée tissant sa toile, écouter le bourdonnement de l'abeille retirant le pollen des fleurs, chanter le grillon dans
l'herbe et voir le scarabée rouler des boules.



La Verge d'Or baissa pensivement ses feuilles. L'Aster poursuivit :
- Et les uns donnent volontiers aux autres une part de ce qu'ils possèdent.
- Jamais je n'ai donné quelque chose, dit la Verge d'Or, je ne voulais que recevoir et je reconnais qu'à aucun moment je n'ai éprouvé de joie. Dis-moi l'Aster, crois-tu qu'une vie simple puisse me rendre heureuse ?
- Bien sûr ! affirma l'Aster, c'est un bonheur de pouvoir donner et partager avec quelqu'un.
- Ton bonheur est donc de partager avec autrui ce qui t'appartient et je devrais en faire de même ?
- Essaie. Tu verras, tu ne le regretteras pas.
- Comme tu es noble et généreux, reprit la Verge d'Or troublée, je me sens toute honteuse devant toi. A présent, je reconnais que la vie que j'ai menée ne m'a apportée que des plaisirs aveugles. Je me trouve là, au bord de la grande route, tachée, poussiéreuse, souillée et toi tu rayonnes de candeur, de fraîcheur et de jeunesse.
- Tu exagères, protesta l'Aster en baissant modestement la tête, je ne suis rien, rien qu'une toute petite chose insignifiante.
- Oh non ! Rien au monde n'est petit et insignifiant devant le Créateur, Son amour va aussi à la plus minuscule de Ses créatures.

Et maintenant, chère enfant, à toi de savoir à qui va ta préférence : à la fière et poussiéreuse Verge d'Or du bord de la grande route, ou à l'Aster Bleu qui peuple les lisières de forêt, les pentes herbeuses et les prés verts, qui rampe et se fait à peine remarquer tellement elle est insignifiante comparée à la Verge d'Or. Pourtant côte à côte, ils offrent une image superbe. A l'écart des chemins, par milliers les petites fleurs bleues étoilent les prés et à côté d'elles se dressent, hors de l'herbe luxuriante, des verges dont les fleurs en grappes brillent dans le ciel. Car l'Aster conduisit son amie loin de la route poussiéreuse, vers de paisibles prairies. De temps à autre, on peut voir ici ou là, une Verge d'Or se dresser au bord d'un poussiéreux chemin. Mais celles qui ont su comme l'Aster se retirer des lieux agités, ont sans doute fait le meilleur choix, car elles ont toujours l'air plus gai.
- Non, dit-elle, je ne puis suivre ton conseil, car vois-tu, je préfère me tenir en bordure de la grande route, là où l'on peut voir beaucoup de choses et rencontrer des gens intéressants. Je veux grandir et épanouir mes fleurs au bord du chemin. Et là, jour et nuit, aussi longtemps que je le pourrai, je veux tout entendre, tout voir, et tout savoir !
- A présent, dit alors simplement l'Aster, nos chemins se séparent, car je n'ai nulle envie de vivre dans la poussière de la route. Je vais aller m'établir loin d'ici, au milieu des prés verts sous un ciel bleu et riant. Dans les prairies fleuries, là où l'air est pur, je veux aller savourer la douceur de la nature.
- Eh bien, je te souhaite beaucoup de bonheur, dit en riant la Verge d'Or. Mais te doutes-tu seulement de tout ce que tu vas manquer ? Nous allons suivre des chemins bien différents. Tandis que tu vas passer une existence misérable et monotone, je lierai connaissance avec toutes sortes de gens intéressants voyageant sur la grande route et j'apprendrai ainsi beaucoup de choses.
C'est ainsi qu'ils se séparèrent.
Fidèle à sa parole, la Verge d'Or s'établit en observatrice silencieuse au bord de la route, et le soleil fit pousser ses fleurs en forme de grappes dorées.
Beaucoup de gens passèrent devant elle. D'abord, ce fut un bataillon de soldats revenant d'un exercice. Une odeur âpre de cuir trempé de sueur enveloppa la Verge d'Or. Fatigués et couverts de poussière, les hommes avaient pourtant l'air gai puisqu'ils chantaient en cœur une chanson à boire.
Puis, un groupe d'ouvriers apparut. Occupés non loin de là à la construction d'une voie ferrée, ils marchaient d'un pas las dans leurs habits tachés de boue et de graisse, mais aucun chant ne montait de leur poitrine.

Un long moment plus tard, la Verge d'Or perçut des aboiements et des roulements de voiture. C'étaient des nomades, des Gitans couverts de lambeaux. A côté du chariot où ils avaient entassé leur pittoresque fatras, des enfants à moitié nus sautillaient joyeusement. Revêtues d'étoffes chatoyantes, de ceintures et de colliers agrémentés de verroteries et de piécettes d'argent, des femmes se pressaient sur les pas d'une maigre jument attachée à l'arrière de la voiture.
Sous les roues, de gros nuages de poussière se soulevaient et se déposaient en couches grises sur les feuilles vertes et les fleurs de la Verge d'Or.
En fin de journée, la pluie se mit à tomber transformant la route en mare de boue.
Quand le soleil se coucha et que la pluie cessa, les pétarades d'une automobile retentirent, et dans un épais nuage bleu de gaz d'échappement elle passa en trombe, ramenant à la maison les convives d'un mariage.
Éclaboussée par les roues du véhicule, la pauvre Verge d'Or avait l'air d'avoir été traînée dans la boue. Mais elle tenait sa personne en si haute estime qu'elle ne voulait pas reconnaître la répugnance de son aspect.
Quelques jours plus tard, elle rencontra à nouveau l'Aster. D'un bleu clair et pur, la fleur était l'image même du ciel. La Verge d'Or dit dédaigneusement :
- Alors petite, es-tu encore toujours aussi incroyablement naïve ?
- Je suis restée la même, répondit modestement la petite fleur bleue. Mais toi, comme tu es devenue grande et belle ! Malheureusement tu as bien triste mine. La boue et la poussière de la route t'ont privée de tes belles couleurs.
- Qu'importe ! répondit avec fatuité la Verge d'Or. En contrepartie, j'ai eu une vie riche en expériences et enseignements. J'ai vu voyager beaucoup de gens. J'ai entendu leurs appels, leurs rires, leurs chants. J'ai vu leurs souffrances, leurs soucis, leurs douleurs, leurs regrets, mais aussi leur espoir d'un matin triomphant qu'ils ne verront sans doute jamais mais qui ne s'éteindra jamais dans leurs cœurs.
- Soit, je n'ai pas vécu ton expérience, répondit l'Aster, mais je suis resté frais et dispos, et toi, te voilà toute rouée, brisée et souillée ! Viens, suis-moi dans les prés, la nature t'y procurera aussi des plaisirs, différents certes, mais tout de même grands et doux. Tu pourras y admirer le travail de l'araignée tissant sa toile, écouter le bourdonnement de l'abeille retirant le pollen des fleurs, chanter le grillon dans
l'herbe et voir le scarabée rouler des boules.



La Verge d'Or baissa pensivement ses feuilles. L'Aster poursuivit :
- Et les uns donnent volontiers aux autres une part de ce qu'ils possèdent.
- Jamais je n'ai donné quelque chose, dit la Verge d'Or, je ne voulais que recevoir et je reconnais qu'à aucun moment je n'ai éprouvé de joie. Dis-moi l'Aster, crois-tu qu'une vie simple puisse me rendre heureuse ?
- Bien sûr ! affirma l'Aster, c'est un bonheur de pouvoir donner et partager avec quelqu'un.
- Ton bonheur est donc de partager avec autrui ce qui t'appartient et je devrais en faire de même ?
- Essaie. Tu verras, tu ne le regretteras pas.
- Comme tu es noble et généreux, reprit la Verge d'Or troublée, je me sens toute honteuse devant toi. A présent, je reconnais que la vie que j'ai menée ne m'a apportée que des plaisirs aveugles. Je me trouve là, au bord de la grande route, tachée, poussiéreuse, souillée et toi tu rayonnes de candeur, de fraîcheur et de jeunesse.
- Tu exagères, protesta l'Aster en baissant modestement la tête, je ne suis rien, rien qu'une toute petite chose insignifiante.
- Oh non ! Rien au monde n'est petit et insignifiant devant le Créateur, Son amour va aussi à la plus minuscule de Ses créatures.

Et maintenant, chère enfant, à toi de savoir à qui va ta préférence : à la fière et poussiéreuse Verge d'Or du bord de la grande route, ou à l'Aster Bleu qui peuple les lisières de forêt, les pentes herbeuses et les prés verts, qui rampe et se fait à peine remarquer tellement elle est insignifiante comparée à la Verge d'Or. Pourtant côte à côte, ils offrent une image superbe. A l'écart des chemins, par milliers les petites fleurs bleues étoilent les prés et à côté d'elles se dressent, hors de l'herbe luxuriante, des verges dont les fleurs en grappes brillent dans le ciel. Car l'Aster conduisit son amie loin de la route poussiéreuse, vers de paisibles prairies. De temps à autre, on peut voir ici ou là, une Verge d'Or se dresser au bord d'un poussiéreux chemin. Mais celles qui ont su comme l'Aster se retirer des lieux agités, ont sans doute fait le meilleur choix, car elles ont toujours l'air plus gai.
Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:43, édité 5 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Le Myosotis ou Vergiss-Mein-Nicht
Le Myosotis ou Vergiss-Mein-Nicht
Il y a bien longtemps, un chevalier du nom de Rodolphe de Rapoldsee passait sa veillée d'armes dans la chapelle du château où il était né. A l'aube du lendemain il devait rejoindre Saint Bernard, ganté, cuirassé et masqué par la grille de son casque au cimier d'argent, pour entreprendre une nouvelle croisade.

Puis, gagnant Spire par étapes, il avait fait halte au château du comte de Frankenstein où il trouvait bon accueil et bon gîte. Dans la haute salle aux voûtes blasonnées où le souper était servi, on se passait à la ronde autour de la table le hanap plein de vin. Un ménestrel s'aidant d'une mandoline, célébrait la beauté incomparable par sa longue chevelure souple et blonde de la fille du seigneur.
Berthe était son nom. Et le gratteur de cordes faisait délirer tous ces soldats et capitaines. Leurs pupilles brillaient sous les capulets de fer, et les cicatrices en travers des joues s'avivaient.
 Quand on lui apprit que la belle, pieuse et sage, vivait dans le castel de son père, il fut piqué au vif par la curiosité et peut-être bien par un naissant amour. Introduit dans la chambre des dames, il trouva Berthe filant. Le ménestrel n'avait pas menti. Elle était blonde comme le pollen des fleurs et un simple cercle d'argent maintenait sur ses tempes un léger voile dont la retombée atténuait l'éclat de ses cheveux. Rodolphe la regardait ainsi auréolée et les paupières mi-closes. Quand lentement, très lentement, elle les leva, Rodolphe tomba sur les genoux comme un Sarrazin, le front au sol, les bras écartés. De son côté, la belle ne resta pas insensible à la noble prestance du jeune chevalier. Et ce furent deux semaines de tendres rendez-vous, de délicieuses promenades, jusqu'au jour du départ. Puissant et riche seigneur, Rodolphe obtint d'épouser Berthe à son retour de Terre Sainte.
Quand on lui apprit que la belle, pieuse et sage, vivait dans le castel de son père, il fut piqué au vif par la curiosité et peut-être bien par un naissant amour. Introduit dans la chambre des dames, il trouva Berthe filant. Le ménestrel n'avait pas menti. Elle était blonde comme le pollen des fleurs et un simple cercle d'argent maintenait sur ses tempes un léger voile dont la retombée atténuait l'éclat de ses cheveux. Rodolphe la regardait ainsi auréolée et les paupières mi-closes. Quand lentement, très lentement, elle les leva, Rodolphe tomba sur les genoux comme un Sarrazin, le front au sol, les bras écartés. De son côté, la belle ne resta pas insensible à la noble prestance du jeune chevalier. Et ce furent deux semaines de tendres rendez-vous, de délicieuses promenades, jusqu'au jour du départ. Puissant et riche seigneur, Rodolphe obtint d'épouser Berthe à son retour de Terre Sainte.
En ce mois d'octobre de l'année 1177, entouré d'une centaine de chevaliers, de nombreux Templiers et Hospitaliers avec leur Grand Maître, Rodolphe rejoignit l'armée que les hauts barons du roi de Jérusalem étaient en train de lever.
A leur grand étonnement, ils trouvèrent la Cour de Jérusalem occupée par des mariages mondains. Quant au sultan Saladin, il s'était replié sur l'Egypte avec le gros de ses forces. Le roi de Jérusalem envoya alors le duc d'Alsace et la majeure partie de ses chevaliers dont Rodolphe, guerroyer dans le nord. Ce faisant, il avait considérablement affaibli son armée.
En apprenant la nouvelle, Saladin, véritable foudre de guerre et grand capitaine, voyant tout le sud de la Palestine privé de défense, comprit rapidement l'avantage qu'il pouvait tirer d'une invasion. Avec ses troupes d'élite il fonça en direction du royaume franc, empruntant la piste qui longe la mer à travers les déserts.
Pour le jeune roi de Jérusalem, la situation était dramatique. Le gros de son armée continuait sa progression vers le nord, seule l'arrière-garde avait pu être contactée, et son chef de guerre, le Connétable Onfroy, retenu malade dans la citadelle de Toron, n'était pas en mesure de conduire le reste de ses troupes. Rassemblant alors en toute hâte les chevaliers qui lui restaient, le roi se précipita dans la cité fortifiée d'Ascalon que Saladin n'allait pas tarder à atteindre.
Les cavaliers du sultan n'étaient plus très loin car la fumée des incendies qu'ils allumaient pour détruire les récoltes des belles plaines du littoral se rapprochait des murs d'Ascalon. Saladin avait négligé d'attaquer le château de Darom et Gaza où le Grand Maître du Temple et quelques Templiers qui n'avaient pas suivi le duc d'Alsace s'étaient retirés. Pour le sultan ces postes étaient sans importance, ils tomberaient comme des fruits mûrs lorsqu'il aurait vaincu l'armée chrétienne qui s'était réfugiée derrière les murs d'Ascalon.
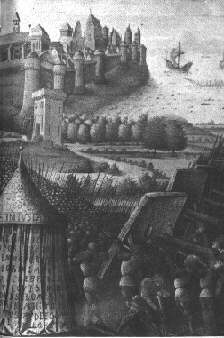
Ascalon
Lorsque les premiers cavaliers ennemis furent visibles depuis les murs, le roi Baudouin fit ranger ses chevaliers sur les collines proches de la cité. Leur nombre était dérisoire face aux soixante mille hommes de Saladin. Le jeune roi de dix-sept ans déplorait l'absence de son vieux Connétable, mais les cinq hauts barons qui l'entouraient le conseillèrent judicieusement. Il fallait coûte que coûte éviter toute action offensive en attendant les renforts de l'arrière-garde.
L'attitude résolue des chevaliers rangés en bon ordre troubla Saladin qui ne put se décider à lancer ses escadrons sur les Francs. Les deux armées restèrent toute la journée face à face sans bouger. A la tombée du jour, redoutant quelque ruse, le roi préféra se retirer sagement derrière les murailles. Saladin qui ne comprenait toujours pas l'attitude de Baudouin, interpréta sa retraite comme un abandon, un renoncement à combattre et à s'opposer à sa marche sur Jérusalem. Il ne jugea pas utile d'assiéger Ascalon et dès l'aube, il lança ses troupes en avant.
Malheureusement, l'arrière-garde que le roi Baudouin avait rappelée, arrivait à ce moment-là et se trouva enveloppée par les hordes musulmanes.
Pour ses premières armes, Rodolphe qui faisait partie de l'arrière-garde, allait connaître la guerre sous un de ses aspects les plus pénibles. Le choc tant appréhendé fut rude. Cependant il était courageux. Il se battit avec acharnement mais en raison de la détermination des troupes du sultan et de l'accablante chaleur faisant presque autant de victimes que la fureur de la mêlée, les Francs furent massacrés ou faits prisonniers.

Rodolphe se trouva parmi ces derniers. Les mains attachées dans le dos, ils marchaient en longues files douloureuses et tragiques, traînés par des chameaux à la suite de l'armée. Leurs visages blêmes, leurs yeux agrandis par de profonds cernes, leurs pauvres corps meurtris dont la chair brûlait et la peau saignait, racontaient leur profonde lassitude.
Rodolphe brûlait d'étranges ardeurs, celles de l'amour et celles de la haine. Il revoyait le charmant visage aux paupières baissées de Berthe, son sourire ingénu, ses belles mains délicates et douces serrant des gerbes d'iris ou ouvrant son escarcelle pour les lépreux et les mendiants appuyés sur leurs béquilles sous le porche de la cathédrale. Au fil des jours il concevait une haine grandissante pour les musulmans. Il savait qu'il allait être envoyé à Damas car il était assez fortuné pour payer une forte rançon à moins que Saladin, dans un geste de grande générosité qui lui était coutumier quand l'envie le prenait de savourer un triomphe, ne le fasse massacrer avec tous les autres prisonniers. Il ne pleurait pas sur la misère qui se révélait à ses yeux car il n'aurait pas assez de larmes. Les Infidèles ne laissaient derrière eux que ruine et désolation. Ils coupaient les arbres, arrachaient les vignes, brûlaient les maisons et les récoltes, emmenaient en esclavage un peuple entier.
En apprenant le massacre de l'arrière-garde, les quatre-vingts et derniers Templiers de Gaza rejoignirent les effectifs du roi de Jérusalem à Ascalon. Pour faire face à soixante mille musulmans, Baudouin disposait à présent de trois cent soixante-quinze chevaliers !
Par une poterne cachée, pour ne point éveiller l'attention des sentinelles laissées devant Ascalon par Saladin, les chevaliers quittèrent la cité pour prendre la route de la forteresse de Montgisard sise à l'est sur une éminence au milieu d'une plaine. Saladin se trouvait non loin de là, un peu plus au sud. Quand on lui apprit l'arrivée des chrétiens, sa surprise fut grande. Il n'eut que le temps de rappeler ses troupes éparpillées dans la campagne que déjà les silhouettes des chevaliers se découpaient sur la butte de Montgisard.
Serrant les rangs, les chevaliers avançaient résolus, prêts à mourir pour sauver le pays meurtri. Le danger encouru était grand. Aussi l'évêque de Bethléem avait-il pris rang parmi eux, avec un morceau de la Vraie Croix plaquée d'or et sertie de pierreries. A la vue des Turcs, tous les chevaliers étendirent la main sur la Croix et jurèrent de mourir plutôt que de fuir.
Les chevaliers engagèrent la bataille à la grande joie des musulmans qui pensaient déjà avoir raison d'eux.
Ce fut une vague énorme se précipitant avec fracas, qui vint dans une trombe de houle se ruer sur un barrage humain, comme un éboulement de rochers sur une montagne, et s'y arrêter. Les chevaux peinaient dans la tourmente sous le poids des armures qui alourdissaient leur croupe. La mêlée d'abord terrible devint horrible. Les grandes épées flamboyantes des chrétiens semblaient les protéger de leur cercle immense. Elles tombaient et remontaient brisant les casques des Infidèles qui roulaient comme des cruches vides sous les sabots des chevaux. Blessés ou morts, les flots des assaillants étaient toujours repoussés. Les chevaliers s'acharnaient, se ruaient, paraient, frappaient. Recevaient-ils une blessure ? Que leur importait. Ils luttaient. Leur chair mieux que l'acier trempé ne craignait pas les morsures du fer. Les assauts se succédaient mais les chevaliers ne perdaient pas courage. Peu à peu, ils réussirent à faire quelques percées dans les rangs adverses. Bientôt de larges éclaircies se firent autour d'eux puis, soudain, ce fut la dislocation des rangs et la fuite.
Les trois cent soixante-quinze chevaliers n'en croyaient pas leurs yeux. Ils venaient de mettre en déroute une armée de plusieurs milliers de Turcs qui s'empressaient de jeter tout ce qui entravait leur course éperdue : armes, casques, cottes de mailles, gantelets de fer, bottes.
Rodolphe qui avait perçu les grands cris de la charge des chevaliers et le heurt des armes donna libre cours à son violent désir de liberté et de vengeance. Il réussit à se libérer de ses liens et profita de la confusion générale pour délivrer les autres prisonniers. Ils se défirent rapidement de leurs gardes et, ramassant des armes jetées par les fuyards s'en prirent à la garde personnelle du sultan, les mameluks, reconnaissables à leur tunique jaune or.
Rodolphe ressemblait à un archange. Il travaillait tête nue, bras nus, broyant les Infidèles. Et la terre buvait le sang des mameluks mieux que Bacchus le vin. Quant à Saladin, il ne dut ce jour-là, d'avoir la vie sauve qu'à la rapidité de son coursier et au sacrifice de ses mameluks.

Les chevaliers poursuivirent les Infidèles durant trois jours. Le coup final leur fut porté par les Bédouins du désert. Ils avaient observé la scène de loin et attendaient que les chrétiens se replient sur Ascalon pour se jeter, tels des vautours, sur les derniers fuyards, les massacrer et les dépouiller.
La famine avait succédé à la déroute de Saladin. Le monde musulman était suffisamment ébranlé pour qu'une paix relative et provisoire put s'installer, car le terrible sultan n'avait nullement renoncé à expulser les chrétiens de Terre Sainte.
Rodolphe quitta donc le littoral chrétien et s'embarqua sur le premier navire appareillé.
Et maintenant, s'orientant d'après les dernières lueurs du couchant, il poussait sa monture en avant, le long des rives du Rhin, vers le burg de sa bien-aimée.

Alors à travers la haute salle blasonnée du château toute flambante et fumante de cierges, Berthe et Rodolphe allèrent l'un vers l'autre, et s'enlacèrent haletant silencieusement, le coeur houleux et la gorge serrée par la joie.
La veille du mariage, sur les bords du Rhin, Rodolphe et Berthe sont assis. Les cheveux d'or pâle de Berthe tombent en nappe le long de ses joues, son voile bleuâtre ceint sur ses tempes d'une cordelette de soie a glissé le long de ses épaules d'une exquise blancheur, et ses mains tremblent dans celles de Rodolphe. Aux douces paroles du jeune guerrier, le visage de Berthe resplendit tout rose de bonheur ; roses deviennent ses épaules et parfois sa robe d'argent qui se confond avec les rives du fleuve et les fleurs des rosiers sauvages.
Les eaux du Rhin elles-mêmes s'enflamment dans l'incendie du couchant. Berthe, en souvenir de cette journée demande à Rodolphe de lui cueillir quelques-unes de ces petites fleurs bleues qui croissent sur la berge. Mais les semelles lisses des brodequins du chevalier glissent sur l'herbe humide et il tombe dans les eaux qui se referment sur lui. Dans un dernier effort presque surhumain, Rodolphe remonte à la surface et sa main déjà crispée par le froid de la mort lance à Berthe le bouquet de fleurs bleues en prononçant cette dernière, ardente et triste supplication d'amour : Vergiss-Mein-Nicht. Puis, entraîné par le courant, il disparaît à tout jamais.
Berthe se retira dans un cloître et lorsqu'elle s'éteignit doucement entre les mains des nonnes, elle tenait serrées sur la poitrine les fleurs bleues qu'elle avait reçues et qui ont conservé le nom de Vergiss-Mein-Nicht : ne m'oublie pas.


Puis, gagnant Spire par étapes, il avait fait halte au château du comte de Frankenstein où il trouvait bon accueil et bon gîte. Dans la haute salle aux voûtes blasonnées où le souper était servi, on se passait à la ronde autour de la table le hanap plein de vin. Un ménestrel s'aidant d'une mandoline, célébrait la beauté incomparable par sa longue chevelure souple et blonde de la fille du seigneur.
Berthe était son nom. Et le gratteur de cordes faisait délirer tous ces soldats et capitaines. Leurs pupilles brillaient sous les capulets de fer, et les cicatrices en travers des joues s'avivaient.

En ce mois d'octobre de l'année 1177, entouré d'une centaine de chevaliers, de nombreux Templiers et Hospitaliers avec leur Grand Maître, Rodolphe rejoignit l'armée que les hauts barons du roi de Jérusalem étaient en train de lever.
A leur grand étonnement, ils trouvèrent la Cour de Jérusalem occupée par des mariages mondains. Quant au sultan Saladin, il s'était replié sur l'Egypte avec le gros de ses forces. Le roi de Jérusalem envoya alors le duc d'Alsace et la majeure partie de ses chevaliers dont Rodolphe, guerroyer dans le nord. Ce faisant, il avait considérablement affaibli son armée.
En apprenant la nouvelle, Saladin, véritable foudre de guerre et grand capitaine, voyant tout le sud de la Palestine privé de défense, comprit rapidement l'avantage qu'il pouvait tirer d'une invasion. Avec ses troupes d'élite il fonça en direction du royaume franc, empruntant la piste qui longe la mer à travers les déserts.
Pour le jeune roi de Jérusalem, la situation était dramatique. Le gros de son armée continuait sa progression vers le nord, seule l'arrière-garde avait pu être contactée, et son chef de guerre, le Connétable Onfroy, retenu malade dans la citadelle de Toron, n'était pas en mesure de conduire le reste de ses troupes. Rassemblant alors en toute hâte les chevaliers qui lui restaient, le roi se précipita dans la cité fortifiée d'Ascalon que Saladin n'allait pas tarder à atteindre.
Les cavaliers du sultan n'étaient plus très loin car la fumée des incendies qu'ils allumaient pour détruire les récoltes des belles plaines du littoral se rapprochait des murs d'Ascalon. Saladin avait négligé d'attaquer le château de Darom et Gaza où le Grand Maître du Temple et quelques Templiers qui n'avaient pas suivi le duc d'Alsace s'étaient retirés. Pour le sultan ces postes étaient sans importance, ils tomberaient comme des fruits mûrs lorsqu'il aurait vaincu l'armée chrétienne qui s'était réfugiée derrière les murs d'Ascalon.
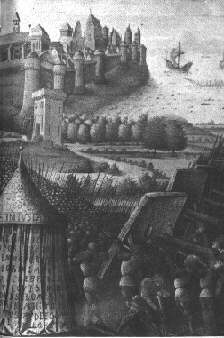
Ascalon
Lorsque les premiers cavaliers ennemis furent visibles depuis les murs, le roi Baudouin fit ranger ses chevaliers sur les collines proches de la cité. Leur nombre était dérisoire face aux soixante mille hommes de Saladin. Le jeune roi de dix-sept ans déplorait l'absence de son vieux Connétable, mais les cinq hauts barons qui l'entouraient le conseillèrent judicieusement. Il fallait coûte que coûte éviter toute action offensive en attendant les renforts de l'arrière-garde.
L'attitude résolue des chevaliers rangés en bon ordre troubla Saladin qui ne put se décider à lancer ses escadrons sur les Francs. Les deux armées restèrent toute la journée face à face sans bouger. A la tombée du jour, redoutant quelque ruse, le roi préféra se retirer sagement derrière les murailles. Saladin qui ne comprenait toujours pas l'attitude de Baudouin, interpréta sa retraite comme un abandon, un renoncement à combattre et à s'opposer à sa marche sur Jérusalem. Il ne jugea pas utile d'assiéger Ascalon et dès l'aube, il lança ses troupes en avant.
Malheureusement, l'arrière-garde que le roi Baudouin avait rappelée, arrivait à ce moment-là et se trouva enveloppée par les hordes musulmanes.
Pour ses premières armes, Rodolphe qui faisait partie de l'arrière-garde, allait connaître la guerre sous un de ses aspects les plus pénibles. Le choc tant appréhendé fut rude. Cependant il était courageux. Il se battit avec acharnement mais en raison de la détermination des troupes du sultan et de l'accablante chaleur faisant presque autant de victimes que la fureur de la mêlée, les Francs furent massacrés ou faits prisonniers.

Rodolphe se trouva parmi ces derniers. Les mains attachées dans le dos, ils marchaient en longues files douloureuses et tragiques, traînés par des chameaux à la suite de l'armée. Leurs visages blêmes, leurs yeux agrandis par de profonds cernes, leurs pauvres corps meurtris dont la chair brûlait et la peau saignait, racontaient leur profonde lassitude.
Rodolphe brûlait d'étranges ardeurs, celles de l'amour et celles de la haine. Il revoyait le charmant visage aux paupières baissées de Berthe, son sourire ingénu, ses belles mains délicates et douces serrant des gerbes d'iris ou ouvrant son escarcelle pour les lépreux et les mendiants appuyés sur leurs béquilles sous le porche de la cathédrale. Au fil des jours il concevait une haine grandissante pour les musulmans. Il savait qu'il allait être envoyé à Damas car il était assez fortuné pour payer une forte rançon à moins que Saladin, dans un geste de grande générosité qui lui était coutumier quand l'envie le prenait de savourer un triomphe, ne le fasse massacrer avec tous les autres prisonniers. Il ne pleurait pas sur la misère qui se révélait à ses yeux car il n'aurait pas assez de larmes. Les Infidèles ne laissaient derrière eux que ruine et désolation. Ils coupaient les arbres, arrachaient les vignes, brûlaient les maisons et les récoltes, emmenaient en esclavage un peuple entier.
En apprenant le massacre de l'arrière-garde, les quatre-vingts et derniers Templiers de Gaza rejoignirent les effectifs du roi de Jérusalem à Ascalon. Pour faire face à soixante mille musulmans, Baudouin disposait à présent de trois cent soixante-quinze chevaliers !
Par une poterne cachée, pour ne point éveiller l'attention des sentinelles laissées devant Ascalon par Saladin, les chevaliers quittèrent la cité pour prendre la route de la forteresse de Montgisard sise à l'est sur une éminence au milieu d'une plaine. Saladin se trouvait non loin de là, un peu plus au sud. Quand on lui apprit l'arrivée des chrétiens, sa surprise fut grande. Il n'eut que le temps de rappeler ses troupes éparpillées dans la campagne que déjà les silhouettes des chevaliers se découpaient sur la butte de Montgisard.
Serrant les rangs, les chevaliers avançaient résolus, prêts à mourir pour sauver le pays meurtri. Le danger encouru était grand. Aussi l'évêque de Bethléem avait-il pris rang parmi eux, avec un morceau de la Vraie Croix plaquée d'or et sertie de pierreries. A la vue des Turcs, tous les chevaliers étendirent la main sur la Croix et jurèrent de mourir plutôt que de fuir.
Les chevaliers engagèrent la bataille à la grande joie des musulmans qui pensaient déjà avoir raison d'eux.
Ce fut une vague énorme se précipitant avec fracas, qui vint dans une trombe de houle se ruer sur un barrage humain, comme un éboulement de rochers sur une montagne, et s'y arrêter. Les chevaux peinaient dans la tourmente sous le poids des armures qui alourdissaient leur croupe. La mêlée d'abord terrible devint horrible. Les grandes épées flamboyantes des chrétiens semblaient les protéger de leur cercle immense. Elles tombaient et remontaient brisant les casques des Infidèles qui roulaient comme des cruches vides sous les sabots des chevaux. Blessés ou morts, les flots des assaillants étaient toujours repoussés. Les chevaliers s'acharnaient, se ruaient, paraient, frappaient. Recevaient-ils une blessure ? Que leur importait. Ils luttaient. Leur chair mieux que l'acier trempé ne craignait pas les morsures du fer. Les assauts se succédaient mais les chevaliers ne perdaient pas courage. Peu à peu, ils réussirent à faire quelques percées dans les rangs adverses. Bientôt de larges éclaircies se firent autour d'eux puis, soudain, ce fut la dislocation des rangs et la fuite.
Les trois cent soixante-quinze chevaliers n'en croyaient pas leurs yeux. Ils venaient de mettre en déroute une armée de plusieurs milliers de Turcs qui s'empressaient de jeter tout ce qui entravait leur course éperdue : armes, casques, cottes de mailles, gantelets de fer, bottes.
Rodolphe qui avait perçu les grands cris de la charge des chevaliers et le heurt des armes donna libre cours à son violent désir de liberté et de vengeance. Il réussit à se libérer de ses liens et profita de la confusion générale pour délivrer les autres prisonniers. Ils se défirent rapidement de leurs gardes et, ramassant des armes jetées par les fuyards s'en prirent à la garde personnelle du sultan, les mameluks, reconnaissables à leur tunique jaune or.
Rodolphe ressemblait à un archange. Il travaillait tête nue, bras nus, broyant les Infidèles. Et la terre buvait le sang des mameluks mieux que Bacchus le vin. Quant à Saladin, il ne dut ce jour-là, d'avoir la vie sauve qu'à la rapidité de son coursier et au sacrifice de ses mameluks.

Les chevaliers poursuivirent les Infidèles durant trois jours. Le coup final leur fut porté par les Bédouins du désert. Ils avaient observé la scène de loin et attendaient que les chrétiens se replient sur Ascalon pour se jeter, tels des vautours, sur les derniers fuyards, les massacrer et les dépouiller.
La famine avait succédé à la déroute de Saladin. Le monde musulman était suffisamment ébranlé pour qu'une paix relative et provisoire put s'installer, car le terrible sultan n'avait nullement renoncé à expulser les chrétiens de Terre Sainte.
Rodolphe quitta donc le littoral chrétien et s'embarqua sur le premier navire appareillé.
Et maintenant, s'orientant d'après les dernières lueurs du couchant, il poussait sa monture en avant, le long des rives du Rhin, vers le burg de sa bien-aimée.

Alors à travers la haute salle blasonnée du château toute flambante et fumante de cierges, Berthe et Rodolphe allèrent l'un vers l'autre, et s'enlacèrent haletant silencieusement, le coeur houleux et la gorge serrée par la joie.
La veille du mariage, sur les bords du Rhin, Rodolphe et Berthe sont assis. Les cheveux d'or pâle de Berthe tombent en nappe le long de ses joues, son voile bleuâtre ceint sur ses tempes d'une cordelette de soie a glissé le long de ses épaules d'une exquise blancheur, et ses mains tremblent dans celles de Rodolphe. Aux douces paroles du jeune guerrier, le visage de Berthe resplendit tout rose de bonheur ; roses deviennent ses épaules et parfois sa robe d'argent qui se confond avec les rives du fleuve et les fleurs des rosiers sauvages.
Les eaux du Rhin elles-mêmes s'enflamment dans l'incendie du couchant. Berthe, en souvenir de cette journée demande à Rodolphe de lui cueillir quelques-unes de ces petites fleurs bleues qui croissent sur la berge. Mais les semelles lisses des brodequins du chevalier glissent sur l'herbe humide et il tombe dans les eaux qui se referment sur lui. Dans un dernier effort presque surhumain, Rodolphe remonte à la surface et sa main déjà crispée par le froid de la mort lance à Berthe le bouquet de fleurs bleues en prononçant cette dernière, ardente et triste supplication d'amour : Vergiss-Mein-Nicht. Puis, entraîné par le courant, il disparaît à tout jamais.
Berthe se retira dans un cloître et lorsqu'elle s'éteignit doucement entre les mains des nonnes, elle tenait serrées sur la poitrine les fleurs bleues qu'elle avait reçues et qui ont conservé le nom de Vergiss-Mein-Nicht : ne m'oublie pas.

Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 17:51, édité 4 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Le Liseron des Haies
Le Liseron des Haies
En des temps reculés où l’on ne connaissait pas l’électricité ni même les lampes à pétrole, on aimait, le soir venu, s’asseoir au coin du feu. La magie évocatoire de la flamme charmait alors l’aïeule de la famille. Repoussant devant ses yeux fatigués les frontières de la nuit, elle se transportait soudain à une époque où l’on croyait encore aux sorcières, magiciens, fées et elfes. C’est à ce moment-là, que délaissant son rouet, elle se mettait à narrer des contes. Une de ces histoires, je m’en vais te la conter, chère enfant.
Cela se passait dans un pays nordique où vivait un bon vieux roi. Son palais, un vieux château, était la chose la plus curieuse qu’il fût donné de voir. Surplombant les vagues, ses donjons et ses remparts crénelés et taillés dans le roc blanc de la falaise, se dessinaient en dents de scie sur l’horizon. On eût dit une gerbe d’écume pétrifiée. C’était une merveille. Le peuple l’appelait le Château de la Lune. Par les nuits froides de grand vent, les flots montant sous le clair de lune brillaient d’un éclat glauque et jetaient dans l’obscurité leurs feux verdâtres sur les tours qui prenaient alors une transparence verte. L’un des donjons était occupé par la fille du vieux roi, la princesse Fleur de Lune, aux yeux d’aigue-marine et aux cheveux d’or pâle. Quant au roi et à la reine, ils habitaient, entourés de leurs six fils, la Tour des Chevaliers.
Aimable et douce, Fleur de Lune était choyée par tous les membres de la famille royale. Heureuse de son sort, elle ne songeait nullement à quitter le château familial pour celui d’un époux. Mais le vieux roi son père, pressentant qu’il allait bientôt rejoindre ses ancêtres, nourrissait l’espoir de voir sa fille épouser un royal fiancé.
 Un jour, le roi organisa pour ses fils et sa Cour, une grande chasse au faucon à laquelle prit part la princesse Fleur de Lune. Ce matin-là, les genêts embaumaient l’air et le vent courant sur les vagues et les bruyères portait à la princesse, avec la senteur des fleurs, les songes enchantés nés de de leurs âmes. Le regard rêveur, Fleur de Lune laissa sa jument blanche aller à l’aventure. Le cheval s’écarta du sentier et s’éloigna de la troupe des chasseurs pour s’enfoncer dans une profonde forêt de sapins et de bouleaux. Elle se retrouva ainsi au bord d’un petit étang sur lequel une brume bleuâtre pesait comme un couvercle. Un vol noir de corbeaux s’éleva de la forêt rouillée par l’automne et plana au-dessus de l’étang. Secouée par les sinistres croassements, écœurés par une odeur fade de feuilles mortes et de fleurs fanées qui montait du sol, la princesse fut prise d’un malaise. Comme elle se penchait en avant pour lancer au galop son cheval, un brusque soubresaut la désarçonna presque. S’étant inclinée pour voir l’obstacle, elle aperçut à quelques pas devant elle, deux petites perles qui avaient l’éclat du cristal. Fleur de Lune descendit de cheval pour examiner de plus près ces deux points lumineux. C’étaient deux yeux ! Et ces yeux appartenaient à une grenouille verte qui, se dressant hors de l’herbe, se courba révérencieusement devant la princesse. Effrayée, Fleur de Lune recula et cria :
Un jour, le roi organisa pour ses fils et sa Cour, une grande chasse au faucon à laquelle prit part la princesse Fleur de Lune. Ce matin-là, les genêts embaumaient l’air et le vent courant sur les vagues et les bruyères portait à la princesse, avec la senteur des fleurs, les songes enchantés nés de de leurs âmes. Le regard rêveur, Fleur de Lune laissa sa jument blanche aller à l’aventure. Le cheval s’écarta du sentier et s’éloigna de la troupe des chasseurs pour s’enfoncer dans une profonde forêt de sapins et de bouleaux. Elle se retrouva ainsi au bord d’un petit étang sur lequel une brume bleuâtre pesait comme un couvercle. Un vol noir de corbeaux s’éleva de la forêt rouillée par l’automne et plana au-dessus de l’étang. Secouée par les sinistres croassements, écœurés par une odeur fade de feuilles mortes et de fleurs fanées qui montait du sol, la princesse fut prise d’un malaise. Comme elle se penchait en avant pour lancer au galop son cheval, un brusque soubresaut la désarçonna presque. S’étant inclinée pour voir l’obstacle, elle aperçut à quelques pas devant elle, deux petites perles qui avaient l’éclat du cristal. Fleur de Lune descendit de cheval pour examiner de plus près ces deux points lumineux. C’étaient deux yeux ! Et ces yeux appartenaient à une grenouille verte qui, se dressant hors de l’herbe, se courba révérencieusement devant la princesse. Effrayée, Fleur de Lune recula et cria :
- Qui es-tu ? Tu me fais peur ! et elle se hâta de remonter en selle.
Muette de stupéfaction, la grenouille ne répondit pas. La princesse lui paraissait très grande, géante même, et le petit animal hésitait devant cette haute silhouette se profilant sur le ciel crépusculaire. Au lieu de poursuivre son chemin, la princesse curieuse comme toutes les jeunes filles, demanda :
- Bel étranger, dis-moi qui tu es.
Alors la grenouille qui n’était autre que le Prince Vert, entrouvrit les lèvres pour parler. Mais, avant qu’il ait pu prononcer une seule parole, le roi, parti à la recherche de Fleur de Lune, apparut sur son cheval et, arrivé auprès d’elle sauta à terre. La grenouille fit une profonde révérence et disparut dans une haie.
- Père ! cria la princesse, je viens d’apercevoir celui qui sera bientôt mon époux.
- Comment ! demanda le roi étonné, tu veux épouser, et encore prochainement, quelqu’un que tu n’as fait qu’entrevoir ?
- Mais papa, je le connais depuis longtemps, car il m’est souvent apparu dans mes rêves ! Ses yeux ont l’éclat et la profondeur de l’émeraude. Il a la souplesse d’un jeune bouleau et son habit vert brille comme notre château sous la lune.
- Voici une fort belle impression qu’il ne produit pas sur moi, remarqua le roi. Je trouve, au contraire, qu’il a des yeux globuleux et un visage plutôt singulier ! Viens, mon enfant, il commence à faire nuit, nous devons retourner au château.

Les chasseurs ne tardèrent guère à rejoindre le roi et sa fille. Tandis que la troupe s’orientait d’après les dernières lueurs du couchant et piquait droit à travers la forêt ténébreuse vers le château, Fleur de Lune scrutait le sol, croyant voir briller des yeux dans tous les taillis.
A leur retour les chasseurs trouvèrent le château entièrement illuminé, Fleur de Lune jeta un regard interrogateur à sa mère qui s’approcha d’elle pour lui confier :
- Ton père et moi te réservons une belle surprise ! Un grand festin va être donné ce soir au château.
- En l’honneur de qui, chère maman ? demanda la princesse.
- Ecoute ma chérie, le Prince de l’Avenir a demandé ta main. Ton père a accédé à sa demande et l’a invité ce soir pour fêter vos fiançailles officielles.
- Je ne veux pas de ce prince, mère !
- Et pourquoi ?
- Mais parce que j’en aime un autre !
- Je ne te comprends pas ma fille, dit la reine déconcertée. Ton père m’a raconté que tu aurais fait une rencontre singulière cet après-midi à la chasse. Ce n’est tout de même pas de celui-ci que tu veux parler ?
- Si mère. Il est peut-être moins riche et moins célèbre que le Prince de l’Avenir, mais il a des yeux si doux… et je veux, je dois le revoir !
Haussant légèrement les épaules, la reine répondit :
- L’amour rend aveugle, pense à ce vieux dicton ma fille.
Puis, sur un ton un peu aigre elle ajouta :
- Après tout, ton bien-aimé n’est qu’une détestable petite grenouille verte !
Ces paroles mirent Fleur de Lune de mauvaise humeur. Elle cria en tapant du pied :
- Ne parle pas ainsi de lui, mère ! Autrement, je quitte immédiatement le château pour errer à la recherche de l’élu de mon cœur !
- Tu tiens là un langage bien impertinent, ma fille ! Tu n’as pas échangé deux mots avec cet étranger que déjà tu veux quitter le château familial pour suivre un inconnu au regard étrange. Tout cela est insensé ! Trêve de discussion ! Vas t’habiller et prépare-toi à recevoir le Prince de l’Avenir !
La princesse se mit alors à pleurer amèrement, conjurant sa mère de lui accorder un sursis ; elle ne pouvait recevoir le Prince de l’Avenir, car elle devait d’abord se retirer dans ses appartements pour réfléchir, et effacer de son visage les traces de ses pleurs.
La bonne reine accepta.
- Si j’explique tout au Prince, dit-elle, et s’il est compréhensif, peut-être te pardonnera-t-il.

La princesse se retira dans son donjon et laissa ses servantes la déshabiller. Mais elle ne se coucha pas ; elle s’approcha d’une fenêtre et s’accouda sur le rebord garni d’un coussin de soie. Ses regards se portèrent au loin sur le parc du château. Se redressant soudain, elle ouvrit de grands yeux. Là-bas, au pied même du donjon seigneurial, debout dans le brouillard, et drapé dans son habit émeraude, se tenait le Prince Vert.
- Cher Prince ! s’écria-t-elle toute joyeuse, présente-toi demain au château où mon père te recevra comme jamais aucun de ses hôtes ne l’a été.
Malheureusement, à cette époque déjà, vivaient de méchantes fées qui dansaient la nuit, dans l’air embaumé du lourd parfum des genêts de la lande ou dans la brume argentée des lumineuses journées d’automne. Or, l’une de ces vilaines fées qui ne souhaitaient point le bonheur d’aucun enfant, se glissa dans les appartements de la princesse. Elle y vit une vieille servante toute ridée qu’elle avait rencontrée quelques fois, ramassant des fleurs à l’orée du bois à l’heure du crépuscule. C’était une âme simple et sa bouche édentée marmottait une éternelle prière.
La mauvaise fée souffla alors toute sa malice dans l’esprit de la pauvre vieille. Et ce fut ainsi que ses doigts rencontrèrent la hanche d’un vase garni de fleurs.
- M’est avis qu’il faut changer cette eau, murmura la vieille, et elle s’en alla jeter l’eau du vase par une fenêtre à l’instant même où, au pied du donjon, le Prince Vert répondant à l’invitation de Fleur de Lune, ouvrait la bouche pour lui chanter une chanson. Le pauvre prince reçut l’eau croupie en plein visage et même dans la bouche. Suffocant, furieux, il disparut. Cachée derrière une tapisserie, la méchante fée ricana.
Les mois passèrent. Le Prince Vert ne se montrait plus, et Fleur de Lune se désolait. Ses parents cherchaient par tous les moyens à la distraire. Les bals et les fêtes se succédaient. Des conteurs, des troubadours et des jongleurs furent appelés de partout pour amuser Fleur de Lune, mais en vain, elle ne retrouvait pas son sourire. Désespéré, le roi son père lui demanda :
- Dis-moi ma fille, qu’est-ce qui te manque ? Que dois-je faire pour que tu retrouves la joie de vivre ?
Séchant une larme du revers de la main, la princesse lui répondit :
- Père, fais rechercher le Prince Vert, celui qui un jour croisa mon chemin dans la forêt.
- Le Prince Vert ? Qui est-ce ? Il ne figure pas sur la liste des nobles !
- Et pourtant père, il doit être un grand seigneur, car il a de si beaux yeux verts… Pour sûr qu’il est de sang royal !
- Les apparences sont souvent trompeuses ma fille !
- Elles ne le sont pas toujours, père ! Je t’en supplie, fais fouiller toutes les forêts du royaume pour le retrouver !
- En vérité, dit le roi en soupirant, tu le prends pour un prince et il règne sur ton cœur !

Le monarque fit convoquer tous ses chevaliers et rassembler tous ses hommes d’armes. Ils furent dix mille à répondre à son appel. La grande salle du château était comble. Les hommes de guerre se pressaient jusqu’aux marches du trône et, au-dehors, par-delà les douves, les chevaliers gantés de fer et masqués du cimier d’argent de leur casque surmonté de plumes ou d’un aigle aux ailes éployées, attendaient sur leurs chevaux si serrés les uns contre les autres, qu’un enfant n’aurait pu se faufiler entre eux.
Sur l’ordre du roi, et sous le haut commandement de son connétable, cette formidable armée, déployant ses étendards de soie bordés d’or et d’argent, se mit en marche à la recherche du Prince Vert. De la plus haute tour du château, Fleur de Lune suivait du regard les hommes d’armes. Ils avaient ornés les poignées de leurs glaives et les fers de leurs lances, de rubans à ses couleurs.
Les recherches étaient rendues incroyablement difficiles par la couleur même des habits du prince qui se confondait avec l’herbe et le feuillage. Seul, l’éclat de ses yeux d’émeraude pouvait le trahir.
Ce fut en vain que les soldats fouillèrent la lande et la forêt. Et, après plusieurs semaines de battues infructueuses, le connétable du roi réunit ses hommes et leur dit :
- Je sais que cela fera de la peine à notre princesse, mais nous devons à présent rebrousser chemin.
Un jeune chevalier ayant retiré son casque d’argent mat auréolé d’or descendit de cheval. Prenant l’animal par la bride, il le mena étancher sa soif au bord d’un étang. Tandis que le cheval se désaltérait, le jeune homme silencieux et pensif fredonnait une vielle chanson. Et voilà que dans la pénombre crépusculaire, parmi les touffes d’herbe grasse de la rive, il vit briller une paire d’yeux. Le jeune chevalier qui était un garçon malin et rusé, s’écria :
- Seigneur, suis-moi au château. La princesse Fleur de Lune se meurt d’amour pour toi ; elle t’attend avec impatience.
A ces mots, la grenouille bondit et s’échappa. Le chevalier courut aussitôt chez le connétable pour lui relater sa rencontre. Les soldats reçurent l’ordre d’encercler l’étang ; ce qu’ils firent rapidement, et le Prince Vert fut capturé. Il ne dit mot, mais lançait de temps à autre un regard chargé de reproches au jeune chevalier responsable de sa capture. Les hommes d’armes du roi se bousculèrent pour voir l’étrange personnage. Les rires fusèrent et les moqueries.
- Je me demande, dit en riant un chevalier, quel plaisir pourrait bien éprouver notre belle princesse, avec un lourdaud pareil !
- Il n’a pas l’air d’avoir l’habitude de parler aux dames, renchérit un autre.
- Tu veux dire, rétorqua un autre encore, qu’il ne serait même pas capable de lui faire une déclaration d’amour !
Un vieux chevalier aux cheveux tout blancs s’approcha alors du Prince Vert et lui dit avec un sourire narquois :
- Bien sûr, selon un vieux dicton : la parole est d’argent et le silence est d’or, mais malgré tout, tu ferais bien de délier ta langue si tu veux garder le cœur de la princesse !
Les chevaliers rirent aux larmes. Le Prince Vert quant à lui restait impassible et silencieux. La longue marche du retour commença. L’armée s’étira sur de lieues et des lieues. Le Prince Vert tenta à maintes reprises de s’échapper, mais sans succès. Il fut repris à chaque fois. Il arriva ainsi au Château de la Lune où, fortement encadré d’archers, on lui fit franchir la galerie des ancêtres pour le mener à la salle du trône. Aux murs de cristal de la galerie, pendaient les portraits de la longue lignée des seigneurs et grandes dames de la famille royale ; et il semblait au prince, que ces personnages aux regards froids, se penchaient pour mieux le dévisager.
Les portes de la salle du trône s’ouvrirent. Toute la Cour était là, entourant le roi vêtu d’un lourd manteau coupé dans une étoffe cramoisie et bordé d’hermine. Une couronne d’or bosselée de pierres multicolores, brillait à son front. Les nobles dames du royaume, gainées dans des robes de brocart, les flancs ceints dans de larges ceintures tissées de perles, se tenaient en face des chevaliers portant cuirasses d’argent, et des grands seigneurs aux longs manteaux, lourds de broderies et de pierreries tombant sur leurs pieds chaussés de brodequins.
Au milieu de cette brillante assemblée, le Prince Vert avait honte de ses modestes habits. Mais, lorsqu’il aperçut Fleur de Lune drapée dans une souple soierie blanche, avec ses cheveux d’un blond pâle et ses yeux où miroitait le reflet trouble des vagues, il s’agenouilla instinctivement, buvant du regard la charmante jeune fille.
Le roi s’attendait à ce que l’étranger prit la parole, mais le singulier personnage resta muet. Un sourire narquois retroussa alors les lèvres des nobles dames et chevaliers.
- Qu’on me laisse seule avec lui, supplia Fleur de Lune se tournant vers ses parents.
Le couple royal se leva pour quitter la salle, et invita la Cour à en faire autant.
Le Prince Vert et la princesse se tenaient face à face.
- Noble ami, lui dit Fleur de Lune, pourquoi ne dis-tu rien si tu m’aimes ? Ton mutisme devient énervant !
Pas de réponse ! Et pourtant la princesse avait le sentiment que ce singulier jeune homme était aussi épris d’elle, qu’elle l’était de lui.
- Te sens-tu humilié parce qu’on t’a fait prisonnier ? Tu ne veux pas rester avec moi ?... Eh bien, je vais te rendre ta liberté.
- La princesse agita une clochette d’argent et les portes de la salle s’ouvrirent aussitôt largement. Le Prince Vert se jeta alors à ses pieds et baisa l’ourlet de sa robe finement ramagée d’or. Lorsque le roi et la reine virent cela, ils se hâtèrent joyeux vers le prince et la princesse, suivis de leurs courtisans mordus de curiosité.
- Sois le bienvenu mon gendre, dit le roi au Prince Vert. Ainsi, vais-je pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Mais dis-moi, de quelle noble famille descends-tu ?
Le Prince Vert roula de gros yeux et resta silencieux. Alors tous secouèrent la tête et la reine dit :
- Fleur de Lune ferait mieux de s’abstenir de prendre ce muet pour époux.
Mais la princesse ne voulut rien entendre et resta sourde à tous les avis et conseils.
Et c’est ainsi que les noces furent célébrées. A l’heure du banquet, personne n’avait encore entendu la voix du Prince Vert. Seuls ses grands yeux globuleux exprimaient sa joie et son bonheur. A l’issue du repas, le jeune marié invita par gestes sa jeune épouse à monter à ses côtés dans un riche carrosse qui les attendait au bas de l’escalier du château. Garni de coussins roses, le carrosse était d’argent et avait la forme d’un coquillage. Il était tiré par huit chevaux à la robe blanche, aux harnais garnis de grelots d’argent. Le jeune couple prit place au milieu des coussins et les huit étalons blancs s’élancèrent aussitôt à travers la brume d’une clarté surnaturelle qui baignait la lande et la forêt. La neige se mit à floconner doucement. Les parents de la princesse s’étonnèrent de tout cela et s’inquiétèrent pour leur fille. Mais Fleur de Lune faisait confiance à celui qu’elle aimait, ne lui posa aucune question, et se blottit heureuse contre lui.

La nuit était tombée ; la forêt que traversait l’attelage parut de plus en plus sombre mais, bientôt le ciel s’éclaira et Fleur de Lune put enfin apercevoir au sommet d’une colline escarpée, le château féerique de son époux.
Lorsque le carrosse s’immobilisa devant la porte du palais, le Prince Vert, prévenant, aida son épouse à descendre de la voiture, la mena par la main dans un jardin et il entrouvrit enfin les lèvres :
- Reine de mon cœur, lui dit-il, avant de franchir le seuil de ta nouvelle demeure, tu dois me demander qui je suis.
Avec un léger sourire Fleur de Lune répondit :
- Tu es mon prince, tout le reste n’a aucune importance.
- Comment sais-tu que je suis un prince ? Peut-être ne suis pas celui que tu crois ?
- Si. Tu es le prince de mon cœur. Je t’ai souvent vu dans mes rêves de jeune fille.
Ces paroles réjouirent le Prince Vert : non seulement Fleur de Lune l’aimait, mais elle lui faisait confiance.
Ils vécurent heureux un certain temps. Mais, peu à peu, le prince se rendit compte que sa jeune femme devenait chaque soir de pleine lune plus belle, et tout en elle prenait alors des reflets irisés de neige et de nacre. Ces nuits-là, quand la lune baignait dans un halo pâle et lustré, elle aimait venir appuyer son dos au montant d’une fenêtre haute. Debout dans un faisceau de lumière laiteuse, sa pesante chevelure d’un blond pâle avait les imperceptibles nuances de la neige effleurée par les rayons de l’astre de la nuit. Son visage et ses bras nus blêmissaient, et sur sa peau d’une transparence nacrée se dessinait le réseau bleu de ses veines.
Fleur de Lune, quant à elle, dut se rendre à l’évidence : son époux devenait plus laid chaque soir quand le soleil disparaissait derrière l’horizon. Et une nuit, il partit.
L’automne était déjà fort avancé. Un vent très violent soufflait en tempête autour du château. D’une voix émue, le prince dit à sa jeune femme :
- Adieu, je dois m’en aller !
- Comment ? demanda Fleur de Lune interdite, tu veux m’abandonner dans cette affreuse nuit ?
Au même instant, une rafale plus forte que les autres, ouvrit avec fracas les volets de la chambre. Le prince revêtu de son habit vert sauta par la fenêtre dans le vide. Saisie d’effroi, la princesse bondit hors de son lit et fit aussitôt seller sa jument blanche. Suivie de ses deux plus fidèles écuyers, elle gagna la forêt toute proche. Elle entendit soudain une voix chevroter :
- Saute grenouillette, saute !
Et une voix plaintive répondre :
- Oh mère, oh !
- Saute plus haut mon fils, encore plus haut, toujours plus haut !
- Plus haut, je n’arriverai pas !

La princesse tendit l’oreille et prudemment avança dans la direction d’où étaient venus les éclats de voix. Elle pensa défaillir en reconnaissant son mari, mais l’épouvante la ranima : une hideuse sorcière était la mère du prince !
C’était une grande femme bossue à la face verdâtre couronnée de mèches grises où luisaient des prunelles vitreuses et jaunes. Ses mains étaient palmées, et à la place des ongles elle portait des griffes.
Figée de terreur, Fleur de Lune et ses deux écuyers ne bougèrent pas. La tempête s’était calmée, et la lune, dans le ciel pluvieux, apparut cernée de son halo et éclaira la petite clairière où se tenait la sorcière. Ils la virent alors se tapir au sol, et l’entendirent ordonner à son fils :
- Saute grenouillette, saute par-dessus mon dos !
A la voir ramper avec son ventre lourd, et se redresser petit à petit avec des cris qui ressemblaient davantage à des coassements, on eut dit un colossal crapaud.
- Saute plus haut mon fils, encore plus haut, toujours plus haut ! grondait la sorcière.
Et le prince de gémir :
- Je ne peux pas, mère !
La vieille le fixa et grommela :
- Quel maladroit garçon tu es ! Tu dois sauter plus haut, sinon je vais changer ta délicieuse petite femme en libellule, et tes amies les grenouilles la mangeront !
Le pauvre prince fit de son mieux, mais la sorcière surélevait chaque fois sa bosse au moment où son fils sautait par-dessus, de façon à ce qu’il se tapait les jambes.
- Aïe ! Aïe ! hurlait la vieille, ne sais-tu pas qu’à chaque endroit heurté par tes détestables jambes de grenouille, il me pousse des verrues ? Mes oreilles en sont déjà entièrement recouvertes, et si tu continues, je deviendrai sourde et ne pourrai plus entendre le cri de la chouette qui me réveille ponctuellement chaque soir à minuit !
- Sur ce, elle plongea sa baguette magique dans un seau rempli de goudron bouillant et en frappa rageusement le pauvre prince qui, de douleur, fit un bon en l’air.
Courroucée, Fleur de Lune lança son cheval sur la sorcière en criant :
- Veux-tu immédiatement laisser mon prince tranquille !
La sorcière ricana, et sans savoir comment, Fleur de Lune s’éveilla avec un grand cri dans son lit. La sorcière lui avait joué ce tour pour la punir de son impertinence. Encore terrassée par l’affreux cauchemar, Fleur de Lune sauta échevelée de son lit et courut à la fenêtre. Entre les buissons de rosiers du parc, la sorcière continuait d’exercer son fils.
Maintenant, chevrota la vieille, je vais te changer en perroquet, alors tu pourras voler très haut. Un…, deux…, trois…, perroquet tu es ! A présent, pose-toi sur la branche d’un arbre et répète : « Laura ». En récompense, tu recevras des graines de tournesol !
Le prince métamorphosé en grand perroquet vert, exécuta l’ordre de sa mère.
- Bien ! dit-elle. Quand le jour commencera à poindre, tu pourras rejoindre ta princesse.
- Pourquoi me tourmentes-tu ainsi, maman ? demanda le prince.
- Cela, tu ne peux le comprendre, tu es encore trop jeune, répondit la vieille. Toi et ta femme m’en serez reconnaissants un jour. Mais, si vous tentez de déjouer mes plans, vous ne partagerez jamais le bonheur que je vous réserve. A présent je dois regagner ma grotte, car le soleil va se lever.
Saisissant une branche sèche qui gisait sur le gazon, la sorcière l’enfourcha et s’envola dans les airs. Le prince vola de l’arbre sur le gazon où il agita trois fois ses ailes, redevint grenouille, se secoua encore trois fois et reprit sa forme de jeune homme. Quand il regagna sa chambre, Fleur de Lune sommeillait.
Nuit après nuit, le même sortilège se répéta. La sorcière transformait son fils en perroquet, en hibou, puis en cigogne et finalement en aigle.
- Mon fils, dit un jour la vielle, ta femme nous a observés chaque nuit. Retourne à présent dans ton palais et dis-lui que je ne suis pas cette méchante sorcière pour qui elle me prend, mais une bonne et aimante mère. A présent, en tant qu’aigle tu peux voler jusqu’au ciel, et sur tes puissantes ailes porter ta petite femme jusque sur la lune, afin qu’elle puisse rendre visite à ses parents.
- Comment s’étonna le prince, mais ses parents habitent le Château de la Lune au bord de la mer !
- Ce fut seulement leur résidence terrestre ! le temps que tu ramènes dans ton palais leur fille, ils retournèrent dans leur véritable patrie.
Lorsque le prince arriva chez lui, il raconta à sa femme tout ce que sa mère lui avait dit. Alors la princesse sourit et dit :
- Oui, mes parents ont regagné leur royaume. Mais chaque nuit de pleine lune ils prenaient de mes nouvelles. Le scintillement lunaire m’attirait et, en m’effleurant donnait à ma chair la blancheur et l'éclat chatoyant d’une perle, comme un nénuphar qui flotte sur le lac du parc. Des messagers de mon père me remirent une baguette magique. Avec elle, j’aurais pu m’élever et voler vers la lune, mais comme je t’aime et te fais confiance, j’ai refusé de partir sans toi.
- Et maintenant, allons –nous en ! acheva la princesse.
Le prince prit alors la forme d’un puissant aigle, fit monter sa femme sur ses ailes et prit son essor. Ils s’envolèrent pour la lune où ils furent reçus en grande pompe par les parents de Fleur de Lune.

Quiconque quitte cette terre n’a plus envie d’y revenir. En souvenir de leur séjour sur notre planète, le prince jeta son revêtement de grenouille, et Fleur de Lune sa baguette magique qui, en se brisant en mille morceaux, fit jaillir de la terre une gerbe de fleurs blanches, des liserons, fleurs de la lune. Et depuis lors, dans l’air tiède des soirées roses et mauves du printemps, on peut voir sous la clarté lunaire parmi les prés et les talus tout fleuris de liserons, des chœurs de grenouilles donner des concerts pour honorer la mémoire de Fleur de Lune.

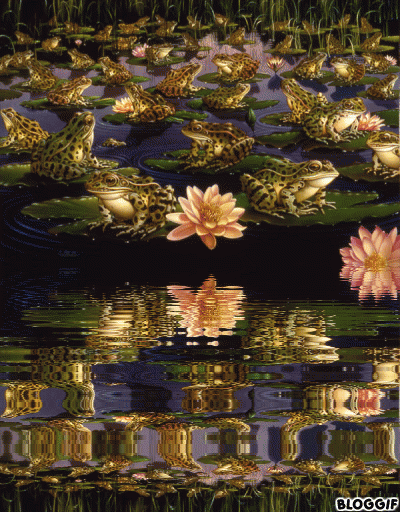
Cela se passait dans un pays nordique où vivait un bon vieux roi. Son palais, un vieux château, était la chose la plus curieuse qu’il fût donné de voir. Surplombant les vagues, ses donjons et ses remparts crénelés et taillés dans le roc blanc de la falaise, se dessinaient en dents de scie sur l’horizon. On eût dit une gerbe d’écume pétrifiée. C’était une merveille. Le peuple l’appelait le Château de la Lune. Par les nuits froides de grand vent, les flots montant sous le clair de lune brillaient d’un éclat glauque et jetaient dans l’obscurité leurs feux verdâtres sur les tours qui prenaient alors une transparence verte. L’un des donjons était occupé par la fille du vieux roi, la princesse Fleur de Lune, aux yeux d’aigue-marine et aux cheveux d’or pâle. Quant au roi et à la reine, ils habitaient, entourés de leurs six fils, la Tour des Chevaliers.
Aimable et douce, Fleur de Lune était choyée par tous les membres de la famille royale. Heureuse de son sort, elle ne songeait nullement à quitter le château familial pour celui d’un époux. Mais le vieux roi son père, pressentant qu’il allait bientôt rejoindre ses ancêtres, nourrissait l’espoir de voir sa fille épouser un royal fiancé.

- Qui es-tu ? Tu me fais peur ! et elle se hâta de remonter en selle.
Muette de stupéfaction, la grenouille ne répondit pas. La princesse lui paraissait très grande, géante même, et le petit animal hésitait devant cette haute silhouette se profilant sur le ciel crépusculaire. Au lieu de poursuivre son chemin, la princesse curieuse comme toutes les jeunes filles, demanda :
- Bel étranger, dis-moi qui tu es.
Alors la grenouille qui n’était autre que le Prince Vert, entrouvrit les lèvres pour parler. Mais, avant qu’il ait pu prononcer une seule parole, le roi, parti à la recherche de Fleur de Lune, apparut sur son cheval et, arrivé auprès d’elle sauta à terre. La grenouille fit une profonde révérence et disparut dans une haie.
- Père ! cria la princesse, je viens d’apercevoir celui qui sera bientôt mon époux.
- Comment ! demanda le roi étonné, tu veux épouser, et encore prochainement, quelqu’un que tu n’as fait qu’entrevoir ?
- Mais papa, je le connais depuis longtemps, car il m’est souvent apparu dans mes rêves ! Ses yeux ont l’éclat et la profondeur de l’émeraude. Il a la souplesse d’un jeune bouleau et son habit vert brille comme notre château sous la lune.
- Voici une fort belle impression qu’il ne produit pas sur moi, remarqua le roi. Je trouve, au contraire, qu’il a des yeux globuleux et un visage plutôt singulier ! Viens, mon enfant, il commence à faire nuit, nous devons retourner au château.

Les chasseurs ne tardèrent guère à rejoindre le roi et sa fille. Tandis que la troupe s’orientait d’après les dernières lueurs du couchant et piquait droit à travers la forêt ténébreuse vers le château, Fleur de Lune scrutait le sol, croyant voir briller des yeux dans tous les taillis.
A leur retour les chasseurs trouvèrent le château entièrement illuminé, Fleur de Lune jeta un regard interrogateur à sa mère qui s’approcha d’elle pour lui confier :
- Ton père et moi te réservons une belle surprise ! Un grand festin va être donné ce soir au château.
- En l’honneur de qui, chère maman ? demanda la princesse.
- Ecoute ma chérie, le Prince de l’Avenir a demandé ta main. Ton père a accédé à sa demande et l’a invité ce soir pour fêter vos fiançailles officielles.
- Je ne veux pas de ce prince, mère !
- Et pourquoi ?
- Mais parce que j’en aime un autre !
- Je ne te comprends pas ma fille, dit la reine déconcertée. Ton père m’a raconté que tu aurais fait une rencontre singulière cet après-midi à la chasse. Ce n’est tout de même pas de celui-ci que tu veux parler ?
- Si mère. Il est peut-être moins riche et moins célèbre que le Prince de l’Avenir, mais il a des yeux si doux… et je veux, je dois le revoir !
Haussant légèrement les épaules, la reine répondit :
- L’amour rend aveugle, pense à ce vieux dicton ma fille.
Puis, sur un ton un peu aigre elle ajouta :
- Après tout, ton bien-aimé n’est qu’une détestable petite grenouille verte !
Ces paroles mirent Fleur de Lune de mauvaise humeur. Elle cria en tapant du pied :
- Ne parle pas ainsi de lui, mère ! Autrement, je quitte immédiatement le château pour errer à la recherche de l’élu de mon cœur !
- Tu tiens là un langage bien impertinent, ma fille ! Tu n’as pas échangé deux mots avec cet étranger que déjà tu veux quitter le château familial pour suivre un inconnu au regard étrange. Tout cela est insensé ! Trêve de discussion ! Vas t’habiller et prépare-toi à recevoir le Prince de l’Avenir !
La princesse se mit alors à pleurer amèrement, conjurant sa mère de lui accorder un sursis ; elle ne pouvait recevoir le Prince de l’Avenir, car elle devait d’abord se retirer dans ses appartements pour réfléchir, et effacer de son visage les traces de ses pleurs.
La bonne reine accepta.
- Si j’explique tout au Prince, dit-elle, et s’il est compréhensif, peut-être te pardonnera-t-il.

La princesse se retira dans son donjon et laissa ses servantes la déshabiller. Mais elle ne se coucha pas ; elle s’approcha d’une fenêtre et s’accouda sur le rebord garni d’un coussin de soie. Ses regards se portèrent au loin sur le parc du château. Se redressant soudain, elle ouvrit de grands yeux. Là-bas, au pied même du donjon seigneurial, debout dans le brouillard, et drapé dans son habit émeraude, se tenait le Prince Vert.
- Cher Prince ! s’écria-t-elle toute joyeuse, présente-toi demain au château où mon père te recevra comme jamais aucun de ses hôtes ne l’a été.
Malheureusement, à cette époque déjà, vivaient de méchantes fées qui dansaient la nuit, dans l’air embaumé du lourd parfum des genêts de la lande ou dans la brume argentée des lumineuses journées d’automne. Or, l’une de ces vilaines fées qui ne souhaitaient point le bonheur d’aucun enfant, se glissa dans les appartements de la princesse. Elle y vit une vieille servante toute ridée qu’elle avait rencontrée quelques fois, ramassant des fleurs à l’orée du bois à l’heure du crépuscule. C’était une âme simple et sa bouche édentée marmottait une éternelle prière.
La mauvaise fée souffla alors toute sa malice dans l’esprit de la pauvre vieille. Et ce fut ainsi que ses doigts rencontrèrent la hanche d’un vase garni de fleurs.
- M’est avis qu’il faut changer cette eau, murmura la vieille, et elle s’en alla jeter l’eau du vase par une fenêtre à l’instant même où, au pied du donjon, le Prince Vert répondant à l’invitation de Fleur de Lune, ouvrait la bouche pour lui chanter une chanson. Le pauvre prince reçut l’eau croupie en plein visage et même dans la bouche. Suffocant, furieux, il disparut. Cachée derrière une tapisserie, la méchante fée ricana.
Les mois passèrent. Le Prince Vert ne se montrait plus, et Fleur de Lune se désolait. Ses parents cherchaient par tous les moyens à la distraire. Les bals et les fêtes se succédaient. Des conteurs, des troubadours et des jongleurs furent appelés de partout pour amuser Fleur de Lune, mais en vain, elle ne retrouvait pas son sourire. Désespéré, le roi son père lui demanda :
- Dis-moi ma fille, qu’est-ce qui te manque ? Que dois-je faire pour que tu retrouves la joie de vivre ?
Séchant une larme du revers de la main, la princesse lui répondit :
- Père, fais rechercher le Prince Vert, celui qui un jour croisa mon chemin dans la forêt.
- Le Prince Vert ? Qui est-ce ? Il ne figure pas sur la liste des nobles !
- Et pourtant père, il doit être un grand seigneur, car il a de si beaux yeux verts… Pour sûr qu’il est de sang royal !
- Les apparences sont souvent trompeuses ma fille !
- Elles ne le sont pas toujours, père ! Je t’en supplie, fais fouiller toutes les forêts du royaume pour le retrouver !
- En vérité, dit le roi en soupirant, tu le prends pour un prince et il règne sur ton cœur !

Le monarque fit convoquer tous ses chevaliers et rassembler tous ses hommes d’armes. Ils furent dix mille à répondre à son appel. La grande salle du château était comble. Les hommes de guerre se pressaient jusqu’aux marches du trône et, au-dehors, par-delà les douves, les chevaliers gantés de fer et masqués du cimier d’argent de leur casque surmonté de plumes ou d’un aigle aux ailes éployées, attendaient sur leurs chevaux si serrés les uns contre les autres, qu’un enfant n’aurait pu se faufiler entre eux.
Sur l’ordre du roi, et sous le haut commandement de son connétable, cette formidable armée, déployant ses étendards de soie bordés d’or et d’argent, se mit en marche à la recherche du Prince Vert. De la plus haute tour du château, Fleur de Lune suivait du regard les hommes d’armes. Ils avaient ornés les poignées de leurs glaives et les fers de leurs lances, de rubans à ses couleurs.
Les recherches étaient rendues incroyablement difficiles par la couleur même des habits du prince qui se confondait avec l’herbe et le feuillage. Seul, l’éclat de ses yeux d’émeraude pouvait le trahir.
Ce fut en vain que les soldats fouillèrent la lande et la forêt. Et, après plusieurs semaines de battues infructueuses, le connétable du roi réunit ses hommes et leur dit :
- Je sais que cela fera de la peine à notre princesse, mais nous devons à présent rebrousser chemin.
Un jeune chevalier ayant retiré son casque d’argent mat auréolé d’or descendit de cheval. Prenant l’animal par la bride, il le mena étancher sa soif au bord d’un étang. Tandis que le cheval se désaltérait, le jeune homme silencieux et pensif fredonnait une vielle chanson. Et voilà que dans la pénombre crépusculaire, parmi les touffes d’herbe grasse de la rive, il vit briller une paire d’yeux. Le jeune chevalier qui était un garçon malin et rusé, s’écria :
- Seigneur, suis-moi au château. La princesse Fleur de Lune se meurt d’amour pour toi ; elle t’attend avec impatience.
A ces mots, la grenouille bondit et s’échappa. Le chevalier courut aussitôt chez le connétable pour lui relater sa rencontre. Les soldats reçurent l’ordre d’encercler l’étang ; ce qu’ils firent rapidement, et le Prince Vert fut capturé. Il ne dit mot, mais lançait de temps à autre un regard chargé de reproches au jeune chevalier responsable de sa capture. Les hommes d’armes du roi se bousculèrent pour voir l’étrange personnage. Les rires fusèrent et les moqueries.
- Je me demande, dit en riant un chevalier, quel plaisir pourrait bien éprouver notre belle princesse, avec un lourdaud pareil !
- Il n’a pas l’air d’avoir l’habitude de parler aux dames, renchérit un autre.
- Tu veux dire, rétorqua un autre encore, qu’il ne serait même pas capable de lui faire une déclaration d’amour !
Un vieux chevalier aux cheveux tout blancs s’approcha alors du Prince Vert et lui dit avec un sourire narquois :
- Bien sûr, selon un vieux dicton : la parole est d’argent et le silence est d’or, mais malgré tout, tu ferais bien de délier ta langue si tu veux garder le cœur de la princesse !
Les chevaliers rirent aux larmes. Le Prince Vert quant à lui restait impassible et silencieux. La longue marche du retour commença. L’armée s’étira sur de lieues et des lieues. Le Prince Vert tenta à maintes reprises de s’échapper, mais sans succès. Il fut repris à chaque fois. Il arriva ainsi au Château de la Lune où, fortement encadré d’archers, on lui fit franchir la galerie des ancêtres pour le mener à la salle du trône. Aux murs de cristal de la galerie, pendaient les portraits de la longue lignée des seigneurs et grandes dames de la famille royale ; et il semblait au prince, que ces personnages aux regards froids, se penchaient pour mieux le dévisager.
Les portes de la salle du trône s’ouvrirent. Toute la Cour était là, entourant le roi vêtu d’un lourd manteau coupé dans une étoffe cramoisie et bordé d’hermine. Une couronne d’or bosselée de pierres multicolores, brillait à son front. Les nobles dames du royaume, gainées dans des robes de brocart, les flancs ceints dans de larges ceintures tissées de perles, se tenaient en face des chevaliers portant cuirasses d’argent, et des grands seigneurs aux longs manteaux, lourds de broderies et de pierreries tombant sur leurs pieds chaussés de brodequins.
Au milieu de cette brillante assemblée, le Prince Vert avait honte de ses modestes habits. Mais, lorsqu’il aperçut Fleur de Lune drapée dans une souple soierie blanche, avec ses cheveux d’un blond pâle et ses yeux où miroitait le reflet trouble des vagues, il s’agenouilla instinctivement, buvant du regard la charmante jeune fille.
Le roi s’attendait à ce que l’étranger prit la parole, mais le singulier personnage resta muet. Un sourire narquois retroussa alors les lèvres des nobles dames et chevaliers.
- Qu’on me laisse seule avec lui, supplia Fleur de Lune se tournant vers ses parents.
Le couple royal se leva pour quitter la salle, et invita la Cour à en faire autant.
Le Prince Vert et la princesse se tenaient face à face.
- Noble ami, lui dit Fleur de Lune, pourquoi ne dis-tu rien si tu m’aimes ? Ton mutisme devient énervant !
Pas de réponse ! Et pourtant la princesse avait le sentiment que ce singulier jeune homme était aussi épris d’elle, qu’elle l’était de lui.
- Te sens-tu humilié parce qu’on t’a fait prisonnier ? Tu ne veux pas rester avec moi ?... Eh bien, je vais te rendre ta liberté.
- La princesse agita une clochette d’argent et les portes de la salle s’ouvrirent aussitôt largement. Le Prince Vert se jeta alors à ses pieds et baisa l’ourlet de sa robe finement ramagée d’or. Lorsque le roi et la reine virent cela, ils se hâtèrent joyeux vers le prince et la princesse, suivis de leurs courtisans mordus de curiosité.
- Sois le bienvenu mon gendre, dit le roi au Prince Vert. Ainsi, vais-je pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Mais dis-moi, de quelle noble famille descends-tu ?
Le Prince Vert roula de gros yeux et resta silencieux. Alors tous secouèrent la tête et la reine dit :
- Fleur de Lune ferait mieux de s’abstenir de prendre ce muet pour époux.
Mais la princesse ne voulut rien entendre et resta sourde à tous les avis et conseils.
Et c’est ainsi que les noces furent célébrées. A l’heure du banquet, personne n’avait encore entendu la voix du Prince Vert. Seuls ses grands yeux globuleux exprimaient sa joie et son bonheur. A l’issue du repas, le jeune marié invita par gestes sa jeune épouse à monter à ses côtés dans un riche carrosse qui les attendait au bas de l’escalier du château. Garni de coussins roses, le carrosse était d’argent et avait la forme d’un coquillage. Il était tiré par huit chevaux à la robe blanche, aux harnais garnis de grelots d’argent. Le jeune couple prit place au milieu des coussins et les huit étalons blancs s’élancèrent aussitôt à travers la brume d’une clarté surnaturelle qui baignait la lande et la forêt. La neige se mit à floconner doucement. Les parents de la princesse s’étonnèrent de tout cela et s’inquiétèrent pour leur fille. Mais Fleur de Lune faisait confiance à celui qu’elle aimait, ne lui posa aucune question, et se blottit heureuse contre lui.

La nuit était tombée ; la forêt que traversait l’attelage parut de plus en plus sombre mais, bientôt le ciel s’éclaira et Fleur de Lune put enfin apercevoir au sommet d’une colline escarpée, le château féerique de son époux.
Lorsque le carrosse s’immobilisa devant la porte du palais, le Prince Vert, prévenant, aida son épouse à descendre de la voiture, la mena par la main dans un jardin et il entrouvrit enfin les lèvres :
- Reine de mon cœur, lui dit-il, avant de franchir le seuil de ta nouvelle demeure, tu dois me demander qui je suis.
Avec un léger sourire Fleur de Lune répondit :
- Tu es mon prince, tout le reste n’a aucune importance.
- Comment sais-tu que je suis un prince ? Peut-être ne suis pas celui que tu crois ?
- Si. Tu es le prince de mon cœur. Je t’ai souvent vu dans mes rêves de jeune fille.
Ces paroles réjouirent le Prince Vert : non seulement Fleur de Lune l’aimait, mais elle lui faisait confiance.
Ils vécurent heureux un certain temps. Mais, peu à peu, le prince se rendit compte que sa jeune femme devenait chaque soir de pleine lune plus belle, et tout en elle prenait alors des reflets irisés de neige et de nacre. Ces nuits-là, quand la lune baignait dans un halo pâle et lustré, elle aimait venir appuyer son dos au montant d’une fenêtre haute. Debout dans un faisceau de lumière laiteuse, sa pesante chevelure d’un blond pâle avait les imperceptibles nuances de la neige effleurée par les rayons de l’astre de la nuit. Son visage et ses bras nus blêmissaient, et sur sa peau d’une transparence nacrée se dessinait le réseau bleu de ses veines.
Fleur de Lune, quant à elle, dut se rendre à l’évidence : son époux devenait plus laid chaque soir quand le soleil disparaissait derrière l’horizon. Et une nuit, il partit.
L’automne était déjà fort avancé. Un vent très violent soufflait en tempête autour du château. D’une voix émue, le prince dit à sa jeune femme :
- Adieu, je dois m’en aller !
- Comment ? demanda Fleur de Lune interdite, tu veux m’abandonner dans cette affreuse nuit ?
Au même instant, une rafale plus forte que les autres, ouvrit avec fracas les volets de la chambre. Le prince revêtu de son habit vert sauta par la fenêtre dans le vide. Saisie d’effroi, la princesse bondit hors de son lit et fit aussitôt seller sa jument blanche. Suivie de ses deux plus fidèles écuyers, elle gagna la forêt toute proche. Elle entendit soudain une voix chevroter :
- Saute grenouillette, saute !
Et une voix plaintive répondre :
- Oh mère, oh !
- Saute plus haut mon fils, encore plus haut, toujours plus haut !
- Plus haut, je n’arriverai pas !

C’était une grande femme bossue à la face verdâtre couronnée de mèches grises où luisaient des prunelles vitreuses et jaunes. Ses mains étaient palmées, et à la place des ongles elle portait des griffes.
Figée de terreur, Fleur de Lune et ses deux écuyers ne bougèrent pas. La tempête s’était calmée, et la lune, dans le ciel pluvieux, apparut cernée de son halo et éclaira la petite clairière où se tenait la sorcière. Ils la virent alors se tapir au sol, et l’entendirent ordonner à son fils :
- Saute grenouillette, saute par-dessus mon dos !
A la voir ramper avec son ventre lourd, et se redresser petit à petit avec des cris qui ressemblaient davantage à des coassements, on eut dit un colossal crapaud.
- Saute plus haut mon fils, encore plus haut, toujours plus haut ! grondait la sorcière.
Et le prince de gémir :
- Je ne peux pas, mère !
La vieille le fixa et grommela :
- Quel maladroit garçon tu es ! Tu dois sauter plus haut, sinon je vais changer ta délicieuse petite femme en libellule, et tes amies les grenouilles la mangeront !
Le pauvre prince fit de son mieux, mais la sorcière surélevait chaque fois sa bosse au moment où son fils sautait par-dessus, de façon à ce qu’il se tapait les jambes.
- Aïe ! Aïe ! hurlait la vieille, ne sais-tu pas qu’à chaque endroit heurté par tes détestables jambes de grenouille, il me pousse des verrues ? Mes oreilles en sont déjà entièrement recouvertes, et si tu continues, je deviendrai sourde et ne pourrai plus entendre le cri de la chouette qui me réveille ponctuellement chaque soir à minuit !
- Sur ce, elle plongea sa baguette magique dans un seau rempli de goudron bouillant et en frappa rageusement le pauvre prince qui, de douleur, fit un bon en l’air.
Courroucée, Fleur de Lune lança son cheval sur la sorcière en criant :
- Veux-tu immédiatement laisser mon prince tranquille !
La sorcière ricana, et sans savoir comment, Fleur de Lune s’éveilla avec un grand cri dans son lit. La sorcière lui avait joué ce tour pour la punir de son impertinence. Encore terrassée par l’affreux cauchemar, Fleur de Lune sauta échevelée de son lit et courut à la fenêtre. Entre les buissons de rosiers du parc, la sorcière continuait d’exercer son fils.
Maintenant, chevrota la vieille, je vais te changer en perroquet, alors tu pourras voler très haut. Un…, deux…, trois…, perroquet tu es ! A présent, pose-toi sur la branche d’un arbre et répète : « Laura ». En récompense, tu recevras des graines de tournesol !
Le prince métamorphosé en grand perroquet vert, exécuta l’ordre de sa mère.
- Bien ! dit-elle. Quand le jour commencera à poindre, tu pourras rejoindre ta princesse.
- Pourquoi me tourmentes-tu ainsi, maman ? demanda le prince.
- Cela, tu ne peux le comprendre, tu es encore trop jeune, répondit la vieille. Toi et ta femme m’en serez reconnaissants un jour. Mais, si vous tentez de déjouer mes plans, vous ne partagerez jamais le bonheur que je vous réserve. A présent je dois regagner ma grotte, car le soleil va se lever.
Saisissant une branche sèche qui gisait sur le gazon, la sorcière l’enfourcha et s’envola dans les airs. Le prince vola de l’arbre sur le gazon où il agita trois fois ses ailes, redevint grenouille, se secoua encore trois fois et reprit sa forme de jeune homme. Quand il regagna sa chambre, Fleur de Lune sommeillait.
Nuit après nuit, le même sortilège se répéta. La sorcière transformait son fils en perroquet, en hibou, puis en cigogne et finalement en aigle.
- Mon fils, dit un jour la vielle, ta femme nous a observés chaque nuit. Retourne à présent dans ton palais et dis-lui que je ne suis pas cette méchante sorcière pour qui elle me prend, mais une bonne et aimante mère. A présent, en tant qu’aigle tu peux voler jusqu’au ciel, et sur tes puissantes ailes porter ta petite femme jusque sur la lune, afin qu’elle puisse rendre visite à ses parents.
- Comment s’étonna le prince, mais ses parents habitent le Château de la Lune au bord de la mer !
- Ce fut seulement leur résidence terrestre ! le temps que tu ramènes dans ton palais leur fille, ils retournèrent dans leur véritable patrie.
Lorsque le prince arriva chez lui, il raconta à sa femme tout ce que sa mère lui avait dit. Alors la princesse sourit et dit :
- Oui, mes parents ont regagné leur royaume. Mais chaque nuit de pleine lune ils prenaient de mes nouvelles. Le scintillement lunaire m’attirait et, en m’effleurant donnait à ma chair la blancheur et l'éclat chatoyant d’une perle, comme un nénuphar qui flotte sur le lac du parc. Des messagers de mon père me remirent une baguette magique. Avec elle, j’aurais pu m’élever et voler vers la lune, mais comme je t’aime et te fais confiance, j’ai refusé de partir sans toi.
- Et maintenant, allons –nous en ! acheva la princesse.
Le prince prit alors la forme d’un puissant aigle, fit monter sa femme sur ses ailes et prit son essor. Ils s’envolèrent pour la lune où ils furent reçus en grande pompe par les parents de Fleur de Lune.

Quiconque quitte cette terre n’a plus envie d’y revenir. En souvenir de leur séjour sur notre planète, le prince jeta son revêtement de grenouille, et Fleur de Lune sa baguette magique qui, en se brisant en mille morceaux, fit jaillir de la terre une gerbe de fleurs blanches, des liserons, fleurs de la lune. Et depuis lors, dans l’air tiède des soirées roses et mauves du printemps, on peut voir sous la clarté lunaire parmi les prés et les talus tout fleuris de liserons, des chœurs de grenouilles donner des concerts pour honorer la mémoire de Fleur de Lune.
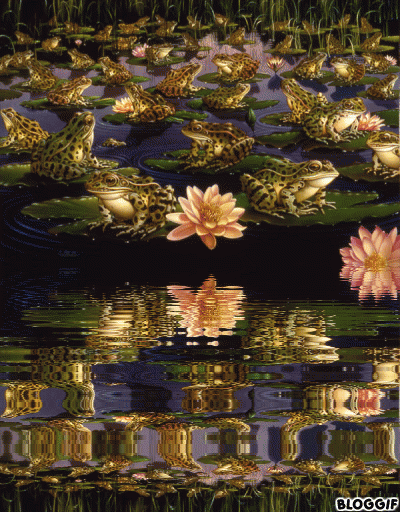
Dernière édition par Freya le Sam 16 Nov 2013 - 15:40, édité 12 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Le Houx Vert
Le Houx Vert
Pour ses baies rouges il fut dédié à Thor, fils d’Odin et de Jord, dieu du tonnerre et de la pluie bienfaisante. Les Scandinaves lui offraient l’appui d’un mur de leur maison pour la protéger de la foudre. Jeune, ses feuilles oblongues, luisantes et hérissées d’épines, sont coriaces et fortement piquantes. Avec le temps elles deviennent tendres et plates, et perdent leurs épines.
 Un jeune arbuste se lamentait :
Un jeune arbuste se lamentait :
- Pourquoi faut-il que mes feuilles soient aussi coriaces et piquantes ?
- Tu comprendras plus tard, lui répondit en riant son père. Avant que tes feuilles soient aussi tendres et plates que celles de tes frères et sœurs, il te faudra passer par bien des épreuves.
- Ce que tu me dis là, ne m’explique toujours pas pourquoi je suis aussi piquant, poursuivit l’impertinent arbuste. Je trouve ces épines non seulement gênantes mais encore superflues. Je préfèrerais, et de loin, avoir des feuilles aussi tendres que celles des membres les plus âgés de notre famille. Mais regarde père ! N’est-ce pas le vieux Tom précédé de deux jeunes oursons qui vient vers nous ?
- Par ici les petits ! cria le grand ours brun à sa progéniture. Ce jeune houx est la solution idéale pour brosser nos poils et gratter nos dos.
Les oursons se précipitèrent pour se rouler sur les feuilles piquantes du jeune arbuste.
- Oh, que c’est bon ! soupira le premier.
- Pousse-toi un peu, protesta le second, je veux aussi me faire gratter le dos.
- A moi, vous ne laissez pas la moindre petite place, se plaignit le père. Vous n’êtes que des enfants égoïstes !
- Va donc derrière l’arbuste, lui répondit l’un des oursons.
- Tu es arrivé le dernier, osa renchérir l’autre, et puis, est-ce de notre faute si tu es aussi gros et grand ?
Redoutant les foudres paternelles, le premier ourson tira son frère de côté afin que leur père put à son tour se brosser les poils.
Tom ne put s’empêcher de faire remarquer à ses petits :
- Ces feuilles piquantes sont vraiment d’une grande utilité.
Avec un grognement de satisfaction il rajouta :
- D’ailleurs, dans la nature, chaque chose a sa raison d’être. Il faut seulement apprendre à la comprendre. Existe-t-il de meilleures brosses pour nos fourrures que le houx ?
- Si seulement il nous arrachait un peu moins de poils ! se plaignit l’ourson.
- Ce n’est rien, répondit le père, les poils qu’il nous a arrachés, les oiseaux en garniront leurs nids. Donc, en t’y frottant, non seulement tu te grattes mais encore tu fais une bonne action.
Et les trois ours continuèrent à brosser et à lisser leur fourrure jusqu’à ce qu’elle fut brillante. Alors satisfaits, ils s’en allèrent en se dandinant.

A peine Tom et ses petits furent-ils hors de vue, que le jeune arbuste s’adressa à nouveau à ses parents :
- Ne sommes-nous donc sur terre que pour servir de brosse et de grattoir à ces gros balourds d’ours ?
- Non, mes enfants, répondit avec douceur la mère. Vous avez encore des buts plus élevés. Quand le rude hiver s’abattra sur la nature, vous aurez de la joie à donner au monde. Les oiseaux de la forêt trouveront refuge dans nos rameaux et se nourriront de nos baies rouges. En hiver nous sommes la plante la plus utile, et notre feuillage persistant fait de nous le symbole de Noël.

Le petit arbuste qui dès le début ne cessait de se lamenter sur son sort, dit sur un ton boudeur :
- Je ne trouve pas très esthétique d’être éternellement vert.
- Tu comprendras bientôt, patience mon chéri, répliqua la mère. Attends de voir passer à travers le vent et les bourrasques, le traîneau de Neighilde l’emportant au-dessus des nuages, et de dessous son long manteau de givre tomber les flocons de neige. Alors nos feuilles persistantes luiront dans la forêt rigide recouverte de cette morne blancheur, et nos baies éviteront aux oiseaux chanteurs de connaître les affres de la faim.
- Pourquoi ne nous relie-t-on pas ? Nous ferions certainement un très beau livre !
- Que tu es stupide, dit le père en riant. Nous avons certes des feuilles comme toutes les plantes, mais ce sont des pages qu’il faut pour faire un livre.
- Même comme page, dans un livre de contes par exemple, nous ferions bonne figure, fit le petit arbuste buté. Récemment, un écolier oublia son livre à mon pied. J’ai pu voir que de savantes choses y étaient écrites.
- En tant que houx, il est inutile d’aller acquérir ton savoir dans les livres ! rétorqua le père. Tu peux le faire dans la nature, et tes parents te transmettront leurs propres expériences.
- Et chez les humains, en va-t-il de même ?
- Je le crois bien, mon enfant. Nous avons d’ailleurs un point commun avec eux. Jeunes, ils sont épineux et mal dégrossis ; mais quand la vie les a bien usés, avec l’âge ils deviennent doux et bons.
Tandis que la mère s’exprimait ainsi, le ciel s’obscurcit et le vent du nord se mit à tourmenter avec férocité les arbres de la forêt. Mais les houx restèrent impassibles car ils savaient que les tourments de la vie ravivent nos forces.
Les nuages s’étirèrent laissant à nouveau la place au ciel bleu. Les oiseaux affamés arrivèrent pour picorer les baies rouges dans la couronne persistante du houx. Occupés à calmer leur faim, ils n’aperçurent pas les trois ours qui revenaient et dont les pas dans la neige ne faisaient aucun bruit.

Arrivés à proximité des houx, le vieux Tom grogna :
- Hé, les oiseaux, descendez de là, venez danser avec moi !
Mais les oiseaux toujours méfiants, non seulement déclinèrent son invitation, mais restèrent encore perchés sur les plus hautes branches.
Alors Tom se dressa sur ses pattes de derrière et tenta d’attraper un oiseau. Mais les feuilles du jeune houx lui infligèrent des piqûres si brûlantes qu’il dut abandonner.
Irrité, il s’adressa en ces termes à ses fils :
- Ce houx est jaloux comme un tigre ! Pas une seule fois il ne nous accorderait une paire de ces misérables volatiles ! Venez, nous n’avons rien à espérer ici !
Et en grommelant, ils s’en allèrent.
- Sais-tu à présent à quelles fins tu peux utiliser tes épines ? demanda le père au jeune houx. Bientôt, à l’époque où tout est gris et triste, tu apprendras à te réjouir de la persistance de ton feuillage. Vois, des enfants arrivent ! Noël n’est plus loin, et pour embellir aussi bien les palais des riches que les chaumières des pauvres, ils viennent couper de nos rameaux garnis de baies rouges et en faire des couronnes.
Alors le petit arbuste dû se rendre à l’évidence que ses parents avaient raison et il fut satisfait de son aspect piquant éternellement vert.


- Pourquoi faut-il que mes feuilles soient aussi coriaces et piquantes ?
- Tu comprendras plus tard, lui répondit en riant son père. Avant que tes feuilles soient aussi tendres et plates que celles de tes frères et sœurs, il te faudra passer par bien des épreuves.
- Ce que tu me dis là, ne m’explique toujours pas pourquoi je suis aussi piquant, poursuivit l’impertinent arbuste. Je trouve ces épines non seulement gênantes mais encore superflues. Je préfèrerais, et de loin, avoir des feuilles aussi tendres que celles des membres les plus âgés de notre famille. Mais regarde père ! N’est-ce pas le vieux Tom précédé de deux jeunes oursons qui vient vers nous ?
- Par ici les petits ! cria le grand ours brun à sa progéniture. Ce jeune houx est la solution idéale pour brosser nos poils et gratter nos dos.
Les oursons se précipitèrent pour se rouler sur les feuilles piquantes du jeune arbuste.
- Oh, que c’est bon ! soupira le premier.
- Pousse-toi un peu, protesta le second, je veux aussi me faire gratter le dos.
- A moi, vous ne laissez pas la moindre petite place, se plaignit le père. Vous n’êtes que des enfants égoïstes !
- Va donc derrière l’arbuste, lui répondit l’un des oursons.
- Tu es arrivé le dernier, osa renchérir l’autre, et puis, est-ce de notre faute si tu es aussi gros et grand ?
Redoutant les foudres paternelles, le premier ourson tira son frère de côté afin que leur père put à son tour se brosser les poils.
Tom ne put s’empêcher de faire remarquer à ses petits :
- Ces feuilles piquantes sont vraiment d’une grande utilité.
Avec un grognement de satisfaction il rajouta :
- D’ailleurs, dans la nature, chaque chose a sa raison d’être. Il faut seulement apprendre à la comprendre. Existe-t-il de meilleures brosses pour nos fourrures que le houx ?
- Si seulement il nous arrachait un peu moins de poils ! se plaignit l’ourson.
- Ce n’est rien, répondit le père, les poils qu’il nous a arrachés, les oiseaux en garniront leurs nids. Donc, en t’y frottant, non seulement tu te grattes mais encore tu fais une bonne action.
Et les trois ours continuèrent à brosser et à lisser leur fourrure jusqu’à ce qu’elle fut brillante. Alors satisfaits, ils s’en allèrent en se dandinant.

A peine Tom et ses petits furent-ils hors de vue, que le jeune arbuste s’adressa à nouveau à ses parents :
- Ne sommes-nous donc sur terre que pour servir de brosse et de grattoir à ces gros balourds d’ours ?
- Non, mes enfants, répondit avec douceur la mère. Vous avez encore des buts plus élevés. Quand le rude hiver s’abattra sur la nature, vous aurez de la joie à donner au monde. Les oiseaux de la forêt trouveront refuge dans nos rameaux et se nourriront de nos baies rouges. En hiver nous sommes la plante la plus utile, et notre feuillage persistant fait de nous le symbole de Noël.

Le petit arbuste qui dès le début ne cessait de se lamenter sur son sort, dit sur un ton boudeur :
- Je ne trouve pas très esthétique d’être éternellement vert.
- Tu comprendras bientôt, patience mon chéri, répliqua la mère. Attends de voir passer à travers le vent et les bourrasques, le traîneau de Neighilde l’emportant au-dessus des nuages, et de dessous son long manteau de givre tomber les flocons de neige. Alors nos feuilles persistantes luiront dans la forêt rigide recouverte de cette morne blancheur, et nos baies éviteront aux oiseaux chanteurs de connaître les affres de la faim.
- Pourquoi ne nous relie-t-on pas ? Nous ferions certainement un très beau livre !
- Que tu es stupide, dit le père en riant. Nous avons certes des feuilles comme toutes les plantes, mais ce sont des pages qu’il faut pour faire un livre.
- Même comme page, dans un livre de contes par exemple, nous ferions bonne figure, fit le petit arbuste buté. Récemment, un écolier oublia son livre à mon pied. J’ai pu voir que de savantes choses y étaient écrites.
- En tant que houx, il est inutile d’aller acquérir ton savoir dans les livres ! rétorqua le père. Tu peux le faire dans la nature, et tes parents te transmettront leurs propres expériences.
- Et chez les humains, en va-t-il de même ?
- Je le crois bien, mon enfant. Nous avons d’ailleurs un point commun avec eux. Jeunes, ils sont épineux et mal dégrossis ; mais quand la vie les a bien usés, avec l’âge ils deviennent doux et bons.
Tandis que la mère s’exprimait ainsi, le ciel s’obscurcit et le vent du nord se mit à tourmenter avec férocité les arbres de la forêt. Mais les houx restèrent impassibles car ils savaient que les tourments de la vie ravivent nos forces.
Les nuages s’étirèrent laissant à nouveau la place au ciel bleu. Les oiseaux affamés arrivèrent pour picorer les baies rouges dans la couronne persistante du houx. Occupés à calmer leur faim, ils n’aperçurent pas les trois ours qui revenaient et dont les pas dans la neige ne faisaient aucun bruit.

Arrivés à proximité des houx, le vieux Tom grogna :
- Hé, les oiseaux, descendez de là, venez danser avec moi !
Mais les oiseaux toujours méfiants, non seulement déclinèrent son invitation, mais restèrent encore perchés sur les plus hautes branches.
Alors Tom se dressa sur ses pattes de derrière et tenta d’attraper un oiseau. Mais les feuilles du jeune houx lui infligèrent des piqûres si brûlantes qu’il dut abandonner.
Irrité, il s’adressa en ces termes à ses fils :
- Ce houx est jaloux comme un tigre ! Pas une seule fois il ne nous accorderait une paire de ces misérables volatiles ! Venez, nous n’avons rien à espérer ici !
Et en grommelant, ils s’en allèrent.
- Sais-tu à présent à quelles fins tu peux utiliser tes épines ? demanda le père au jeune houx. Bientôt, à l’époque où tout est gris et triste, tu apprendras à te réjouir de la persistance de ton feuillage. Vois, des enfants arrivent ! Noël n’est plus loin, et pour embellir aussi bien les palais des riches que les chaumières des pauvres, ils viennent couper de nos rameaux garnis de baies rouges et en faire des couronnes.
Alors le petit arbuste dû se rendre à l’évidence que ses parents avaient raison et il fut satisfait de son aspect piquant éternellement vert.

Dernière édition par Freya le Jeu 18 Avr 2013 - 17:30, édité 2 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Le Lys doré Tamar
Le Lys doré Tamar
En Palestine, en ce jour du 4 juillet 1187, le sultan Saladin remportait la victoire finale sur les chevaliers Francs.
En proie à la haine, il donna l’ordre de rechercher parmi les prisonniers tous les Templiers et les Hospitaliers et de les exécuter sans exception.
Ibn al Athir, un proche du sultan, savait parfaitement que ce dernier voulait surtout la mort de ces preux car ils étaient bien plus énergiques au combat que tous les autres guerriers francs. Or Ibn al Athir s’était emparé d’un jeune Templier. Au cours de leur combat corps à corps, le musulman avait pris conscience de la valeur du jeune homme et des avantages qu’il pourrait en tirer ; il le dissimula donc parmi ses autres prisonniers.

Ibn al Athir était le père d’une très belle fille du nom de Tamar. Elle menait l’existence oisive des filles de pacha, et il lui arrivait parfois de se promener, tenant à la main de grands lys poussés dans le parc du palais, et elle paraissait si frêle dans sa longue robe de soie jaune safran qu’on eût dit qu’elle était leur grande sœur. Son père l’aimait tendrement et lui tenait souvent la tête appuyée sur son cœur.
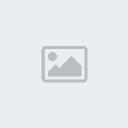 Cependant, le souci du bonheur de sa fille l’obsédait. Il la voyait grandir au milieu des grandes salles tendues de tapis de soie, des vastes cours fraîches où, jour et nuit, des jets d’eau chantaient dans des vasques. Abandonnée aux soins de ses servantes sous l’œil vigilant d’eunuques, elle passait les longues journées à peine vêtue sous ses voiles, accoudée sur de lourds coussins de soie brochée, à se laisser teindre les paupières et parfumer le corps avec les essences les plus rares apportées à grands frais des contrées lointaines dans des buires d’argent.
Cependant, le souci du bonheur de sa fille l’obsédait. Il la voyait grandir au milieu des grandes salles tendues de tapis de soie, des vastes cours fraîches où, jour et nuit, des jets d’eau chantaient dans des vasques. Abandonnée aux soins de ses servantes sous l’œil vigilant d’eunuques, elle passait les longues journées à peine vêtue sous ses voiles, accoudée sur de lourds coussins de soie brochée, à se laisser teindre les paupières et parfumer le corps avec les essences les plus rares apportées à grands frais des contrées lointaines dans des buires d’argent.
Éduqué par les maîtres du Temple, Guy, le jeune chevalier prisonnier du pacha, fut alors, sur son ordre, introduit auprès de Tamar pour lui apprendre à lire, à écrire et à dessiner. Les gardes du pacha veillaient au-dehors des murs et aucun d’eux ne connaissait le visage de Tamar ; des eunuques assuraient autour d’elle une grande vigilance et, hormis ces faces glabres et grasses, la fille du pacha n’avait jamais vu de visage d’homme.
Tamar aimait ces leçons. A chaque fois, elle accueillait Guy avec un sourire qui aurait fait tourner la tête à un sultan. Angélique et tendre, elle pressait la main de cet unique ami. Le chevalier tressaillait ; elle était sa joie et elle était son souci. Et un jour, penchés sur le même livre, la joue rose de Tamar toucha les lèvres de Guy. Au-dehors le soleil rougissait les toits et la lune douce aux amours se levait derrière les minarets blancs.
Les vieux eunuques avaient épié le jeune couple et leur regard, ce soir, était inquiet. Émus par la beauté de Tamar, ils l’adoraient, et leurs sabres restèrent au fourreau.

Depuis sa naissance Tamar était promise au fils d’un ami de son père, et elle savait que, même si Guy se faisait musulman, le pacha ne reviendrait pas sur sa décision.
Alors Guy lui proposa de fuir tous les deux en Grèce. Le cœur de Tamar était partagé entre son devoir et son amour pour le chevalier, mais finalement elle accepta son offre.
Saisissant la première occasion, ils avaient fui vers les montagnes grecques. Ils étaient arrivés devant un grand pâturage situé dans la montagne et dévalant en pente douce vers un ermitage occupé par un vieil ascète courbé par les ans.
Tamar s’ouvrit à lui.
- Mon enfant, lui dit l’ermite avec bonté, viens t’agenouiller à mon côté et laisse-moi prier Dieu pour qu’Il vous vienne en aide.
Suivi de la jeune fille il sortit de la cabane. Genoux en terre, le vieil homme anachorète à la barbe blanche et à la robe de bure, leva alors les bras vers le ciel. La jeune fille, ses longs cheveux noirs flottants sur ses habits de soie rouge brodés de rubis, s’agenouilla auprès de lui.
Perdu dans sa prière, l’ermite ne remarqua pas que la belle turque s’était relevée sans bruit et avait disparu.
Quand enfin il leva la tête, il vit à la place de Tamar un grand lys rouge. Effrayé, il se précipita à l’intérieur de sa cabane pensant y trouver le jeune fille, mais elle n’y était pas.
Entre-temps, Guy s’était également mis à la recherche de sa bien-aimée. Quel ne fut pas son effarement quand le vieillard lui dit :
- Regarde ! Dieu a changé en lys rouge celle que tu aimais afin qu’elle n’ait plus à choisir entre son devoir et son amour pour toi.
Guy se jeta au pied de la fleur et s’écria :
- Tamar, mon doux amour, si vraiment tu vis à présent sous la forme de ce lys rouge, donne-moi la preuve que ce que m’a dit le vieil homme est vrai.
Alors un doux zéphyr fit frémir les lointains oliviers et voltigea jusqu’au lys et Guy entendit une voix étouffée lui souffler :
- Oui, je suis Tamar, ta bien-aimée !
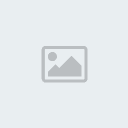
De tristesse et de douleur, Guy courba la tête. Son visage jaunit et des larmes dorées roulèrent sur ses joues et tombèrent, goutte à goutte, comme des perles, sur les pétales du lys, changeant leur couleur rouge en un jaune éclatant.
Touché de compassion, Dieu changea Guy en nuage de pluie. Ainsi pût-il rafraîchir le lys et prolonger son existence.
Depuis ce temps-là, les filles turques ont coutume d’effeuiller des lys rouges et dorés dans les champs menacés par la sécheresse pour attirer les nuages porteurs de pluie.
Elles ont aussi gardé une autre habitude. Cette belle fleur que l’on appelle en Turquie, le « lys Tamar », fleurit soit rouge, soit jaune, et il est impossible de dire à l’avance de quelle couleur elle sera, d’autant plus que son calice ne s’ouvre que sous la première pluie. Aussi les jeunes filles turques choisissent-elles au hasard une de ces fleurs en bouton pour qu’elle présage leur avenir. Si elle fleurit jaune, l’être aimé leur sera infidèle ; si elle s’épanouit rouge, un grand amour sans nuages les attend.

En proie à la haine, il donna l’ordre de rechercher parmi les prisonniers tous les Templiers et les Hospitaliers et de les exécuter sans exception.
Ibn al Athir, un proche du sultan, savait parfaitement que ce dernier voulait surtout la mort de ces preux car ils étaient bien plus énergiques au combat que tous les autres guerriers francs. Or Ibn al Athir s’était emparé d’un jeune Templier. Au cours de leur combat corps à corps, le musulman avait pris conscience de la valeur du jeune homme et des avantages qu’il pourrait en tirer ; il le dissimula donc parmi ses autres prisonniers.

Ibn al Athir était le père d’une très belle fille du nom de Tamar. Elle menait l’existence oisive des filles de pacha, et il lui arrivait parfois de se promener, tenant à la main de grands lys poussés dans le parc du palais, et elle paraissait si frêle dans sa longue robe de soie jaune safran qu’on eût dit qu’elle était leur grande sœur. Son père l’aimait tendrement et lui tenait souvent la tête appuyée sur son cœur.
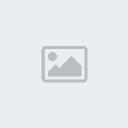
Éduqué par les maîtres du Temple, Guy, le jeune chevalier prisonnier du pacha, fut alors, sur son ordre, introduit auprès de Tamar pour lui apprendre à lire, à écrire et à dessiner. Les gardes du pacha veillaient au-dehors des murs et aucun d’eux ne connaissait le visage de Tamar ; des eunuques assuraient autour d’elle une grande vigilance et, hormis ces faces glabres et grasses, la fille du pacha n’avait jamais vu de visage d’homme.
Tamar aimait ces leçons. A chaque fois, elle accueillait Guy avec un sourire qui aurait fait tourner la tête à un sultan. Angélique et tendre, elle pressait la main de cet unique ami. Le chevalier tressaillait ; elle était sa joie et elle était son souci. Et un jour, penchés sur le même livre, la joue rose de Tamar toucha les lèvres de Guy. Au-dehors le soleil rougissait les toits et la lune douce aux amours se levait derrière les minarets blancs.
Les vieux eunuques avaient épié le jeune couple et leur regard, ce soir, était inquiet. Émus par la beauté de Tamar, ils l’adoraient, et leurs sabres restèrent au fourreau.

Depuis sa naissance Tamar était promise au fils d’un ami de son père, et elle savait que, même si Guy se faisait musulman, le pacha ne reviendrait pas sur sa décision.
Alors Guy lui proposa de fuir tous les deux en Grèce. Le cœur de Tamar était partagé entre son devoir et son amour pour le chevalier, mais finalement elle accepta son offre.
Saisissant la première occasion, ils avaient fui vers les montagnes grecques. Ils étaient arrivés devant un grand pâturage situé dans la montagne et dévalant en pente douce vers un ermitage occupé par un vieil ascète courbé par les ans.
Tamar s’ouvrit à lui.
- Mon enfant, lui dit l’ermite avec bonté, viens t’agenouiller à mon côté et laisse-moi prier Dieu pour qu’Il vous vienne en aide.
Suivi de la jeune fille il sortit de la cabane. Genoux en terre, le vieil homme anachorète à la barbe blanche et à la robe de bure, leva alors les bras vers le ciel. La jeune fille, ses longs cheveux noirs flottants sur ses habits de soie rouge brodés de rubis, s’agenouilla auprès de lui.
Perdu dans sa prière, l’ermite ne remarqua pas que la belle turque s’était relevée sans bruit et avait disparu.
Quand enfin il leva la tête, il vit à la place de Tamar un grand lys rouge. Effrayé, il se précipita à l’intérieur de sa cabane pensant y trouver le jeune fille, mais elle n’y était pas.
Entre-temps, Guy s’était également mis à la recherche de sa bien-aimée. Quel ne fut pas son effarement quand le vieillard lui dit :
- Regarde ! Dieu a changé en lys rouge celle que tu aimais afin qu’elle n’ait plus à choisir entre son devoir et son amour pour toi.
Guy se jeta au pied de la fleur et s’écria :
- Tamar, mon doux amour, si vraiment tu vis à présent sous la forme de ce lys rouge, donne-moi la preuve que ce que m’a dit le vieil homme est vrai.
Alors un doux zéphyr fit frémir les lointains oliviers et voltigea jusqu’au lys et Guy entendit une voix étouffée lui souffler :
- Oui, je suis Tamar, ta bien-aimée !
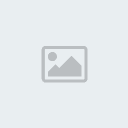
De tristesse et de douleur, Guy courba la tête. Son visage jaunit et des larmes dorées roulèrent sur ses joues et tombèrent, goutte à goutte, comme des perles, sur les pétales du lys, changeant leur couleur rouge en un jaune éclatant.
Touché de compassion, Dieu changea Guy en nuage de pluie. Ainsi pût-il rafraîchir le lys et prolonger son existence.
Depuis ce temps-là, les filles turques ont coutume d’effeuiller des lys rouges et dorés dans les champs menacés par la sécheresse pour attirer les nuages porteurs de pluie.
Elles ont aussi gardé une autre habitude. Cette belle fleur que l’on appelle en Turquie, le « lys Tamar », fleurit soit rouge, soit jaune, et il est impossible de dire à l’avance de quelle couleur elle sera, d’autant plus que son calice ne s’ouvre que sous la première pluie. Aussi les jeunes filles turques choisissent-elles au hasard une de ces fleurs en bouton pour qu’elle présage leur avenir. Si elle fleurit jaune, l’être aimé leur sera infidèle ; si elle s’épanouit rouge, un grand amour sans nuages les attend.


Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 L'Hellébore ou Rose de Noël
L'Hellébore ou Rose de Noël
Quand la terrible reine sut que la pomme qu’elle avait donnée à croquer à la princesse Hellébore ne lui avait que fait perdre connaissance, et que les nains de la forêt avaient recueilli son beau corps léthargique dans un cercueil de cristal, et pire, qu’ils le gardaient jalousement invisible dans leur grotte magique, elle se mit en colère. Elle se dressa dans sa cathèdre de bois d’ébène, incrustée d’argent et d’ivoire où elle songeait assise dans la chambre la plus élevée du donjon, déchira de haut en bas sa lourde dalmatique de brocart doré enrichie de gerbes de lys pourpres, et brisa contre le sol le miroir ovale qui venait de lui apprendre l’odieuse nouvelle.

Quelque peu calmée, elle ouvrit les battants de la haute fenêtre de sa chambre et promena son regard sur la campagne. Elle était toute couverte de neige et, dans l’air froid de la nuit, les flocons voletaient mouchetant l’horizon. Au pied du donjon, la neige avait des reflets d’incendie et la reine savait que c’était le feu des cuisines royales où se préparait le festin du soir, car cette histoire se passait le jour même de l’Epiphanie et il y aurait grande fête au château. La méchante reine ne put réprimer un mauvais sourire car, à ce moment même rôtissait pour le roi un faisan doré que traîtreusement elle avait fait remplir d’un mélange horrible de substances destiné à égarer définitivement l’esprit du vieux roi et effacer à tout jamais de sa mémoire défaillante le souvenir de sa fille, la douce princesse Hellébore.

Pourquoi fallait-il que cette frêle enfant, avec ses grands yeux de biche et son visage de poupée de porcelaine, la surpasse en beauté, elle, la merveilleuse reine des Isles ? Pourquoi avait-il fallu qu’elle vînt dans ce petit royaume pour s’entendre dire et répéter par le vent jouant dans les haies et jusqu’à son propre miroir, un miroir magique animé par un génie : « Ta beauté, grande reine, est sans pareille, mais la princesse Hellébore est plus belle encore ! » Que la peste soit d’elle ! Alors elle n’avait plus eu ni trêve ni repos ; il n’y avait pas eu d’infamies dont elle n’eût accusé la petite fille pour la perdre dans l’esprit de son père le roi. Mais aveuglé d’amour et de tendresse, le vieil imbécile ne l’écoutait pas, tout épris qu’il fût de sa beauté de magicienne. Etaient-ce les fées ou son innocence qui protégeaient son corps frêle d’enfant contre les poisons les plus violents ? C’est avec rage qu’elle se souvenait encore du jour où, n’y tenant plus, elle fit dévêtir par les chambrières la pauvrette pour la faire fouetter jusqu’au sang et entamer sa peau et sa chair. Mais les lanières de cuir s’étaient changées en plumes qui n’avaient fait que caresser les épaules tremblantes de la petite Hellébore.

Alors exaspérée, la méchante reine avait résolu sa perte. La nuit venue, elle l’avait étranglée de ses propres mains et transportée en-dehors du parc royal. Qu’allait-elle dire au roi ? Il ne se passait de jour sans que quelque troupe de Bohémiens ne vînt chanter et danser au pied des remparts bien gardés du château. Mais amusée par les grimaces et les jongleries de ces gueux, la petite princesse avait quitté la haute fenêtre de sa chambre pour s’aventurer parmi leurs chariots. Et quand l’aube se leva sur le château royal, les gardes trouvèrent la poterne grande ouverte. La méchante reine n’avait même pas eu à se servir du prétexte qu’elle avait inventé : la garnison mise sur pied ne retrouva pas la trace de la petite princesse ; les loups avaient dû se charger de faire disparaître son corps. Enfin, l’orgueilleuse reine triomphait quand elle eût l’idée d’interroger à nouveau son miroir magique. Vivement contrariée par le génie, elle s’était vengée de lui en brisant aussitôt le miroir. Mais cela ne l’avait guère avancée puisque sa rivale dormait sous la protection des gnomes de la forêt.
Fort embarrassée, elle referma les battants de la haute fenêtre de sa chambre et alla retirer du double fond d’un grand coffre la tête d’un sorcier mort, qu’elle ne consultait que dans des circonstances exceptionnelles. L’ayant posée à côté d’un vieux grimoire ouvert sur un pupitre, elle allumait trois cierges de cire sombre et tandis qu’elle se perdait dans ses horribles pensées, son corbeau apprivoisé fouillait du bec les orbites vides où autrefois brillaient deux yeux à la prunelle vitreuse et verte.

Négligeant les sages conseils de son astrologue, elle cheminait à présent à des lieues du château, sous le vent froid de la nuit et la neige, dans le silence de la forêt assoupie. Sur sa chemise de soie blanche, elle avait passé une robe de bure brune qui la faisait ressembler à quelque vieux moine pénitent. Protégeant l’éclat de son visage sous sa large capuche, elle pressait le pas au pied des sapins chargés de neige, évitant de passer sous les pins et les houx ayant pouvoir de chasser les mauvais esprits, Noël n’étant pas encore bien éloigné. Quelques-uns avec leurs branches dressées vers le ciel semblaient vouloir la maudire ; d’autres, écrasés par leur cagoule de neige et de glace avaient pris d’étranges attitudes de pénitents ou de moines en prière agenouillés sur le bord du chemin. Dans l’étrange forêt où son pas ne faisait aucun bruit, la reine se hâtait, tout entière à son noir dessein, les pans de son manteau ramenés sur un objet qui remuait faiblement et poussait de petits cris plaintifs.
Dérobé à une servante, le nouveau-né qu’elle emportait, devait être égorgé au douzième coup de minuit, ainsi qu’il est écrit dans son vieux grimoire, à un carrefour de chemins. Alors, les trolls ennemis des gnomes accourraient pour boire le sang chaud et elle les charmerait avec sa flûte en cristal au son magique. Charmés, les trolls lui obéiraient et la conduiraient jusqu’à la grotte des nains. En cette nuit de l’Epiphanie, tout comme la veille de Noël, tout enchantement était suspendu et l’entrée en était rendue visible et assez grande pour laisser passer un être humain. Elle pénètrerait donc dans la grotte en dispersant à l’aide de son émeraude magique, les kobolds, gardiens des trésors enfouis dans la terre, s’approcherait de la châsse de cristal, en briserait le couvercle, au besoin, pour frapper en plein cœur sa rivale endormie.

L’enivrante jouissance de la vengeance qu’elle allait enfin pouvoir satisfaire lui faisait perdre toute vigilance. Elle hâtait le pas, abîmée dans ses pensées sombres, sous les arbres géants aux branches immobiles où la vie s’était figée.
Une grande inquiétude émanait du paysage, mais des musiques lointaines et des voix résonnant soudain, faisaient se dresser l’oreille de la reine. Il se fit une très légère vibration dans les branches givrées qui frémirent, et la reine frappée de stupeur, vit s’avancer un bien étrange cortège.
Sous un ciel bas d’hiver, dans un décor froid et étincelant de givre et de glace, apparurent des palanquins de soie oscillant au dos de chameaux, des cavaliers coiffés de turbans verts et portant des étendards garnis de croissants de lune et de boules d’or. Des négrillons rieurs à l’émail des dents éclatant, aux bras et aux chevilles chargés d’anneaux d’or sautillaient dans la neige autour de trois majestueux patriarches au profil hautain, emmitouflés dans de grands burnous blancs, s’ouvrant sur des robes d’or, de pourpre et d’hyacinthe. Enveloppées dans la gaze de leurs voiles et les volutes bleuâtres et parfumées exhalées par de longues cassolettes d’argent, des femmes chantaient des psaumes.
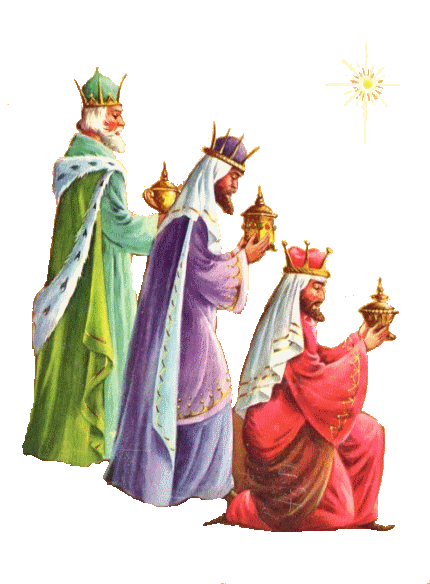 Cachée derrière un tronc d’arbre, la reine avait reconnu les rois mages : Gaspar le Noir, Melchior le jeune cheik et Balthazar le vieux sage.
Cachée derrière un tronc d’arbre, la reine avait reconnu les rois mages : Gaspar le Noir, Melchior le jeune cheik et Balthazar le vieux sage.
La caravane était passée mais les psaumes et les voix qui les chantaient bourdonnaient encore à ses oreilles. Livide, la reine sentait monter l’angoisse qui lui baignait les tempes de sueur. Elle venait de se souvenir trop tard que, la nuit de l’Epiphanie, le pouvoir des maléfices était rompu. Dans l’air imprégné du nard et de l’encens des brûle-parfums, aucun sortilège n’était possible.
C’est donc en vain qu’elle avait parcouru des lieues dans la forêt glacée et enneigée. Elle résolut de retourner sur ses pas, mais l’enfant qu’elle tenait toujours serré sous son manteau devint soudain pénible à porter, si pesant qu’elle demeura là comme pétrifiée debout dans la neige qui commençait à s’amonceler étrangement autour d’elle.
Une torpeur étrange, un accablement invincible l’avaient saisie. Elle ne pouvait plus bouger ses pieds. Un charme la retenait prisonnière dans cette étrange forêt de coraux de glace. Elle était vouée à une mort certaine si elle n’arrivait pas à en rompre le cercle. Mais qui accepterait de venir à son secours ? En cette nuit d’Epiphanie tous les mauvais esprits se tiennent bien tranquille, seuls rôdent les bons ; et la perfide reine eut l’idée d’appeler les nains, ces bons petits hommes de la forêt qui avaient recueilli Hellébore. Les sachant épris de musique douce, elle eut encore la force de tirer sa flûte magique de dessous son manteau et de la porter à ses lèvres.

Elle se sentait défaillir sous le poids de l’enfant, et ses pieds pris dans la neige glacée bleuissaient, mais ses lèvres exsangues trouvaient encore des sons doux et mélancoliques.
Tandis que soutenue par une vague espérance, elle tentait cet ultime appel, ses yeux fouillaient désespérément les branches grêles à fleur de sol, les nœuds des racines au pied des grands chênes et les souches laissées çà et là par les bûcherons, lieux où les gnomes se montraient de préférence.
La reine tressauta. Tout autour d’elle, des yeux jaunes et brillants la fixaient. Il y en avait partout, au loin et tout près, entre les arbres, les buissons, derrière les souches, et chaque paire d’yeux étincelaient dans la nuit formant un cercle se refermant sur elle.
Les gnomes !... Enfin !... La reine esquissait un sourire qui se figeait aussitôt en une expression d’épouvante : au-dessus de chaque paire d’yeux fulgurant dans la nuit, elle venait d’apercevoir des oreilles pointues, et au-dessous, un museau aux babines retroussées sur des crocs blancs.
En cette nuit d’Epiphanie, sa flûte de cristal magique n’avait réussi à appeler que les loups.

Le lendemain, la garnison du château, attirée par les vagissements du petit enfant, ne retrouva que le corps dépecé de la terrible reine.



Quelque peu calmée, elle ouvrit les battants de la haute fenêtre de sa chambre et promena son regard sur la campagne. Elle était toute couverte de neige et, dans l’air froid de la nuit, les flocons voletaient mouchetant l’horizon. Au pied du donjon, la neige avait des reflets d’incendie et la reine savait que c’était le feu des cuisines royales où se préparait le festin du soir, car cette histoire se passait le jour même de l’Epiphanie et il y aurait grande fête au château. La méchante reine ne put réprimer un mauvais sourire car, à ce moment même rôtissait pour le roi un faisan doré que traîtreusement elle avait fait remplir d’un mélange horrible de substances destiné à égarer définitivement l’esprit du vieux roi et effacer à tout jamais de sa mémoire défaillante le souvenir de sa fille, la douce princesse Hellébore.

Pourquoi fallait-il que cette frêle enfant, avec ses grands yeux de biche et son visage de poupée de porcelaine, la surpasse en beauté, elle, la merveilleuse reine des Isles ? Pourquoi avait-il fallu qu’elle vînt dans ce petit royaume pour s’entendre dire et répéter par le vent jouant dans les haies et jusqu’à son propre miroir, un miroir magique animé par un génie : « Ta beauté, grande reine, est sans pareille, mais la princesse Hellébore est plus belle encore ! » Que la peste soit d’elle ! Alors elle n’avait plus eu ni trêve ni repos ; il n’y avait pas eu d’infamies dont elle n’eût accusé la petite fille pour la perdre dans l’esprit de son père le roi. Mais aveuglé d’amour et de tendresse, le vieil imbécile ne l’écoutait pas, tout épris qu’il fût de sa beauté de magicienne. Etaient-ce les fées ou son innocence qui protégeaient son corps frêle d’enfant contre les poisons les plus violents ? C’est avec rage qu’elle se souvenait encore du jour où, n’y tenant plus, elle fit dévêtir par les chambrières la pauvrette pour la faire fouetter jusqu’au sang et entamer sa peau et sa chair. Mais les lanières de cuir s’étaient changées en plumes qui n’avaient fait que caresser les épaules tremblantes de la petite Hellébore.

Alors exaspérée, la méchante reine avait résolu sa perte. La nuit venue, elle l’avait étranglée de ses propres mains et transportée en-dehors du parc royal. Qu’allait-elle dire au roi ? Il ne se passait de jour sans que quelque troupe de Bohémiens ne vînt chanter et danser au pied des remparts bien gardés du château. Mais amusée par les grimaces et les jongleries de ces gueux, la petite princesse avait quitté la haute fenêtre de sa chambre pour s’aventurer parmi leurs chariots. Et quand l’aube se leva sur le château royal, les gardes trouvèrent la poterne grande ouverte. La méchante reine n’avait même pas eu à se servir du prétexte qu’elle avait inventé : la garnison mise sur pied ne retrouva pas la trace de la petite princesse ; les loups avaient dû se charger de faire disparaître son corps. Enfin, l’orgueilleuse reine triomphait quand elle eût l’idée d’interroger à nouveau son miroir magique. Vivement contrariée par le génie, elle s’était vengée de lui en brisant aussitôt le miroir. Mais cela ne l’avait guère avancée puisque sa rivale dormait sous la protection des gnomes de la forêt.
Fort embarrassée, elle referma les battants de la haute fenêtre de sa chambre et alla retirer du double fond d’un grand coffre la tête d’un sorcier mort, qu’elle ne consultait que dans des circonstances exceptionnelles. L’ayant posée à côté d’un vieux grimoire ouvert sur un pupitre, elle allumait trois cierges de cire sombre et tandis qu’elle se perdait dans ses horribles pensées, son corbeau apprivoisé fouillait du bec les orbites vides où autrefois brillaient deux yeux à la prunelle vitreuse et verte.

Négligeant les sages conseils de son astrologue, elle cheminait à présent à des lieues du château, sous le vent froid de la nuit et la neige, dans le silence de la forêt assoupie. Sur sa chemise de soie blanche, elle avait passé une robe de bure brune qui la faisait ressembler à quelque vieux moine pénitent. Protégeant l’éclat de son visage sous sa large capuche, elle pressait le pas au pied des sapins chargés de neige, évitant de passer sous les pins et les houx ayant pouvoir de chasser les mauvais esprits, Noël n’étant pas encore bien éloigné. Quelques-uns avec leurs branches dressées vers le ciel semblaient vouloir la maudire ; d’autres, écrasés par leur cagoule de neige et de glace avaient pris d’étranges attitudes de pénitents ou de moines en prière agenouillés sur le bord du chemin. Dans l’étrange forêt où son pas ne faisait aucun bruit, la reine se hâtait, tout entière à son noir dessein, les pans de son manteau ramenés sur un objet qui remuait faiblement et poussait de petits cris plaintifs.
Dérobé à une servante, le nouveau-né qu’elle emportait, devait être égorgé au douzième coup de minuit, ainsi qu’il est écrit dans son vieux grimoire, à un carrefour de chemins. Alors, les trolls ennemis des gnomes accourraient pour boire le sang chaud et elle les charmerait avec sa flûte en cristal au son magique. Charmés, les trolls lui obéiraient et la conduiraient jusqu’à la grotte des nains. En cette nuit de l’Epiphanie, tout comme la veille de Noël, tout enchantement était suspendu et l’entrée en était rendue visible et assez grande pour laisser passer un être humain. Elle pénètrerait donc dans la grotte en dispersant à l’aide de son émeraude magique, les kobolds, gardiens des trésors enfouis dans la terre, s’approcherait de la châsse de cristal, en briserait le couvercle, au besoin, pour frapper en plein cœur sa rivale endormie.

L’enivrante jouissance de la vengeance qu’elle allait enfin pouvoir satisfaire lui faisait perdre toute vigilance. Elle hâtait le pas, abîmée dans ses pensées sombres, sous les arbres géants aux branches immobiles où la vie s’était figée.
Une grande inquiétude émanait du paysage, mais des musiques lointaines et des voix résonnant soudain, faisaient se dresser l’oreille de la reine. Il se fit une très légère vibration dans les branches givrées qui frémirent, et la reine frappée de stupeur, vit s’avancer un bien étrange cortège.
Sous un ciel bas d’hiver, dans un décor froid et étincelant de givre et de glace, apparurent des palanquins de soie oscillant au dos de chameaux, des cavaliers coiffés de turbans verts et portant des étendards garnis de croissants de lune et de boules d’or. Des négrillons rieurs à l’émail des dents éclatant, aux bras et aux chevilles chargés d’anneaux d’or sautillaient dans la neige autour de trois majestueux patriarches au profil hautain, emmitouflés dans de grands burnous blancs, s’ouvrant sur des robes d’or, de pourpre et d’hyacinthe. Enveloppées dans la gaze de leurs voiles et les volutes bleuâtres et parfumées exhalées par de longues cassolettes d’argent, des femmes chantaient des psaumes.
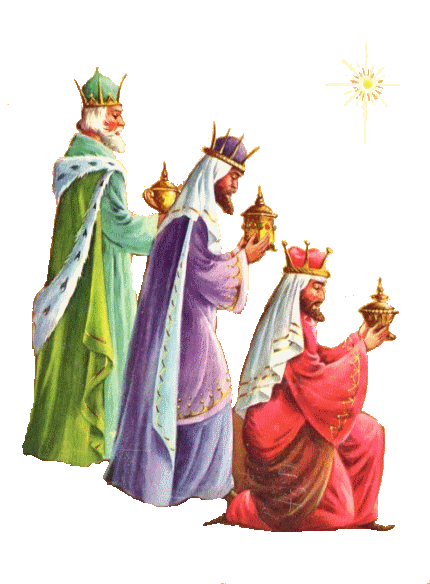
La caravane était passée mais les psaumes et les voix qui les chantaient bourdonnaient encore à ses oreilles. Livide, la reine sentait monter l’angoisse qui lui baignait les tempes de sueur. Elle venait de se souvenir trop tard que, la nuit de l’Epiphanie, le pouvoir des maléfices était rompu. Dans l’air imprégné du nard et de l’encens des brûle-parfums, aucun sortilège n’était possible.
C’est donc en vain qu’elle avait parcouru des lieues dans la forêt glacée et enneigée. Elle résolut de retourner sur ses pas, mais l’enfant qu’elle tenait toujours serré sous son manteau devint soudain pénible à porter, si pesant qu’elle demeura là comme pétrifiée debout dans la neige qui commençait à s’amonceler étrangement autour d’elle.
Une torpeur étrange, un accablement invincible l’avaient saisie. Elle ne pouvait plus bouger ses pieds. Un charme la retenait prisonnière dans cette étrange forêt de coraux de glace. Elle était vouée à une mort certaine si elle n’arrivait pas à en rompre le cercle. Mais qui accepterait de venir à son secours ? En cette nuit d’Epiphanie tous les mauvais esprits se tiennent bien tranquille, seuls rôdent les bons ; et la perfide reine eut l’idée d’appeler les nains, ces bons petits hommes de la forêt qui avaient recueilli Hellébore. Les sachant épris de musique douce, elle eut encore la force de tirer sa flûte magique de dessous son manteau et de la porter à ses lèvres.

Elle se sentait défaillir sous le poids de l’enfant, et ses pieds pris dans la neige glacée bleuissaient, mais ses lèvres exsangues trouvaient encore des sons doux et mélancoliques.
Tandis que soutenue par une vague espérance, elle tentait cet ultime appel, ses yeux fouillaient désespérément les branches grêles à fleur de sol, les nœuds des racines au pied des grands chênes et les souches laissées çà et là par les bûcherons, lieux où les gnomes se montraient de préférence.
La reine tressauta. Tout autour d’elle, des yeux jaunes et brillants la fixaient. Il y en avait partout, au loin et tout près, entre les arbres, les buissons, derrière les souches, et chaque paire d’yeux étincelaient dans la nuit formant un cercle se refermant sur elle.
Les gnomes !... Enfin !... La reine esquissait un sourire qui se figeait aussitôt en une expression d’épouvante : au-dessus de chaque paire d’yeux fulgurant dans la nuit, elle venait d’apercevoir des oreilles pointues, et au-dessous, un museau aux babines retroussées sur des crocs blancs.
En cette nuit d’Epiphanie, sa flûte de cristal magique n’avait réussi à appeler que les loups.

Le lendemain, la garnison du château, attirée par les vagissements du petit enfant, ne retrouva que le corps dépecé de la terrible reine.



Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 L'Orchidée Pourpre
L'Orchidée Pourpre
Il y a fort longtemps, un père et une mère vivaient avec leurs sept filles dans une humble métairie à l’écart du village, à la lisière d’une profonde forêt.
L’aînée des sœurs était une âme simple et pourtant pleine de mystère. Depuis seize ans ses parents la voyaient errer dans la grisaille des petits jours comme dans la splendeur des crépuscules, ou rêver adossée, le fuseau à la main, contre quelque vieux tronc à la silhouette de spectre. Et c’était là la grande peine de sa mère, car ses yeux bleus, lointains, toujours ailleurs, toujours partis dans les nuages quand ils ne fixaient pas impatiemment la forêt. Charme du gazouillis des oiseaux, séduction de la rêverie, enivrement du vent, son oreille percevait de doux échos de fêtes et la main appuyée sur son cœur, elle écoutait bourdonner et résonner au fond d’elle-même la voix des elfes. Elle tombait alors dans une mélancolie étrange.
 Par une cruelle ironie du sort, la petite fileuse de lin aimait les somptueuses étoffes de pourpre, satins, soies écarlates. A force d’y penser, le jour dans la forêt, la nuit dans sa chaumière, elle se mit en tête qu’elle était fille de roi. Elle se voyait alors, les longs cheveux blonds ornés de fleurs, une robe à traîne pourpre descendant sur ses pas les marches d’un somptueux escalier où s’étageaient les courtisans.
Par une cruelle ironie du sort, la petite fileuse de lin aimait les somptueuses étoffes de pourpre, satins, soies écarlates. A force d’y penser, le jour dans la forêt, la nuit dans sa chaumière, elle se mit en tête qu’elle était fille de roi. Elle se voyait alors, les longs cheveux blonds ornés de fleurs, une robe à traîne pourpre descendant sur ses pas les marches d’un somptueux escalier où s’étageaient les courtisans.
Par un jour brumeux elle se coucha dans l’herbe haute d’une clairière et se mit à pleurer. Se reprenant, elle pria les esprits de la forêt de l’aider à réaliser son rêve. Soudain, elle perçut la voix de sa mère partie à sa recherche :
- Que fais-tu à nouveau dans la forêt alors qu’il y a du travail à terminer à la maison ?
- Je rêvais, répondit la jeune fille.
- Tu ferais mieux de rentrer et de balayer la cuisine, rétorqua la mère irritée.
- Regarde mère, reprit la jeune fille, j’ai vu des elfes marcher dans la mousse en se tenant par la main. Ils dansaient autour des charmantes fleurs pourpres que tu vois là, et versaient du parfum dans leurs calices. Mais ils se sont enfuis à ton approche, car ils n’aiment pas les paroles dures. A présent, ils se cachent dans les calices de ces fleurs merveilleuses.
La mère se pencha sur les fleurs et dit :
- Tu as raison mon enfant, ces fleurs sont très belles mais elles ne dégagent aucun parfum. Je vais tout de même en cueillir quelques-unes et les rapporter à la maison.
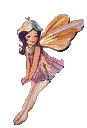
La prière de la jeune fille se répandit telle une bouffée de parfum dans les bois embrumés et complices, tout fleuris d’orchidées. Un mystère était en elles, le mystère de leur ressemblance avec des colombes, oiseaux de la déesse de l’Amour. Douées d’une singulière puissance occulte, une étrange clarté émanait d’elles et tout le bois sombre s’éclaira de leurs corolles translucides. Une bouffée de brise passa et emportant la senteur troublante des fleurs, diffusa aux alentours du pays l’appel de la petite fileuse de lin.
Il se trouva qu’au même moment, le roi et la reine du pays voisin s’apprêtaient à fêter leurs noces d’argent. Leur fils entendit parler de ces fleurs merveilleuses, et comme il souhaitait offrir une chose rare à ses parents, il prit la résolution de se rendre dans la contrée où elles poussaient.

Il y avait déjà des heures que le prince chevauchait dans le clair-obscur de la haute et profonde forêt de chênes où les pas de son cheval ne faisaient aucun bruit. Et comme il se penchait en avant pour mieux fouiller du regard le sol entre les nœuds des racines aux pieds des chênes, une forme svelte de jeune fille apparaissait un peu en-dessous de lui. Une étoffe pourpre flottait sur ses reins, lui moulant la taille, et maintenant qu’il s’était rapproché, le prince admirait ses chevaux d’un blond très pâle couronnés d’orchidées et flottant en nappe autour d’elle.
« Ah » songea le prince, « je préfère cette apparition féerique à toutes les fleurs, fussent-elles rares et précieuses, car elle est l’incarnation de la fleur légendaire, inconnue fleur de rêve de cette forêt. Je vais la rapporter à mes parents en guise de cadeau ». Et il dit à la belle :
- Dis-moi, blonde enfant, es-tu de nature humaine ? Ne serais-tu pas plutôt la reine des fées qui tiennent cour en cette forêt ?
- Comme toi, répondit la jeune fille, je suis de nature humaine, aucune fée ne se tient devant toi. A l’orée de la forêt s’élève la chaumière de mes parents. Mais toi mon prince, je te connais pour t’avoir vu en rêve.
- Quand je me reposais dans ma chambre baignée de clair de lune, la tête appuyée sur les coussins de soie bleue de mon lit, je voyais en rêve ton corps, souple tige de fleur dont le délicieux calice modelé comme un visage souriait à mesure que je me penchais vers lui. Viens douce orchidée, tu seras ma princesse.
La jeune fille se laissa prendre sous les aisselles et mettre en selle. Ensemble, ils chevauchèrent à travers la forêt ensoleillée et odorante, fleurie d’orchidées pourpres qui toutes avaient baissé leur petite tête, approuvant le choix du prince. Des formes blanches se pressaient en cercles autour d’eux avec un froissement d’ailes et de petits cris, et le prince reconnut les elfes.

Lorsque le prince épousa la jeune fille, les elfes lui tressèrent la plus belle couronne d’orchidées qu’une mariée eût portée. Depuis lors, l’orchidée est une fleur royale et il en existe des variétés qui valent de l’or.

L’aînée des sœurs était une âme simple et pourtant pleine de mystère. Depuis seize ans ses parents la voyaient errer dans la grisaille des petits jours comme dans la splendeur des crépuscules, ou rêver adossée, le fuseau à la main, contre quelque vieux tronc à la silhouette de spectre. Et c’était là la grande peine de sa mère, car ses yeux bleus, lointains, toujours ailleurs, toujours partis dans les nuages quand ils ne fixaient pas impatiemment la forêt. Charme du gazouillis des oiseaux, séduction de la rêverie, enivrement du vent, son oreille percevait de doux échos de fêtes et la main appuyée sur son cœur, elle écoutait bourdonner et résonner au fond d’elle-même la voix des elfes. Elle tombait alors dans une mélancolie étrange.

Par un jour brumeux elle se coucha dans l’herbe haute d’une clairière et se mit à pleurer. Se reprenant, elle pria les esprits de la forêt de l’aider à réaliser son rêve. Soudain, elle perçut la voix de sa mère partie à sa recherche :
- Que fais-tu à nouveau dans la forêt alors qu’il y a du travail à terminer à la maison ?
- Je rêvais, répondit la jeune fille.
- Tu ferais mieux de rentrer et de balayer la cuisine, rétorqua la mère irritée.
- Regarde mère, reprit la jeune fille, j’ai vu des elfes marcher dans la mousse en se tenant par la main. Ils dansaient autour des charmantes fleurs pourpres que tu vois là, et versaient du parfum dans leurs calices. Mais ils se sont enfuis à ton approche, car ils n’aiment pas les paroles dures. A présent, ils se cachent dans les calices de ces fleurs merveilleuses.
La mère se pencha sur les fleurs et dit :
- Tu as raison mon enfant, ces fleurs sont très belles mais elles ne dégagent aucun parfum. Je vais tout de même en cueillir quelques-unes et les rapporter à la maison.
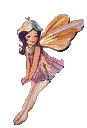
La prière de la jeune fille se répandit telle une bouffée de parfum dans les bois embrumés et complices, tout fleuris d’orchidées. Un mystère était en elles, le mystère de leur ressemblance avec des colombes, oiseaux de la déesse de l’Amour. Douées d’une singulière puissance occulte, une étrange clarté émanait d’elles et tout le bois sombre s’éclaira de leurs corolles translucides. Une bouffée de brise passa et emportant la senteur troublante des fleurs, diffusa aux alentours du pays l’appel de la petite fileuse de lin.
Il se trouva qu’au même moment, le roi et la reine du pays voisin s’apprêtaient à fêter leurs noces d’argent. Leur fils entendit parler de ces fleurs merveilleuses, et comme il souhaitait offrir une chose rare à ses parents, il prit la résolution de se rendre dans la contrée où elles poussaient.

Il y avait déjà des heures que le prince chevauchait dans le clair-obscur de la haute et profonde forêt de chênes où les pas de son cheval ne faisaient aucun bruit. Et comme il se penchait en avant pour mieux fouiller du regard le sol entre les nœuds des racines aux pieds des chênes, une forme svelte de jeune fille apparaissait un peu en-dessous de lui. Une étoffe pourpre flottait sur ses reins, lui moulant la taille, et maintenant qu’il s’était rapproché, le prince admirait ses chevaux d’un blond très pâle couronnés d’orchidées et flottant en nappe autour d’elle.
« Ah » songea le prince, « je préfère cette apparition féerique à toutes les fleurs, fussent-elles rares et précieuses, car elle est l’incarnation de la fleur légendaire, inconnue fleur de rêve de cette forêt. Je vais la rapporter à mes parents en guise de cadeau ». Et il dit à la belle :
- Dis-moi, blonde enfant, es-tu de nature humaine ? Ne serais-tu pas plutôt la reine des fées qui tiennent cour en cette forêt ?
- Comme toi, répondit la jeune fille, je suis de nature humaine, aucune fée ne se tient devant toi. A l’orée de la forêt s’élève la chaumière de mes parents. Mais toi mon prince, je te connais pour t’avoir vu en rêve.
- Quand je me reposais dans ma chambre baignée de clair de lune, la tête appuyée sur les coussins de soie bleue de mon lit, je voyais en rêve ton corps, souple tige de fleur dont le délicieux calice modelé comme un visage souriait à mesure que je me penchais vers lui. Viens douce orchidée, tu seras ma princesse.
La jeune fille se laissa prendre sous les aisselles et mettre en selle. Ensemble, ils chevauchèrent à travers la forêt ensoleillée et odorante, fleurie d’orchidées pourpres qui toutes avaient baissé leur petite tête, approuvant le choix du prince. Des formes blanches se pressaient en cercles autour d’eux avec un froissement d’ailes et de petits cris, et le prince reconnut les elfes.

Lorsque le prince épousa la jeune fille, les elfes lui tressèrent la plus belle couronne d’orchidées qu’une mariée eût portée. Depuis lors, l’orchidée est une fleur royale et il en existe des variétés qui valent de l’or.


Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 La Grande Tulipe
La Grande Tulipe
Il y a bien longtemps, vivait en Angleterre, dans le comté du Devonshire, une gentille vieille dame que les enfants du village, en raison de la couleur de ses cheveux, appelaient « Mamie Grise ».
Elle habitait une chaumière entourée d’un grand jardin de fleurs toujours bien soigné. Tôt le matin, appuyée sur ses béquilles, elle allait en claudicant, étendre le linge de ses petits-enfants sur des branches d’arbustes pour le faire sécher. La rosée tombant alors sur les petits vêtements les blanchissait en leur donnant l’éclat pur des pétales de fleurs sous les rayons chauds du soleil levant.
 En ces temps-là, les tulipes étaient les plus grandes fleurs que l’on pût trouver, et elles étaient toutes blanches, blanches comme la plus délicate et la plus fine des soieries.
En ces temps-là, les tulipes étaient les plus grandes fleurs que l’on pût trouver, et elles étaient toutes blanches, blanches comme la plus délicate et la plus fine des soieries.
La nuit venue, de jeunes elfes, volant de tulipe en tulipe, examinaient leurs calices avant d’y coucher leurs petits pour les laisser s’endormir, bercés par une douce brise.
Or, il arriva une nuit que mamie sortît de sa chaumière pour admirer le jardin baigné de clair de lune. Quelle ne fut pas sa surprise d’apercevoir soudain, à côté de la fontaine aux eaux cristallines, de grandes tulipes s’ouvrir laissant entrevoir dans leurs calices de nombreux bébés d’elfes endormis. « Mes doux chéris ! » s’écria la vielle dame toute émue, « Que vous êtes mignons, vous me rappelez mes petits-enfants ! Comme je suis heureuse que ces tulipes vous soient si agréablement utiles ! »
Tôt le lendemain matin, avant même que les gouttelettes de rosée ne viennent humecter la terre encore endormie, mamie se mit à planter des centaines d’oignons de tulipe en se disant : « Ainsi, de très nombreuses mamans elfes pourront bientôt disposer de berceaux pour leurs tout petits. Ils seront tous les bienvenus ! » Quelques semaines plus tard, les délicats berceaux étaient prêts, et les parents elfes avec leurs petits, quittèrent montagnes et vallées pour venir s’établir dans l’accueillant jardin de mamie.
Assis dans un arbre du jardin, les elfes tinrent conseil : « Nous devons faire quelque chose pour cette gentille mamie au cœur si bon ! » A ce moment précis, mamie Grise sortit de la chaumière appuyée sur ses béquilles, et péniblement elle gagna le jardin. Les elfes chantèrent :
« Aïe ! Aïe ! Aïe !
La voici, toute tordue
Le genou tout tordu,
Le dos tout tordu,
Sur ses béquilles, vacillante,
Elle va voir ses plantes ! »
Et ils ajoutèrent : « Il faut absolument que nous l’amenions à l’hôpital des elfes où toute douleur, toute affliction est soignée et guérie en douceur.
Alors le Conseil de santé des elfes se réunit et demanda : « Quand doit-elle monter sur la civière faite de branches de rose trémière ? »
Le médecin-chef, le « cerveau », répondit : « Quand j’aurai décidé de la méthode à appliquer pour soigner ce dos voûté, ce genou tordu, et le strabisme de la patiente ! »
Cette dernière affection était certainement la plus pénible de toutes pour mamie, car elle excitait l’hilarité de ses petits-enfants qui prenaient souvent un malin plaisir à s’amuser à se faire des grimaces pour se moquer de la loucherie de leur grand’mère.
Mais cela n’émouvait guère la vielle dame, car lorsqu’elle regardait les elfes bercer en chantant leurs tout petits pour les endormir, elle oubliait tout, et plus particulièrement toutes les choses embarrassantes et désagréables de la vie.
Ce jour-là, comme chaque matin, mamie descendit dans son jardin pour se pencher sur les calices de ses tulipes, lorsqu’elle fut brusquement immobilisée par un sévère lumbago, qui l’empêchait non seulement de se redresser, mais encore de bouger les pieds.
 L’heure était grave, aussi le Conseil de santé des elfes se réunit-il en toute hâte. « A présent, conclut-il, il devient urgent de faire transporter mamie à l’hôpital. Aussitôt dit, les elfes s’empressèrent d’assoir mamie sur une civière faite de branches de rose trémière pour la transporter dans leur clinique où elle fut prise en charge par des infirmières tout de blanc vêtues.
L’heure était grave, aussi le Conseil de santé des elfes se réunit-il en toute hâte. « A présent, conclut-il, il devient urgent de faire transporter mamie à l’hôpital. Aussitôt dit, les elfes s’empressèrent d’assoir mamie sur une civière faite de branches de rose trémière pour la transporter dans leur clinique où elle fut prise en charge par des infirmières tout de blanc vêtues.
Le médecin de garde fit allonger mamie sur une table et ordonna qu’on la couchât sur le ventre. Entre tous les instruments disposés sur un chariot, son choix se porta sur un rouleau à pâtisser en bois, et il se mit à le passer et à le repasser en douceur sur le dos de mamie, jusqu’à ce que son dos fût à nouveau bien droit.
- Regardez-moi cela ! dit mamie en riant. Qui aurait pu croire, qu’il fut possible de redresser le dos d’une dame aussi âgée que moi, et encore aussi rapidement ?
- Mais tu n’avais pas le dos voûté, lui répondit l’infirmière en chef, tu te l’étais seulement imaginé. Vous les humains, vous n’avez toujours pas compris qu’il est possible de vous débarrasser de tous vos maux, à condition d’arrêter d’y penser et de ne pas vous en préoccuper.
- Je sais, je sais, reprit la vielle dame, mais mes amies se moqueraient bien de moi si je leur parlais de cette sagesse !
- Eh bien tant pis pour elles ! elles garderont donc leur handicap ! répondit l’infirmière en chef.
- Et si je vous les amenais ? demanda timidement mamie.
- Cela n’aurait aucun sens, répondit le médecin, car la grande majorité des personnes tiennent à leurs maux. Et puis, si nous les en délivrions, elles n’auraient plus aucun sujet de conversation. Nous connaissons tout cela.
Tandis que les infirmières, sur l’ordre du médecin, retournèrent mamie sur le dos, tous les elfes à la vue de son genou tordu, s’écrièrent en chœur :
- Mais c’est terrible comme cette horrible chose là, la fait boiter ! Il faut changer cela !
A ce moment précis, le médecin-chef, le « cerveau » entra dans la salle. Les elfes étaient divisés à son sujet. Les uns préféraient le jeune médecin qui avait reçu mamie en urgence, qui portait les cheveux courts et qui était toujours rasé de très près, car disaient-ils, on ne peut faire confiance à un médecin dont la présentation laisse à désirer. Les autres, au contraire, préféraient le médecin-chef aux cheveux en broussaille et à la longue barbe hirsute car, estimaient-ils, un médecin bien coiffé et rasé de près ne pouvait être pris au sérieux.
Le médecin-chef trouva le cas de mamie très intéressant, mais bien compliqué !
- « Mamie, lui dit-il, ce genou ne peut être redressé que si tu t’imagines le tourner en le pliant dans le mauvais sens. »
Mamie ne put s’empêcher de rire à l’idée que sa claudication allait disparaître comme une ride est estompée par la gaité, car rire de tout cœur est le moyen le plus efficace pour atténuer rides et déformations.
Les elfes étaient heureux que mamie puissent retourner dans son jardin, mais elle louchait toujours. Et cette fois, mamie qui avait foi en la manière de guérir des elfes, suivit avec attention les instructions de leur ophtalmologue, un joyeux gnome dodu, qui portait sur son nez épaté des verres épais enchâssés dans une grande monture ronde qui lui conféraient un air de hibou.
 Lorsque les petits-enfants de mamie la revirent complètement changée, ils s’écrièrent en chœur :
Lorsque les petits-enfants de mamie la revirent complètement changée, ils s’écrièrent en chœur :
- Grand’mère a rajeuni de soixante-dix ans ! Son dos n’est plus voûté, son genou n’est plus tordu, et elle ne louche plus ! Non seulement ses cheveux ne paraissent plus gris, mais encore ils ont des reflets argentés, et sont devenus vigoureux, souples et brillants, alors qu’ils étaient si cassants et fragiles. Qui donc a pu accomplir ce miracle ?
Les voisins aussi s’en étonnèrent, mais ils se demandèrent surtout ce que pouvait bien faire mamie Grise la moitié de la nuit dans son jardin au milieu de ses chères tulipes. Ils ignoraient que mamie, penchée sur les berceaux floraux, s’occupait à donner confiance aux bébés elfes et à jouer avec eux.

Elle avait déjà planté des centaines et des centaines d’oignons de tulipe, et offert des centaines et des centaines de berceaux aux elfes. Aussi, les elfes décidèrent-ils de l’honorer particulièrement, et par une nuit de pleine lune, ils teintèrent de rayures roses, violettes et rouges, certaines tulipes à l’image de la robe que mamie portait souvent, et de jaune, la couleur du fichu dont elle se couvrait la gorge, mais ils conservèrent aussi quelques tulipes blanches rappelant la teinte éclatante de son corselet de lin fin. Et le matin suivant, quand mamie sortit de sa chaumière, elle eut la surprise et la joie de découvrir ses tulipes briller de toutes ses couleurs préférée. Elle invita ses petits-enfants et ses voisins, et tous s’étonnèrent fort de la magnificence des tulipes et de leurs riantes couleurs.
Cependant, la chaumière que mamie occupait, ne lui appartenait pas. Son propriétaire, Monsieur Pied-de-Lavande, était un homme fort riche mais terriblement avare. Et un matin, il se présenta chez mamie et il lui dit :
- Madame, vous m’êtes redevables à présent, de six mois de loyers ! Que signifie ce retard ? Je veux être payé !
Mamie épouvantée s’écria :
- Oh mon Dieu ! Avec les soucis que m’ont donnés mes tulipes, j’ai complètement oublié de payer les loyers. D’ailleurs, ces derniers mois, j’ai gagné si peu d’argent que je n’ai même pas de quoi régler les loyers.
- Et en quoi cela me regarde-t-il ? répondit Monsieur Pied-de-Lavande sur un ton fort discourtois. Vous avez la folie des tulipes, et ce n’est pas avec ces stupides fleurs que vous allez pouvoir me payer. Je ne vous dirais qu’une chose, si dans trois jours vous n’avez pas payé votre dette, je vous ferai expulser !
Mamie Grise était désespérée. Que pouvait-elle bien faire ? Rien, hélas ! Et elle se mit à rassembler les quelques affaires qu’elle possédait, et au petit matin du troisième jour, après avoir pris congé de ses chères tulipes, elle quitta la petite chaumière. Monsieur Pied-de-Lavande prit possession des lieux et s’y installa avec son épouse.
 Le couple décida d’aller visiter le jardin.
Le couple décida d’aller visiter le jardin.
- Regarde-moi ces stupides tulipes ! s’exclama Monsieur Pied-de-Lavande. A-t-on déjà vu pareille sottise ? Planter des fleurs qui n’ont aucune valeur, c’est à peine si elles sont un peu jolies. Cependant, les feuilles me rappellent les endives. Peut-être sont-elles mangeables en salade ? Dans ce cas, elles valent au moins quelque chose !
Mais les feuilles de tulipes avaient un goût amer et le couple Pied-de-Lavande se sentit au plus mal après avoir mangé sa salade.
- Nous allons arracher toutes ces tulipes avec leurs oignons, et planter à leur place des légumes et des salades, car le jardin est agréablement frais grâce à l’eau limpide et fraîche de la fontaine, expliqua Monsieur Pied-de-Lavande à sa femme.
Et ainsi fut fait. Mais brusquement, l’air du jardin devint humide et lourd, car les elfes pour se venger, avaient transformé la fraîche fontaine en source chaude et fumante.
Monsieur Pied-de-Lavande était furieux.
- Cette vieille est une sorcière ! cria-t-il rouge de colère. Elle a ensorcelé la fontaine !

Perchés sur leur arbre, les elfes méditaient la suite de leur vengeance. Et par une nuit de pleine lune, ils apparurent par petits groupes scintillants dans l’obscurité car certains étaient allés décrocher dans le ciel, de pétillantes étincelles d’étoile qu’ils jetèrent sur le chaume du toit qui s’enflamma aussitôt. Monsieur et Madame Pied-de-Lavande n’eurent que le temps de se sauver.
- Je n’ai vraiment pas de chance avec cette chaumière aux tulipes ! grommela l’homme avare, le mieux serait que je la rende à la vieille femme.
Et il prit le chemin de l’hospice où mamie Grise avait trouvé refuge et il lui proposa le marché suivant :
- Je ne peux rien faire de ce lopin de terre ensorcelé. Retourner-y, mais vous devrez me verser un loyer plus élevé !
Mamie secouant la tête lui demanda avec un large sourire :
- Avez-vous l’intention d’emménager ici avec votre femme ?
- Comment ? se fâcha l’homme riche. Moi, je devrais emménager dans un hospice réservé aux gens pauvres ?
- Certes, certes, vous n’y trouverez pas de gens fortunés, mais de bonne compagnie tout de même, lui répondit la vielle dame.
Excédé, Monsieur Pied-de-Lavande lui tourna le dos et s’en alla.
Pendant ce temps, les elfes avaient reconstruit la maisonnette. A présent, elle reposait sur des fondations de boutons de rose, les murs avaient été relevés avec des herbes sauvages, les tuiles du toit étaient constituées de magnifiques pétales de fleurs multicolores, et les vitres taillées dans le cristal de roche le plus fin. A l’intérieur, le sol était recouvert d’un tapis de pensées, un gros champignon servait de table, de plus petits découpés en forme de fauteuils étaient recouverts d’un tissu de satin élaboré à partir de pétales de fleurs brunes, comme seuls les elfes savent en tisser.

Et quand mamie rentra de l’hospice, toutes les clochettes des muguets du jardin se mirent à tinter pour lui souhaiter la bienvenue, les grillons jouèrent du violon, les cigales chantèrent et, joyeux, les elfes dansèrent, car le jardin ne tarderait pas à retrouver l’éclat passé de ses splendides tulipes.
Mamie Grise passa encore de très nombreuses années dans sa maisonnette de fleurs. Mais des tulipes aussi grandes et belles que les siennes, on ne pouvait en voir que dans son jardin, mais après elle, elles ne poussèrent plus jamais. De nos jours, les tulipes sont bien plus petites mais toujours aussi aimées et prisées.

Elle habitait une chaumière entourée d’un grand jardin de fleurs toujours bien soigné. Tôt le matin, appuyée sur ses béquilles, elle allait en claudicant, étendre le linge de ses petits-enfants sur des branches d’arbustes pour le faire sécher. La rosée tombant alors sur les petits vêtements les blanchissait en leur donnant l’éclat pur des pétales de fleurs sous les rayons chauds du soleil levant.

La nuit venue, de jeunes elfes, volant de tulipe en tulipe, examinaient leurs calices avant d’y coucher leurs petits pour les laisser s’endormir, bercés par une douce brise.
Or, il arriva une nuit que mamie sortît de sa chaumière pour admirer le jardin baigné de clair de lune. Quelle ne fut pas sa surprise d’apercevoir soudain, à côté de la fontaine aux eaux cristallines, de grandes tulipes s’ouvrir laissant entrevoir dans leurs calices de nombreux bébés d’elfes endormis. « Mes doux chéris ! » s’écria la vielle dame toute émue, « Que vous êtes mignons, vous me rappelez mes petits-enfants ! Comme je suis heureuse que ces tulipes vous soient si agréablement utiles ! »
Tôt le lendemain matin, avant même que les gouttelettes de rosée ne viennent humecter la terre encore endormie, mamie se mit à planter des centaines d’oignons de tulipe en se disant : « Ainsi, de très nombreuses mamans elfes pourront bientôt disposer de berceaux pour leurs tout petits. Ils seront tous les bienvenus ! » Quelques semaines plus tard, les délicats berceaux étaient prêts, et les parents elfes avec leurs petits, quittèrent montagnes et vallées pour venir s’établir dans l’accueillant jardin de mamie.
Assis dans un arbre du jardin, les elfes tinrent conseil : « Nous devons faire quelque chose pour cette gentille mamie au cœur si bon ! » A ce moment précis, mamie Grise sortit de la chaumière appuyée sur ses béquilles, et péniblement elle gagna le jardin. Les elfes chantèrent :
« Aïe ! Aïe ! Aïe !
La voici, toute tordue
Le genou tout tordu,
Le dos tout tordu,
Sur ses béquilles, vacillante,
Elle va voir ses plantes ! »
Et ils ajoutèrent : « Il faut absolument que nous l’amenions à l’hôpital des elfes où toute douleur, toute affliction est soignée et guérie en douceur.
Alors le Conseil de santé des elfes se réunit et demanda : « Quand doit-elle monter sur la civière faite de branches de rose trémière ? »
Le médecin-chef, le « cerveau », répondit : « Quand j’aurai décidé de la méthode à appliquer pour soigner ce dos voûté, ce genou tordu, et le strabisme de la patiente ! »
Cette dernière affection était certainement la plus pénible de toutes pour mamie, car elle excitait l’hilarité de ses petits-enfants qui prenaient souvent un malin plaisir à s’amuser à se faire des grimaces pour se moquer de la loucherie de leur grand’mère.
Mais cela n’émouvait guère la vielle dame, car lorsqu’elle regardait les elfes bercer en chantant leurs tout petits pour les endormir, elle oubliait tout, et plus particulièrement toutes les choses embarrassantes et désagréables de la vie.
Ce jour-là, comme chaque matin, mamie descendit dans son jardin pour se pencher sur les calices de ses tulipes, lorsqu’elle fut brusquement immobilisée par un sévère lumbago, qui l’empêchait non seulement de se redresser, mais encore de bouger les pieds.

Le médecin de garde fit allonger mamie sur une table et ordonna qu’on la couchât sur le ventre. Entre tous les instruments disposés sur un chariot, son choix se porta sur un rouleau à pâtisser en bois, et il se mit à le passer et à le repasser en douceur sur le dos de mamie, jusqu’à ce que son dos fût à nouveau bien droit.
- Regardez-moi cela ! dit mamie en riant. Qui aurait pu croire, qu’il fut possible de redresser le dos d’une dame aussi âgée que moi, et encore aussi rapidement ?
- Mais tu n’avais pas le dos voûté, lui répondit l’infirmière en chef, tu te l’étais seulement imaginé. Vous les humains, vous n’avez toujours pas compris qu’il est possible de vous débarrasser de tous vos maux, à condition d’arrêter d’y penser et de ne pas vous en préoccuper.
- Je sais, je sais, reprit la vielle dame, mais mes amies se moqueraient bien de moi si je leur parlais de cette sagesse !
- Eh bien tant pis pour elles ! elles garderont donc leur handicap ! répondit l’infirmière en chef.
- Et si je vous les amenais ? demanda timidement mamie.
- Cela n’aurait aucun sens, répondit le médecin, car la grande majorité des personnes tiennent à leurs maux. Et puis, si nous les en délivrions, elles n’auraient plus aucun sujet de conversation. Nous connaissons tout cela.
Tandis que les infirmières, sur l’ordre du médecin, retournèrent mamie sur le dos, tous les elfes à la vue de son genou tordu, s’écrièrent en chœur :
- Mais c’est terrible comme cette horrible chose là, la fait boiter ! Il faut changer cela !
A ce moment précis, le médecin-chef, le « cerveau » entra dans la salle. Les elfes étaient divisés à son sujet. Les uns préféraient le jeune médecin qui avait reçu mamie en urgence, qui portait les cheveux courts et qui était toujours rasé de très près, car disaient-ils, on ne peut faire confiance à un médecin dont la présentation laisse à désirer. Les autres, au contraire, préféraient le médecin-chef aux cheveux en broussaille et à la longue barbe hirsute car, estimaient-ils, un médecin bien coiffé et rasé de près ne pouvait être pris au sérieux.
Le médecin-chef trouva le cas de mamie très intéressant, mais bien compliqué !
- « Mamie, lui dit-il, ce genou ne peut être redressé que si tu t’imagines le tourner en le pliant dans le mauvais sens. »
Mamie ne put s’empêcher de rire à l’idée que sa claudication allait disparaître comme une ride est estompée par la gaité, car rire de tout cœur est le moyen le plus efficace pour atténuer rides et déformations.
Les elfes étaient heureux que mamie puissent retourner dans son jardin, mais elle louchait toujours. Et cette fois, mamie qui avait foi en la manière de guérir des elfes, suivit avec attention les instructions de leur ophtalmologue, un joyeux gnome dodu, qui portait sur son nez épaté des verres épais enchâssés dans une grande monture ronde qui lui conféraient un air de hibou.

- Grand’mère a rajeuni de soixante-dix ans ! Son dos n’est plus voûté, son genou n’est plus tordu, et elle ne louche plus ! Non seulement ses cheveux ne paraissent plus gris, mais encore ils ont des reflets argentés, et sont devenus vigoureux, souples et brillants, alors qu’ils étaient si cassants et fragiles. Qui donc a pu accomplir ce miracle ?
Les voisins aussi s’en étonnèrent, mais ils se demandèrent surtout ce que pouvait bien faire mamie Grise la moitié de la nuit dans son jardin au milieu de ses chères tulipes. Ils ignoraient que mamie, penchée sur les berceaux floraux, s’occupait à donner confiance aux bébés elfes et à jouer avec eux.

Elle avait déjà planté des centaines et des centaines d’oignons de tulipe, et offert des centaines et des centaines de berceaux aux elfes. Aussi, les elfes décidèrent-ils de l’honorer particulièrement, et par une nuit de pleine lune, ils teintèrent de rayures roses, violettes et rouges, certaines tulipes à l’image de la robe que mamie portait souvent, et de jaune, la couleur du fichu dont elle se couvrait la gorge, mais ils conservèrent aussi quelques tulipes blanches rappelant la teinte éclatante de son corselet de lin fin. Et le matin suivant, quand mamie sortit de sa chaumière, elle eut la surprise et la joie de découvrir ses tulipes briller de toutes ses couleurs préférée. Elle invita ses petits-enfants et ses voisins, et tous s’étonnèrent fort de la magnificence des tulipes et de leurs riantes couleurs.
Cependant, la chaumière que mamie occupait, ne lui appartenait pas. Son propriétaire, Monsieur Pied-de-Lavande, était un homme fort riche mais terriblement avare. Et un matin, il se présenta chez mamie et il lui dit :
- Madame, vous m’êtes redevables à présent, de six mois de loyers ! Que signifie ce retard ? Je veux être payé !
Mamie épouvantée s’écria :
- Oh mon Dieu ! Avec les soucis que m’ont donnés mes tulipes, j’ai complètement oublié de payer les loyers. D’ailleurs, ces derniers mois, j’ai gagné si peu d’argent que je n’ai même pas de quoi régler les loyers.
- Et en quoi cela me regarde-t-il ? répondit Monsieur Pied-de-Lavande sur un ton fort discourtois. Vous avez la folie des tulipes, et ce n’est pas avec ces stupides fleurs que vous allez pouvoir me payer. Je ne vous dirais qu’une chose, si dans trois jours vous n’avez pas payé votre dette, je vous ferai expulser !
Mamie Grise était désespérée. Que pouvait-elle bien faire ? Rien, hélas ! Et elle se mit à rassembler les quelques affaires qu’elle possédait, et au petit matin du troisième jour, après avoir pris congé de ses chères tulipes, elle quitta la petite chaumière. Monsieur Pied-de-Lavande prit possession des lieux et s’y installa avec son épouse.

- Regarde-moi ces stupides tulipes ! s’exclama Monsieur Pied-de-Lavande. A-t-on déjà vu pareille sottise ? Planter des fleurs qui n’ont aucune valeur, c’est à peine si elles sont un peu jolies. Cependant, les feuilles me rappellent les endives. Peut-être sont-elles mangeables en salade ? Dans ce cas, elles valent au moins quelque chose !
Mais les feuilles de tulipes avaient un goût amer et le couple Pied-de-Lavande se sentit au plus mal après avoir mangé sa salade.
- Nous allons arracher toutes ces tulipes avec leurs oignons, et planter à leur place des légumes et des salades, car le jardin est agréablement frais grâce à l’eau limpide et fraîche de la fontaine, expliqua Monsieur Pied-de-Lavande à sa femme.
Et ainsi fut fait. Mais brusquement, l’air du jardin devint humide et lourd, car les elfes pour se venger, avaient transformé la fraîche fontaine en source chaude et fumante.
Monsieur Pied-de-Lavande était furieux.
- Cette vieille est une sorcière ! cria-t-il rouge de colère. Elle a ensorcelé la fontaine !

Perchés sur leur arbre, les elfes méditaient la suite de leur vengeance. Et par une nuit de pleine lune, ils apparurent par petits groupes scintillants dans l’obscurité car certains étaient allés décrocher dans le ciel, de pétillantes étincelles d’étoile qu’ils jetèrent sur le chaume du toit qui s’enflamma aussitôt. Monsieur et Madame Pied-de-Lavande n’eurent que le temps de se sauver.
- Je n’ai vraiment pas de chance avec cette chaumière aux tulipes ! grommela l’homme avare, le mieux serait que je la rende à la vieille femme.
Et il prit le chemin de l’hospice où mamie Grise avait trouvé refuge et il lui proposa le marché suivant :
- Je ne peux rien faire de ce lopin de terre ensorcelé. Retourner-y, mais vous devrez me verser un loyer plus élevé !
Mamie secouant la tête lui demanda avec un large sourire :
- Avez-vous l’intention d’emménager ici avec votre femme ?
- Comment ? se fâcha l’homme riche. Moi, je devrais emménager dans un hospice réservé aux gens pauvres ?
- Certes, certes, vous n’y trouverez pas de gens fortunés, mais de bonne compagnie tout de même, lui répondit la vielle dame.
Excédé, Monsieur Pied-de-Lavande lui tourna le dos et s’en alla.
Pendant ce temps, les elfes avaient reconstruit la maisonnette. A présent, elle reposait sur des fondations de boutons de rose, les murs avaient été relevés avec des herbes sauvages, les tuiles du toit étaient constituées de magnifiques pétales de fleurs multicolores, et les vitres taillées dans le cristal de roche le plus fin. A l’intérieur, le sol était recouvert d’un tapis de pensées, un gros champignon servait de table, de plus petits découpés en forme de fauteuils étaient recouverts d’un tissu de satin élaboré à partir de pétales de fleurs brunes, comme seuls les elfes savent en tisser.

Et quand mamie rentra de l’hospice, toutes les clochettes des muguets du jardin se mirent à tinter pour lui souhaiter la bienvenue, les grillons jouèrent du violon, les cigales chantèrent et, joyeux, les elfes dansèrent, car le jardin ne tarderait pas à retrouver l’éclat passé de ses splendides tulipes.
Mamie Grise passa encore de très nombreuses années dans sa maisonnette de fleurs. Mais des tulipes aussi grandes et belles que les siennes, on ne pouvait en voir que dans son jardin, mais après elle, elles ne poussèrent plus jamais. De nos jours, les tulipes sont bien plus petites mais toujours aussi aimées et prisées.

Dernière édition par Freya le Mer 21 Aoû 2013 - 14:04, édité 1 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 La Fleur de Cerisier
La Fleur de Cerisier
Il y a des milliers d’années, régnait sur le Japon un Empereur puissant qui administrait son pays de façon vertueuse et en retour, son peuple l’aimait et l’honorait.
Pour la grande fête du printemps organisée chaque année au moment de l’éclosion des fleurs de cerisiers, le Mikado, comme l’appelaient ses sujets, entouré des plus hauts dignitaires de sa cour, montait à bord de la jonque impériale. Alors, dans un rythme lent et régulier, les soixante rames du navire se levaient en cadence pour s’abattre lourdement sur l’onde et remonter ruisselantes dans un bruit de cascade. Le navire quittait alors sa darse ombragée pour glisser doucement sur les eaux du fleuve à l’ombre des cerisiers fleuris de ses rives. De nombreuses petites embarcations de jonc suivaient la jonque dorée dans son sillage. Sur les berges, le peuple se bousculait pour voir passer la jonque dorée. Il était heureux du retour de la belle saison, il jubilait et avant de boire dans de petites coupes laquées une forte boisson fabriquée à base de bière de riz, il les élevait vers les cerisiers.

Ce printemps-là, l’Empereur, comme chaque année, leva lui aussi sa coupe laquée vers les arbres pour boire à une bonne récolte de cerises. Il passait sous un cerisier luxuriant lorsqu’une brise légère et fraîche vint tourmenter les branches des arbres, et la neige des cerisiers alla blanchir les épaules et la coiffe du monarque. Quelques pétales tombèrent même dans la coupe de l’Empereur qui trouva le saké bien plus doux et plus suave que les fois précédentes.
Année après année, lors de cette fameuse fête des cerisiers, on se racontait une ancienne anecdote. Un matin, deux hommes âgés grimpèrent sur le fameux cerisier qui osa laisser choir quelques-uns de ses pétales dans la coupe de saké du Mikado. Pendant que l’un des deux hommes qui avait posé une hache bien affûtée au pied de l’arbre, lui demanda : « Cerisier refleuriras-tu aussi abondamment l’année prochaine ? » l’autre vieillard sénile montait dans les branches les plus hautes du cerisier. L’arbre répondit : « Oui, je serai tout aussi luxuriant ! » Et les deux vieillards s’imaginèrent que l’esprit de l’arbre avait compris leur avertissement, et craignant de se faire abattre, il leur avait obéi.
Cette petite histoire plaisait tellement aux gens que de nombreuses personnes ne cessaient de la répéter à qui voulait bien l’entendre. Et jusqu’à nos jours, les habitants du pays du Soleil Levant, au moment du premier fleurissement des cerisiers, descendent les cours d’eau, et boivent le saké en élevant leurs coupes à leur dieu préféré, Yamato Damashi.

Le Mikado avait une fille du nom de Tsuya. La princesse était fort éprise d’un noble et courageux samouraï – c’est ainsi que les Japonais appellent leurs chevaliers – et elle pensait être aimée en retour par le beau Chikara, car il lui avait promis de l’épouser avant la prochaine pleine lune.
En son for intérieur, elle se réjouissait d’avoir su gagner le cœur de l’excellent jeune homme. Fille sage et obéissante, elle obtint sans difficulté le consentement de ses parents bien-aimés qui lui avaient toujours enseigné qu’un bon fils arrivé à l’âge adulte, fera un bon conjoint. Forte de cette conviction, mais également de l’exemple de son père qui fut, lui aussi, un bon fils qui honora ses parents durant toute leur longue vie, elle supposa que les dieux ne pouvaient que répandre leurs bienfaits sur elle et sur Chikara. Au Japon, dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à être reconnaissants en premier lieu à leur pays, et en second lieu à leurs parents.
Et quand la princesse obtint de ses parents l’accord d’épouser Chikara, elle en informa aussitôt ses proches et les invita même à lui rendre visite. Avec sa mère, elle organisa les festivités pour célébrer l’événement. Au Japon comme dans le reste du monde, toutes les jeunes filles du monde rêvent de cette journée de fiançailles, promesse d’un prochain mariage.

Mais le croissant de la lune montante augmentait, s’arrondissait, et finalement disparaissait complètement, avant de réapparaître et disparaître maintes et maintes fois, mais de Chikara son fiancé, aucune nouvelle.
La pauvre princesse pleurait et priait les mânes de ses ancêtres, mais aucune information au sujet du jeune samouraï ne parvenait au palais. Et finalement, Tsuya, maudit le jour où elle rencontra le courageux mais infidèle Chikara.
« Chikara est indigne de tes pensées ! » dit un jour l’Impératrice à sa fille. La princesse se souvint alors de son regard ensorceleur, de son visage angélique, de sa svelte silhouette de gazelle, de la simplicité de sa personne, et de ses paroles douces comme le miel.
Avec un profond soupir, elle répondit à sa mère :
- Oh, honorable mère, j’ai bien essayé d’oublier cet homme infidèle. Mais seules les images particulièrement douloureuses de ce merveilleux amour, me viennent à l’esprit.
- Ma chère fille, reprit l’Impératrice, le cœur de ton père saigne. Les nombreuses fêtes printanières devraient te distraire, tes lèvres si douces sourire, et ton pas chancèle comme si tu n’appartenais plus à notre monde.
- Maman, ma chère maman, je ferai tout pour ne plus vous donner de souci à toi et à mon père. Mais tu sais bien à quel point les souvenirs peuvent être douloureux. Les rêves s’élèvent, nous enveloppent comme par magie, nous poursuivent où que nous allions, sans que nous puissions les bannir ou les conjurer.
- Et pourtant, mon enfant, je suis affligée de voir à quel point ton cœur saigne.
- Honorable mère, j’ai entendu dire que seul l’amour pouvait guérir l’amour. Dois-je prier les dieux pour qu’ils distillent un baume sur mon cœur ?
- Et si Chikara devait ne jamais revenir ?
- Alors mère, j’aimerais mieux mourir.
- Tu n’as pas le droit de parler ainsi ! s’écria l’Impératrice, je vais lever les bras au ciel et prier les dieux pour que l’amour de la patrie évince celui d’un homme. Tu sais que nous sommes en guerre. Notre peuple, notre pays ont besoin de nous. Tu es encore bien jeune, mais tu peux servir ton pays, en soignant les guerriers blessés et en apportant aide et confiance aux mourants.
- Oh ! Mère, qu’est-ce que l’amour du peuple et de la patrie, comparé aux sentiments qu’un homme et une jeune fille doivent pouvoir ressentir ?
La mère de Tsuya réfléchit, puis elle lui dit :
- Va donc voir l’Empereur, ton père. Il t’expliquera comment l’amour peut guérir l’amour, parce que tes paroles sont peut-être pleines de sagesse, mais leur appréciation te fait défaut.

Traînant les pieds, Tsuya prit le chemin du pavillon de son père. Le Mikado était assis sur un trône doré au siège recouvert de soie pourpre, et au dossier incrusté d’une fleur de chrysanthème en nacre.
Elle s’agenouilla devant le trône et se courba humblement devant le monarque.
- Que se passe-t-il, ma fille ? demanda l’Empereur avec bienveillance. De quelle peine souffres-tu mon enfant ?
- Majesté et cher père, répondit la princesse, ma mère m’envoie afin que je te pose une question.
- Mais parle, ma douce enfant. Je répondrai à ta question avec toute la sagesse que j’ai acquise dans ce monde depuis mon enfance. Mais que signifie cette ombre dans ton regard et ce pli si douloureux sur ton beau front ?
- Majesté, père, balbutia Tsuya en se blottissant comme un chaton contre le trône, comment l’amour peut-il guérir l’amour ?
L’empereur s’absorba dans de profondes réflexions puis, regardant sa fille, il lui dit :
- Il y a bien longtemps, je me consumais d’amour pour une belle jeune fille qui devint plus tard ta mère. Mais jadis tout comme de nos jours, la guerre faisait rage, parce que les humains ne savent pas s’apprécier.
- Et quand les humains sauront-ils s’aimer ?
- Le jour où ils auront de l’estime pour la vie de leur prochain plutôt que de ne penser qu’à la manière de les anéantir, car nous chérissons et protégeons ceux que nous aimons. Donc mon enfant, j’aimais celle qui, aujourd’hui, est ta mère. Et le temps me paraissait si court, car les heures heureuses s’envolaient à la vitesse d’une flèche ! Elle était comme toi, telle une fleur printanière, une svelte et belle jeune fille. Je lui avouais mes sentiments à son égard et elle m’aima en retour.
- Et, tu l’épousas tout de suite ?
- Non, car comme je viens de te le dire, nous étions en guerre. Et je me souviens comme si cela s’était passé hier, du moment où je suis allé trouver mon père pour lui faire part de ma décision d’épouser celle que j’aimais et encore avant la prochaine pleine lune. Et mon père me répondit : « Fils, ta patrie passe avant ton amour. Tu dois partir pour le front et oublier l’élue de ton cœur. Et quand la paix règnera à nouveau, tu pourras penser à épouser ta bien-aimée. »
La jeune princesse commençait à comprendre.
L’Empereur poursuivit :
- Mais notre amour était si grand et si fort, que nous avions décidé de nous enfuir pour nous marier. Ceci se passait dans les environs proches d’une terrible et sanglante bataille où beaucoup de nos frères et pères furent blessés voire tués, et nombre d’entre eux furent faits prisonniers et déportés. Oubliant celle que j’aimais, j’entrais dans une colère noire et je me jetais corps et âme dans la guerre. Durant les jours terribles qui suivirent ce jour funeste, je n’avais qu’un seul objectif, qu’une seule volonté, me tenir aux côtés de mon pays, sauver mon peuple, et j’en oubliais mon corps, mon amour, et mon âme. Des semaines et des mois durant je me battais épaule contre épaule aux côtés de mes courageux camarades, jusqu’à ce qu’enfin, l’ennemi fut subjugué. Enfin, je pus rentrer chez moi, et mon cœur s’ouvrit à nouveau à l’amour pour celle que j’avais purement et simplement oubliée, et ce fut à ce moment-là que j’appris à aimer réellement ma patrie, et à reconnaître que je n’avais fait que prendre en considération mon propre droit. La paix et le calme revenus, le réconfort des repas préparés par nos fidèles domestiques, et la douce présence de mon épouse, m’ont rendu pleinement heureux, d’autant plus que j’avais retrouvé celle que je pensais avoir perdue. A cela, vint s’ajouter l’attention et l’admiration de ma famille et de tous les hommes que par mon courage j’ai pu sauver grâce à mon abnégation acquise dans le combat pour sauver notre patrie.
- Mon père, penses-tu que pour des raisons similaires, Chikara n’a plus donné de ses nouvelles ?
- Peut-être bien, mon enfant, car il est bien connu que tous les événements sur terre se répètent. Et ainsi, tu as, toi aussi, un destin à vivre, et qui semble être bien identique à celui de ta mère. Attend donc patiemment, le temps finit toujours par répondre à toutes les questions, de fidélité, de silences si longs et si tristes.
Les mois passèrent, et aucun message, aucune nouvelle de Chikara ne parvenait au palais. Et pour finir, la princesse perdit patience, et elle ne voulut plus attendre indéfiniment une hypothétique dépêche de son fiancé, convaincue qu’il l’avait oubliée, et elle fit fi de l’avis et des paroles de son père.
La vieille nourrice de la princesse lui raconta devant une cave à moitié effondrée, que la porte devant laquelle elles se trouvaient, qui était en bois hickory extrêmement dur, fut fabriquée pour la maison d’une terrible sorcière, capable de faits tout simplement étranges et merveilleux. Tsuya souhaita aussitôt rencontrer la sorcière pour lui demander son aide.
 Tsuya ira-t-elle vraiment voir la terrible sorcière ? Les charmes de cette dernière, ne risquent-ils pas de mettre en danger la vie de la princesse ou celle de son fiancé ? Ou bien, Tsuya recevra-t-elle enfin des nouvelles du jeune samouraï ? Nous le saurons la semaine prochaine.
Tsuya ira-t-elle vraiment voir la terrible sorcière ? Les charmes de cette dernière, ne risquent-ils pas de mettre en danger la vie de la princesse ou celle de son fiancé ? Ou bien, Tsuya recevra-t-elle enfin des nouvelles du jeune samouraï ? Nous le saurons la semaine prochaine.
Pour la grande fête du printemps organisée chaque année au moment de l’éclosion des fleurs de cerisiers, le Mikado, comme l’appelaient ses sujets, entouré des plus hauts dignitaires de sa cour, montait à bord de la jonque impériale. Alors, dans un rythme lent et régulier, les soixante rames du navire se levaient en cadence pour s’abattre lourdement sur l’onde et remonter ruisselantes dans un bruit de cascade. Le navire quittait alors sa darse ombragée pour glisser doucement sur les eaux du fleuve à l’ombre des cerisiers fleuris de ses rives. De nombreuses petites embarcations de jonc suivaient la jonque dorée dans son sillage. Sur les berges, le peuple se bousculait pour voir passer la jonque dorée. Il était heureux du retour de la belle saison, il jubilait et avant de boire dans de petites coupes laquées une forte boisson fabriquée à base de bière de riz, il les élevait vers les cerisiers.

Ce printemps-là, l’Empereur, comme chaque année, leva lui aussi sa coupe laquée vers les arbres pour boire à une bonne récolte de cerises. Il passait sous un cerisier luxuriant lorsqu’une brise légère et fraîche vint tourmenter les branches des arbres, et la neige des cerisiers alla blanchir les épaules et la coiffe du monarque. Quelques pétales tombèrent même dans la coupe de l’Empereur qui trouva le saké bien plus doux et plus suave que les fois précédentes.
Année après année, lors de cette fameuse fête des cerisiers, on se racontait une ancienne anecdote. Un matin, deux hommes âgés grimpèrent sur le fameux cerisier qui osa laisser choir quelques-uns de ses pétales dans la coupe de saké du Mikado. Pendant que l’un des deux hommes qui avait posé une hache bien affûtée au pied de l’arbre, lui demanda : « Cerisier refleuriras-tu aussi abondamment l’année prochaine ? » l’autre vieillard sénile montait dans les branches les plus hautes du cerisier. L’arbre répondit : « Oui, je serai tout aussi luxuriant ! » Et les deux vieillards s’imaginèrent que l’esprit de l’arbre avait compris leur avertissement, et craignant de se faire abattre, il leur avait obéi.
Cette petite histoire plaisait tellement aux gens que de nombreuses personnes ne cessaient de la répéter à qui voulait bien l’entendre. Et jusqu’à nos jours, les habitants du pays du Soleil Levant, au moment du premier fleurissement des cerisiers, descendent les cours d’eau, et boivent le saké en élevant leurs coupes à leur dieu préféré, Yamato Damashi.

Le Mikado avait une fille du nom de Tsuya. La princesse était fort éprise d’un noble et courageux samouraï – c’est ainsi que les Japonais appellent leurs chevaliers – et elle pensait être aimée en retour par le beau Chikara, car il lui avait promis de l’épouser avant la prochaine pleine lune.
En son for intérieur, elle se réjouissait d’avoir su gagner le cœur de l’excellent jeune homme. Fille sage et obéissante, elle obtint sans difficulté le consentement de ses parents bien-aimés qui lui avaient toujours enseigné qu’un bon fils arrivé à l’âge adulte, fera un bon conjoint. Forte de cette conviction, mais également de l’exemple de son père qui fut, lui aussi, un bon fils qui honora ses parents durant toute leur longue vie, elle supposa que les dieux ne pouvaient que répandre leurs bienfaits sur elle et sur Chikara. Au Japon, dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à être reconnaissants en premier lieu à leur pays, et en second lieu à leurs parents.
Et quand la princesse obtint de ses parents l’accord d’épouser Chikara, elle en informa aussitôt ses proches et les invita même à lui rendre visite. Avec sa mère, elle organisa les festivités pour célébrer l’événement. Au Japon comme dans le reste du monde, toutes les jeunes filles du monde rêvent de cette journée de fiançailles, promesse d’un prochain mariage.

Mais le croissant de la lune montante augmentait, s’arrondissait, et finalement disparaissait complètement, avant de réapparaître et disparaître maintes et maintes fois, mais de Chikara son fiancé, aucune nouvelle.
La pauvre princesse pleurait et priait les mânes de ses ancêtres, mais aucune information au sujet du jeune samouraï ne parvenait au palais. Et finalement, Tsuya, maudit le jour où elle rencontra le courageux mais infidèle Chikara.
« Chikara est indigne de tes pensées ! » dit un jour l’Impératrice à sa fille. La princesse se souvint alors de son regard ensorceleur, de son visage angélique, de sa svelte silhouette de gazelle, de la simplicité de sa personne, et de ses paroles douces comme le miel.
Avec un profond soupir, elle répondit à sa mère :
- Oh, honorable mère, j’ai bien essayé d’oublier cet homme infidèle. Mais seules les images particulièrement douloureuses de ce merveilleux amour, me viennent à l’esprit.
- Ma chère fille, reprit l’Impératrice, le cœur de ton père saigne. Les nombreuses fêtes printanières devraient te distraire, tes lèvres si douces sourire, et ton pas chancèle comme si tu n’appartenais plus à notre monde.
- Maman, ma chère maman, je ferai tout pour ne plus vous donner de souci à toi et à mon père. Mais tu sais bien à quel point les souvenirs peuvent être douloureux. Les rêves s’élèvent, nous enveloppent comme par magie, nous poursuivent où que nous allions, sans que nous puissions les bannir ou les conjurer.
- Et pourtant, mon enfant, je suis affligée de voir à quel point ton cœur saigne.
- Honorable mère, j’ai entendu dire que seul l’amour pouvait guérir l’amour. Dois-je prier les dieux pour qu’ils distillent un baume sur mon cœur ?
- Et si Chikara devait ne jamais revenir ?
- Alors mère, j’aimerais mieux mourir.
- Tu n’as pas le droit de parler ainsi ! s’écria l’Impératrice, je vais lever les bras au ciel et prier les dieux pour que l’amour de la patrie évince celui d’un homme. Tu sais que nous sommes en guerre. Notre peuple, notre pays ont besoin de nous. Tu es encore bien jeune, mais tu peux servir ton pays, en soignant les guerriers blessés et en apportant aide et confiance aux mourants.
- Oh ! Mère, qu’est-ce que l’amour du peuple et de la patrie, comparé aux sentiments qu’un homme et une jeune fille doivent pouvoir ressentir ?
La mère de Tsuya réfléchit, puis elle lui dit :
- Va donc voir l’Empereur, ton père. Il t’expliquera comment l’amour peut guérir l’amour, parce que tes paroles sont peut-être pleines de sagesse, mais leur appréciation te fait défaut.

Traînant les pieds, Tsuya prit le chemin du pavillon de son père. Le Mikado était assis sur un trône doré au siège recouvert de soie pourpre, et au dossier incrusté d’une fleur de chrysanthème en nacre.
Elle s’agenouilla devant le trône et se courba humblement devant le monarque.
- Que se passe-t-il, ma fille ? demanda l’Empereur avec bienveillance. De quelle peine souffres-tu mon enfant ?
- Majesté et cher père, répondit la princesse, ma mère m’envoie afin que je te pose une question.
- Mais parle, ma douce enfant. Je répondrai à ta question avec toute la sagesse que j’ai acquise dans ce monde depuis mon enfance. Mais que signifie cette ombre dans ton regard et ce pli si douloureux sur ton beau front ?
- Majesté, père, balbutia Tsuya en se blottissant comme un chaton contre le trône, comment l’amour peut-il guérir l’amour ?
L’empereur s’absorba dans de profondes réflexions puis, regardant sa fille, il lui dit :
- Il y a bien longtemps, je me consumais d’amour pour une belle jeune fille qui devint plus tard ta mère. Mais jadis tout comme de nos jours, la guerre faisait rage, parce que les humains ne savent pas s’apprécier.
- Et quand les humains sauront-ils s’aimer ?
- Le jour où ils auront de l’estime pour la vie de leur prochain plutôt que de ne penser qu’à la manière de les anéantir, car nous chérissons et protégeons ceux que nous aimons. Donc mon enfant, j’aimais celle qui, aujourd’hui, est ta mère. Et le temps me paraissait si court, car les heures heureuses s’envolaient à la vitesse d’une flèche ! Elle était comme toi, telle une fleur printanière, une svelte et belle jeune fille. Je lui avouais mes sentiments à son égard et elle m’aima en retour.
- Et, tu l’épousas tout de suite ?
- Non, car comme je viens de te le dire, nous étions en guerre. Et je me souviens comme si cela s’était passé hier, du moment où je suis allé trouver mon père pour lui faire part de ma décision d’épouser celle que j’aimais et encore avant la prochaine pleine lune. Et mon père me répondit : « Fils, ta patrie passe avant ton amour. Tu dois partir pour le front et oublier l’élue de ton cœur. Et quand la paix règnera à nouveau, tu pourras penser à épouser ta bien-aimée. »
La jeune princesse commençait à comprendre.
L’Empereur poursuivit :
- Mais notre amour était si grand et si fort, que nous avions décidé de nous enfuir pour nous marier. Ceci se passait dans les environs proches d’une terrible et sanglante bataille où beaucoup de nos frères et pères furent blessés voire tués, et nombre d’entre eux furent faits prisonniers et déportés. Oubliant celle que j’aimais, j’entrais dans une colère noire et je me jetais corps et âme dans la guerre. Durant les jours terribles qui suivirent ce jour funeste, je n’avais qu’un seul objectif, qu’une seule volonté, me tenir aux côtés de mon pays, sauver mon peuple, et j’en oubliais mon corps, mon amour, et mon âme. Des semaines et des mois durant je me battais épaule contre épaule aux côtés de mes courageux camarades, jusqu’à ce qu’enfin, l’ennemi fut subjugué. Enfin, je pus rentrer chez moi, et mon cœur s’ouvrit à nouveau à l’amour pour celle que j’avais purement et simplement oubliée, et ce fut à ce moment-là que j’appris à aimer réellement ma patrie, et à reconnaître que je n’avais fait que prendre en considération mon propre droit. La paix et le calme revenus, le réconfort des repas préparés par nos fidèles domestiques, et la douce présence de mon épouse, m’ont rendu pleinement heureux, d’autant plus que j’avais retrouvé celle que je pensais avoir perdue. A cela, vint s’ajouter l’attention et l’admiration de ma famille et de tous les hommes que par mon courage j’ai pu sauver grâce à mon abnégation acquise dans le combat pour sauver notre patrie.
- Mon père, penses-tu que pour des raisons similaires, Chikara n’a plus donné de ses nouvelles ?
- Peut-être bien, mon enfant, car il est bien connu que tous les événements sur terre se répètent. Et ainsi, tu as, toi aussi, un destin à vivre, et qui semble être bien identique à celui de ta mère. Attend donc patiemment, le temps finit toujours par répondre à toutes les questions, de fidélité, de silences si longs et si tristes.
Les mois passèrent, et aucun message, aucune nouvelle de Chikara ne parvenait au palais. Et pour finir, la princesse perdit patience, et elle ne voulut plus attendre indéfiniment une hypothétique dépêche de son fiancé, convaincue qu’il l’avait oubliée, et elle fit fi de l’avis et des paroles de son père.
La vieille nourrice de la princesse lui raconta devant une cave à moitié effondrée, que la porte devant laquelle elles se trouvaient, qui était en bois hickory extrêmement dur, fut fabriquée pour la maison d’une terrible sorcière, capable de faits tout simplement étranges et merveilleux. Tsuya souhaita aussitôt rencontrer la sorcière pour lui demander son aide.


Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Re: Contes Floraux du Jardin des Elfes
Re: Contes Floraux du Jardin des Elfes
La Fleur de Cerisier (suite et fin)
Depuis l’aube, la princesse Tsuya emmitouflée dans ses fourrures, cheminait bien loin du palais impérial, dans les bourrasques de neige et de vent glacial qui ployaient en hurlant les herbes sèches du bord du chemin, et faisaient bruire comme de la soie froissée, les immenses roseaux empanachés bordant les rizières, quand enfin, elle arriva en vue du village où habitait la sorcière.

Tsuya traversa le village engourdi par le froid, où seules des corneilles affamées, passant pardessus les toits des maisons, brisaient le morne silence par leurs croassements. La maison de la magicienne se trouvait un peu à l’écart du village. Tsuya frappa à la lourde porte bardée de fer. Par son entrebâillement, une femme âgée au visage ridé apparut.
- Que désires-tu jeune fille ? demanda-t-elle à la princesse.
- Grande magicienne, lui répondit Tsuya, laisse-moi entrer, s’il-te-plaît, laisse-moi entrer !
- Et pourquoi devrais-je te laisser pénétrer chez moi, étrange jeune fille ? demanda en souriant la sorcière.
- On m’a parlé de tes dons extraordinaires, et j’aimerais te demander conseil.
- Tiens, tiens ! grommela la sorcière, eh bien douce fleur, petit cœur de sucre, viens ! confie-moi ta grande peine.
- Laisse-moi d’abord entrer, le vent est coupant, et j’ai si froid ! supplia Tsuya.
La sorcière ouvrit la porte et la princesse se glissa à l’intérieur de la maison. L’endroit était humide et sombre et, pendant un instant, Tsuya ne put rien discerner. Mais quand ses yeux se furent adaptés à la pénombre du lieu, elle fut prise de frissons en apercevant toutes sortes d’animaux desséchés ou empaillés, et des objets bien plus étranges encore qui traînaient sur des tables ou des étagères, comme des crabes aux pinces tordues, de longilignes langoustines, des serpents aux couleurs vives, des pots en argile, des creusets, des hérissons, des rats, des poissons volants, des coquillages, des os d’animaux, des fauteuils aux coussins moisis, des chaises empoussiérées, et un chaudron bouillonnant.
- Ne t’effraie pas ma colombe dorée, dit la sorcière en grimaçant, les choses que tu peux voir là, ne sont que des cadeaux qui m’ont été offerts pour mes bons services. Alors, qu’attends-tu de moi ?
Tsuya frissonnait toujours, mais elle se ressaisit et répondit :
- Je te demande de maudire un samouraï infidèle qui m’abandonna voici bien des mois, sans un mot d’excuse, sans même un mot d’adieu !
Les lèvres minces et sèches de la sorcière s’entrouvrirent, laissant voir deux dents jaunâtres, les dernières de sa mâchoire supérieure.
- T’a-t-il vraiment juré un amour et une fidélité éternels ? demanda la magicienne.
- Bien sûr ! Et il m’a même couverte de cadeaux somptueux, et demandé officiellement ma main à mon père.
- Et ton père l’a-t-il tutoyé ensuite ?
- Mon père qui est un homme noble et bon, consentit de grand cœur à ce mariage.
- Hem, hem ! fit la sorcière en hochant la tête, voici qui ressemble bien aux hommes. Il était si certain de sa conquête, qu’il croyait pouvoir tout se permettre. Ceci est une chose grave, très grave !
- Tu es très méchante, et tu ne penses qu’à mal ! s’emporta Tsuya.
- Quand tu seras abreuvée de toutes les amertumes de cette vie, tu penseras comme moi ! grommela la magicienne.
- Veux-tu réaliser mon vœu ? demanda la princesse impatiente.
La vieille femme leva une de ses béquilles, et l’agitant en l’air, elle répondit :
- Pour maudire un samouraï, je dois rassembler toutes mes forces et toutes mes connaissances, car il est extrêmement difficile de vouer aux gémonies un si vaillant chevalier !
- Oh ! Mon samouraï n’est pas un homme très courageux ! fit Tsuya crispée en haussant les épaules avec mépris. Ou bien, appellerais-tu vaillant et chevaleresque, un homme qui, dédaigneusement, abandonna une pauvre jeune fille qui avait mis toute sa confiance en lui ?
- Au contraire, mon doux rossignol, je trouve cela particulièrement courageux d’abandonner une jeune fille que l’on aime ! Cependant, en réfléchissant bien, je pense que ton samouraï ne t’aime pas vraiment, et il a donc été facile pour lui de t’oublier. Mais dans ce cas, tu as bien raison de dire de lui qu’il n’est pas un homme très courageux.
- Alors il mérite une double peine ! répondit la princesse, les larmes aux yeux.
- Ce que tu me demandes, coûte fort cher ! dit la sorcière âpre au gain.
Tsuya retira une bourse garnie de pièces d’or, de dessous la veste qu’elle portait sur son kimono et, la tendant à la magicienne, elle lui dit :
- Tiens ! Prends-la, et fais tout ton possible pour que mon samouraï vienne se jeter à mes pieds, le cœur rongé de remords. Je veux aussi qu’il apprenne à connaître la souffrance que cause le mal d’amour !
- Bien, répondit la sorcière en hochant la tête, je vais réfléchir au moyen de réaliser ton vœu.
La magicienne s’assit sur un trépied, et murmura des paroles inintelligibles.
 Tsuya promena son regard sur le fond de la pièce. Un chat noir qu’elle avait pris pour une grosse araignée, se réchauffait blotti au pied d’un fourneau rempli de braise.
Tsuya promena son regard sur le fond de la pièce. Un chat noir qu’elle avait pris pour une grosse araignée, se réchauffait blotti au pied d’un fourneau rempli de braise.
Le temps s’écoulait, et Tsuya tremblait d’énervement et d’impatience.
Enfin, la sorcière se leva, étira ses bras osseux, et se mit à décrire au-dessus de sa tête des cercles et des formules magiques.
- Euréka ! s’écria-t-elle, à présent, je sais ! Le merveilleux et le coup de foudre, guérissent le mal d’amour !
Elle se rapprocha du fourneau, et dans le chaudron remplit d’une eau bouillonnante, elle laissa tomber une cuillerée de cire liquide. En durcissant, la cire prit la forme d’un samouraï. Précautionneusement, elle retira alors la figurine du chaudron et la montra à la princesse. La cuirasse était dorée, le visage frais, dispos et rose, et les lèvres écarlates. Elle accrocha aux épaules du samouraï un mantelet de soie verte, et glissa un petit sabre argenté dans son ceinturon.
- Prends l’image de ton samouraï, dit-elle à Tsuya, il t’a délaissée au temps du fleurissement des cerisiers, alors il te faudra attendre jusqu’au printemps. N’oublie pas ! aussitôt que les cerisiers commenceront à bourgeonner, tu prendras avec toi cette figurine de cire, et tu iras la clouer sur le tronc d’un cerisier. Mais, il te faudra utiliser des clous neufs et ce marteau-ci ! Et elle tendit à la princesse étonnée, un lourd marteau de bronze puis, elle déposa dans le creux de sa main, trois clous d’or. Sur ce, elle poursuivit : Je te prédis et je te promets, que ton fiancé, mort ou vif, se jettera à tes pieds, et ce avant même que tu auras enfoncé le troisième clou.
- Oh, comme je m’en réjouis ! dit Tsuya rayonnante de bonheur.
- Cependant, comme il s’agit là d’un enchantement spécial, très difficile à réaliser, il faudra, mon enfant, que tu m’apportes une deuxième bourse garnie de pièces d’or, précisa la sorcière.
Tsuya retira alors le collier d’or qui ornait son cou, ainsi que la précieuse bague qu’elle portait, et les remis à la magicienne avec ces mots :
- Prends, prends, grande magicienne ! et pour te prouver ma reconnaissance, je te ferai porter en sus, une autre bourse pleine d’or.
- Tu es une bonne fille, vraiment une bonne fille, répondit la sorcière souriante, tu verras, bientôt les premiers cerisiers refleuriront, et le bonheur de ton samouraï se flétrira très vite.
Emue, Tsuya prit congé de la sorcière.
Sur le chemin du retour, tout en marchant, la princesse contempla la poupée de cire. Sa figure ressemblait étrangement au visage de Chikara. Choquée, Tsuya rebroussa chemin.
La sorcière se tenait debout devant la porte de sa maison, et pressait sur son cœur la précieuse bourse d’or que Tsuya lui avait donnée. Le vent ébouriffait ses cheveux blancs, et soulevait les lambeaux de la veste jetée sur ses maigres épaules.
- Madame ! dit la princesse, je refuse d’opérer comme tu me l’a conseillé, car malgré tout, je ne souhaite pas de mal à Chikara, et si je venais à le perdre, je ne le supporterais pas.
- Jeune fille, répondit la sorcière d’une voix rauque, suis mon conseil, et tout ira bien. Ton fiancé n’est guère différent des autres hommes. Lorsqu’ils sont sûrs de notre amour, ils nous quittent.
- Je ne puis le croire !
- Et pourtant, il en est bien ainsi !
Perdue dans ses pensées, Tsuya rentra chez elle, où elle dissimula sous les nombreux coussins de soie de son lit, la poupée de cire, le marteau de bronze et les trois clous en or.
Quelques mois plus tard, Tsuya se promenait le long de l’estuaire du fleuve. Elle regardait passer les jonques de guerre et les navires marchands qui s’éloignaient pour disparaître à l’horizon, lorsque soudain, elle aperçut des bourgeons de fleurs de cerisiers sur le point d’éclore, darder le ciel bleu. Sans perdre un instant, elle rentra chez elle chercher la poupée de cire, le marteau de bronze et les trois clous d’or, et retourna à l’emplacement où elle avait aperçu les cerisiers sur le point de fleurir.

D’une main ferme, elle appuya la figurine de cire contre un tronc de cerisier, et planta le premier clou d’or qui transperça la poitrine de la poupée. Elle en fit de même avec le second clou d’or. Soudain, à sa grande surprise, Chikara blessé et perdant son sang, vint s’effondrer à ses pieds. Les yeux emplis d’amour, il la regarda d’un air suppliant, car ni le temps, ni l’éloignement, ni la malédiction de la magie, n’avaient pu tuer ce sentiment, cette sensation de chaleur, d’amour fidèle, qui un jour, prit racine dans le cœur des jeunes gens.
Chikara expliqua à Tsuya comment il fut mobilisé précipitamment, sans même qu’on lui laissât le temps de lui écrire un mot d’adieu, ou une lettre d’amour. Il raconta comment il dut défendre courageusement la patrie, et comment il s’était battu pour libérer bon nombre de ses amis prisonniers.
- Oh, mais c’est la même histoire que celle que mon père m’a racontée. Comment il gagna l’amour de ma chère mère, et comment il dut partir protéger l’Empereur et la patrie ! raconta Tsuya profondément bouleversée.
- Il en est ainsi, ma chérie ! dit Chikara en hochant la tête. Je t’aimais profondément et je t’aime toujours, mais l’amour du pays, de la patrie et de l’empereur prévalent sur la vie privée.
Tsuya lui tendit la main, mais Chikara s’évanouit, et de la blessure, son sang coulait ardent et généreux, se répandant sur les racines du cerisier en fleurs.
- Malheureuse que je suis, gémissait la princesse, c’est moi qui suis responsable de ta blessure mortelle !
Chikara rouvrit les yeux.
- Non, tu n’es pas responsable de ma blessure. Mon honneur et mon devoir, ma fidélité envers l’empereur, l’empire et mon amour pour toi, m’ont abattu.
Tsuya l’aida à se relever en le soutenant de ses bras blancs.
- Pardonne-moi, cher fiancé, pria-t-elle en pleurs, croyant que tu m’étais devenu infidèle, j’ai demandé à la sorcière d’appeler sa malédiction sur toi. La sorcière me donna une poupée de cire à ton image que voici, et que j’ai transpercée de deux clous pour l’épingler sur le tronc d’arbre.
- Ne crois pas les méchantes sorcières, dit dans un souffle le samouraï, je vais confondre l’art maléfique de la sorcière et vivre !
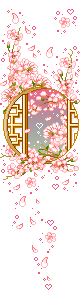 La princesse amena le samouraï blessé dans le pavillon de sa mère. Elles le soignèrent jusqu’à ce qu’il récupéra de sa blessure. Et quand les cerisiers refleurirent, le mariage des fiancés eut lieu.
La princesse amena le samouraï blessé dans le pavillon de sa mère. Elles le soignèrent jusqu’à ce qu’il récupéra de sa blessure. Et quand les cerisiers refleurirent, le mariage des fiancés eut lieu.
Sur le chemin du cortège nuptial, parmi les badauds ébahis qui se pressaient sur son parcours, se trouvait la sorcière. « Il me faut cette poupée de cire pour ma collection d’objets rares », murmura-t-elle, « car il est le premier homme honnête et fidèle, que je rencontre dans ma vie. »
Et quand la magicienne eut pensé cela, elle reconnut qu’il existe encore sur terre des amours sincères, ce qui la rendit heureuse.
Chikara fut traité en fils par l’Empereur et l’Impératrice, et comme tel, selon le droit japonais, il fut logé dans un pavillon du palais impérial.
Alors que le cortège nuptial s’apprêtait à passer les grilles du palais, la sorcière sortant de la foule, s’avança vers le jeune couple et leur dit :
- Pardonnez-moi, mes chers et jeunes amis, si je vous adresse ces quelques mots. Ecoutez les paroles d’une femme qui apprit trop et trop peu de choses au cours de sa longue vie. Avant que votre nouvelle vie ne commence, apprenez ce qu’est l’amour. L’amour débutant est comme un beau fleuve à la surface étincelante, mais maintenu entre ses rives, au cours du temps, il deviendra chaque jour plus profond.

Ce même printemps, le cerisier sur les racines duquel le sang du samouraï coula, se couvrit de fleurs aux délicates nuances de rose, c’est du moins ce que racontent les gens du peuple. Et ces cerisiers-là ne donnent pas de fruits, mais sont pour les Japonais des arbres sacrés, symboles des samouraïs, mais aussi de la vie lumineuse et belle, mais fragile et éphémère.

Depuis l’aube, la princesse Tsuya emmitouflée dans ses fourrures, cheminait bien loin du palais impérial, dans les bourrasques de neige et de vent glacial qui ployaient en hurlant les herbes sèches du bord du chemin, et faisaient bruire comme de la soie froissée, les immenses roseaux empanachés bordant les rizières, quand enfin, elle arriva en vue du village où habitait la sorcière.

- Que désires-tu jeune fille ? demanda-t-elle à la princesse.
- Grande magicienne, lui répondit Tsuya, laisse-moi entrer, s’il-te-plaît, laisse-moi entrer !
- Et pourquoi devrais-je te laisser pénétrer chez moi, étrange jeune fille ? demanda en souriant la sorcière.
- On m’a parlé de tes dons extraordinaires, et j’aimerais te demander conseil.
- Tiens, tiens ! grommela la sorcière, eh bien douce fleur, petit cœur de sucre, viens ! confie-moi ta grande peine.
- Laisse-moi d’abord entrer, le vent est coupant, et j’ai si froid ! supplia Tsuya.
La sorcière ouvrit la porte et la princesse se glissa à l’intérieur de la maison. L’endroit était humide et sombre et, pendant un instant, Tsuya ne put rien discerner. Mais quand ses yeux se furent adaptés à la pénombre du lieu, elle fut prise de frissons en apercevant toutes sortes d’animaux desséchés ou empaillés, et des objets bien plus étranges encore qui traînaient sur des tables ou des étagères, comme des crabes aux pinces tordues, de longilignes langoustines, des serpents aux couleurs vives, des pots en argile, des creusets, des hérissons, des rats, des poissons volants, des coquillages, des os d’animaux, des fauteuils aux coussins moisis, des chaises empoussiérées, et un chaudron bouillonnant.
- Ne t’effraie pas ma colombe dorée, dit la sorcière en grimaçant, les choses que tu peux voir là, ne sont que des cadeaux qui m’ont été offerts pour mes bons services. Alors, qu’attends-tu de moi ?
Tsuya frissonnait toujours, mais elle se ressaisit et répondit :
- Je te demande de maudire un samouraï infidèle qui m’abandonna voici bien des mois, sans un mot d’excuse, sans même un mot d’adieu !
Les lèvres minces et sèches de la sorcière s’entrouvrirent, laissant voir deux dents jaunâtres, les dernières de sa mâchoire supérieure.
- T’a-t-il vraiment juré un amour et une fidélité éternels ? demanda la magicienne.
- Bien sûr ! Et il m’a même couverte de cadeaux somptueux, et demandé officiellement ma main à mon père.
- Et ton père l’a-t-il tutoyé ensuite ?
- Mon père qui est un homme noble et bon, consentit de grand cœur à ce mariage.
- Hem, hem ! fit la sorcière en hochant la tête, voici qui ressemble bien aux hommes. Il était si certain de sa conquête, qu’il croyait pouvoir tout se permettre. Ceci est une chose grave, très grave !
- Tu es très méchante, et tu ne penses qu’à mal ! s’emporta Tsuya.
- Quand tu seras abreuvée de toutes les amertumes de cette vie, tu penseras comme moi ! grommela la magicienne.
- Veux-tu réaliser mon vœu ? demanda la princesse impatiente.
La vieille femme leva une de ses béquilles, et l’agitant en l’air, elle répondit :
- Pour maudire un samouraï, je dois rassembler toutes mes forces et toutes mes connaissances, car il est extrêmement difficile de vouer aux gémonies un si vaillant chevalier !
- Oh ! Mon samouraï n’est pas un homme très courageux ! fit Tsuya crispée en haussant les épaules avec mépris. Ou bien, appellerais-tu vaillant et chevaleresque, un homme qui, dédaigneusement, abandonna une pauvre jeune fille qui avait mis toute sa confiance en lui ?
- Au contraire, mon doux rossignol, je trouve cela particulièrement courageux d’abandonner une jeune fille que l’on aime ! Cependant, en réfléchissant bien, je pense que ton samouraï ne t’aime pas vraiment, et il a donc été facile pour lui de t’oublier. Mais dans ce cas, tu as bien raison de dire de lui qu’il n’est pas un homme très courageux.
- Alors il mérite une double peine ! répondit la princesse, les larmes aux yeux.
- Ce que tu me demandes, coûte fort cher ! dit la sorcière âpre au gain.
Tsuya retira une bourse garnie de pièces d’or, de dessous la veste qu’elle portait sur son kimono et, la tendant à la magicienne, elle lui dit :
- Tiens ! Prends-la, et fais tout ton possible pour que mon samouraï vienne se jeter à mes pieds, le cœur rongé de remords. Je veux aussi qu’il apprenne à connaître la souffrance que cause le mal d’amour !
- Bien, répondit la sorcière en hochant la tête, je vais réfléchir au moyen de réaliser ton vœu.
La magicienne s’assit sur un trépied, et murmura des paroles inintelligibles.

Le temps s’écoulait, et Tsuya tremblait d’énervement et d’impatience.
Enfin, la sorcière se leva, étira ses bras osseux, et se mit à décrire au-dessus de sa tête des cercles et des formules magiques.
- Euréka ! s’écria-t-elle, à présent, je sais ! Le merveilleux et le coup de foudre, guérissent le mal d’amour !
Elle se rapprocha du fourneau, et dans le chaudron remplit d’une eau bouillonnante, elle laissa tomber une cuillerée de cire liquide. En durcissant, la cire prit la forme d’un samouraï. Précautionneusement, elle retira alors la figurine du chaudron et la montra à la princesse. La cuirasse était dorée, le visage frais, dispos et rose, et les lèvres écarlates. Elle accrocha aux épaules du samouraï un mantelet de soie verte, et glissa un petit sabre argenté dans son ceinturon.
- Prends l’image de ton samouraï, dit-elle à Tsuya, il t’a délaissée au temps du fleurissement des cerisiers, alors il te faudra attendre jusqu’au printemps. N’oublie pas ! aussitôt que les cerisiers commenceront à bourgeonner, tu prendras avec toi cette figurine de cire, et tu iras la clouer sur le tronc d’un cerisier. Mais, il te faudra utiliser des clous neufs et ce marteau-ci ! Et elle tendit à la princesse étonnée, un lourd marteau de bronze puis, elle déposa dans le creux de sa main, trois clous d’or. Sur ce, elle poursuivit : Je te prédis et je te promets, que ton fiancé, mort ou vif, se jettera à tes pieds, et ce avant même que tu auras enfoncé le troisième clou.
- Oh, comme je m’en réjouis ! dit Tsuya rayonnante de bonheur.
- Cependant, comme il s’agit là d’un enchantement spécial, très difficile à réaliser, il faudra, mon enfant, que tu m’apportes une deuxième bourse garnie de pièces d’or, précisa la sorcière.
Tsuya retira alors le collier d’or qui ornait son cou, ainsi que la précieuse bague qu’elle portait, et les remis à la magicienne avec ces mots :
- Prends, prends, grande magicienne ! et pour te prouver ma reconnaissance, je te ferai porter en sus, une autre bourse pleine d’or.
- Tu es une bonne fille, vraiment une bonne fille, répondit la sorcière souriante, tu verras, bientôt les premiers cerisiers refleuriront, et le bonheur de ton samouraï se flétrira très vite.
Emue, Tsuya prit congé de la sorcière.
Sur le chemin du retour, tout en marchant, la princesse contempla la poupée de cire. Sa figure ressemblait étrangement au visage de Chikara. Choquée, Tsuya rebroussa chemin.
La sorcière se tenait debout devant la porte de sa maison, et pressait sur son cœur la précieuse bourse d’or que Tsuya lui avait donnée. Le vent ébouriffait ses cheveux blancs, et soulevait les lambeaux de la veste jetée sur ses maigres épaules.
- Madame ! dit la princesse, je refuse d’opérer comme tu me l’a conseillé, car malgré tout, je ne souhaite pas de mal à Chikara, et si je venais à le perdre, je ne le supporterais pas.
- Jeune fille, répondit la sorcière d’une voix rauque, suis mon conseil, et tout ira bien. Ton fiancé n’est guère différent des autres hommes. Lorsqu’ils sont sûrs de notre amour, ils nous quittent.
- Je ne puis le croire !
- Et pourtant, il en est bien ainsi !
Perdue dans ses pensées, Tsuya rentra chez elle, où elle dissimula sous les nombreux coussins de soie de son lit, la poupée de cire, le marteau de bronze et les trois clous en or.
Quelques mois plus tard, Tsuya se promenait le long de l’estuaire du fleuve. Elle regardait passer les jonques de guerre et les navires marchands qui s’éloignaient pour disparaître à l’horizon, lorsque soudain, elle aperçut des bourgeons de fleurs de cerisiers sur le point d’éclore, darder le ciel bleu. Sans perdre un instant, elle rentra chez elle chercher la poupée de cire, le marteau de bronze et les trois clous d’or, et retourna à l’emplacement où elle avait aperçu les cerisiers sur le point de fleurir.

D’une main ferme, elle appuya la figurine de cire contre un tronc de cerisier, et planta le premier clou d’or qui transperça la poitrine de la poupée. Elle en fit de même avec le second clou d’or. Soudain, à sa grande surprise, Chikara blessé et perdant son sang, vint s’effondrer à ses pieds. Les yeux emplis d’amour, il la regarda d’un air suppliant, car ni le temps, ni l’éloignement, ni la malédiction de la magie, n’avaient pu tuer ce sentiment, cette sensation de chaleur, d’amour fidèle, qui un jour, prit racine dans le cœur des jeunes gens.
Chikara expliqua à Tsuya comment il fut mobilisé précipitamment, sans même qu’on lui laissât le temps de lui écrire un mot d’adieu, ou une lettre d’amour. Il raconta comment il dut défendre courageusement la patrie, et comment il s’était battu pour libérer bon nombre de ses amis prisonniers.
- Oh, mais c’est la même histoire que celle que mon père m’a racontée. Comment il gagna l’amour de ma chère mère, et comment il dut partir protéger l’Empereur et la patrie ! raconta Tsuya profondément bouleversée.
- Il en est ainsi, ma chérie ! dit Chikara en hochant la tête. Je t’aimais profondément et je t’aime toujours, mais l’amour du pays, de la patrie et de l’empereur prévalent sur la vie privée.
Tsuya lui tendit la main, mais Chikara s’évanouit, et de la blessure, son sang coulait ardent et généreux, se répandant sur les racines du cerisier en fleurs.
- Malheureuse que je suis, gémissait la princesse, c’est moi qui suis responsable de ta blessure mortelle !
Chikara rouvrit les yeux.
- Non, tu n’es pas responsable de ma blessure. Mon honneur et mon devoir, ma fidélité envers l’empereur, l’empire et mon amour pour toi, m’ont abattu.
Tsuya l’aida à se relever en le soutenant de ses bras blancs.
- Pardonne-moi, cher fiancé, pria-t-elle en pleurs, croyant que tu m’étais devenu infidèle, j’ai demandé à la sorcière d’appeler sa malédiction sur toi. La sorcière me donna une poupée de cire à ton image que voici, et que j’ai transpercée de deux clous pour l’épingler sur le tronc d’arbre.
- Ne crois pas les méchantes sorcières, dit dans un souffle le samouraï, je vais confondre l’art maléfique de la sorcière et vivre !
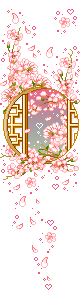
Sur le chemin du cortège nuptial, parmi les badauds ébahis qui se pressaient sur son parcours, se trouvait la sorcière. « Il me faut cette poupée de cire pour ma collection d’objets rares », murmura-t-elle, « car il est le premier homme honnête et fidèle, que je rencontre dans ma vie. »
Et quand la magicienne eut pensé cela, elle reconnut qu’il existe encore sur terre des amours sincères, ce qui la rendit heureuse.
Chikara fut traité en fils par l’Empereur et l’Impératrice, et comme tel, selon le droit japonais, il fut logé dans un pavillon du palais impérial.
Alors que le cortège nuptial s’apprêtait à passer les grilles du palais, la sorcière sortant de la foule, s’avança vers le jeune couple et leur dit :
- Pardonnez-moi, mes chers et jeunes amis, si je vous adresse ces quelques mots. Ecoutez les paroles d’une femme qui apprit trop et trop peu de choses au cours de sa longue vie. Avant que votre nouvelle vie ne commence, apprenez ce qu’est l’amour. L’amour débutant est comme un beau fleuve à la surface étincelante, mais maintenu entre ses rives, au cours du temps, il deviendra chaque jour plus profond.



Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 La Jonquille
La Jonquille
L’inoffensif petit peuple toujours joyeux des elfes, donnait une fête en l’honneur du printemps dans la profonde et mystérieuse forêt du château royal. Les nains, leurs amis, étaient de la fête. Des champignons au large chapeau, leur servaient de tables, et ils sirotaient de délicieuses boissons dans des calices de campanules et de jonquilles.
Sur une fleur d’hibiscus rose, siégeait Paillette d’Or, la petite princesse des elfes. Elle représentait sa maman, la reine, engagée professionnellement ailleurs.
 Le regard vague, la petite princesse songeait et soupirait, souriant tristement de temps à autre à la gaieté de ses invités, car elle se sentait terriblement seule. Son voisin de table avec lequel elle pouvait jouer et danser puisque ils étaient de même rang, lui manquait terriblement.
Le regard vague, la petite princesse songeait et soupirait, souriant tristement de temps à autre à la gaieté de ses invités, car elle se sentait terriblement seule. Son voisin de table avec lequel elle pouvait jouer et danser puisque ils étaient de même rang, lui manquait terriblement.
Dans les branches hautes des arbres, les oiseaux, ces merveilleux petits chanteurs aux plumes multicolores, entonnaient leurs gazouillis printaniers si ardemment attendus de tous.
Le vent courait sur la crête des chênes et faisait bruire les feuilles, tandis qu’au loin, retentissaient des sons de cors de chasse et des appels d’écuyers. Et dans la lumière crépusculaire, surgit un cortège haut en couleurs ; des chasseurs revêtus de costumes verts, des cavaliers à l’écu d’airain au coude et l’épée au fourreau, des garçonnets blonds sanglés dans d’étroits justaucorps de soie, le front cerclé d’or.
Et au milieu de ce cortège éblouissant, un prince, beau comme seuls peuvent l’être ceux des contes de fées, chevauchait un fier étalon blanc dont la crinière soyeuse flottait au vent.
Parvenu devant Paillette d’Or, le prince sauta à bas de sa monture, fit une profonde révérence et baisa aimablement la petite main princière.
- Tu arrives au bon moment, dit Paillette d’Or heureuse, prends place à côté de moi.
Elle tendit au prince sa propre coupe en signe de bienvenue.
- Personne n’a donc encore porté les lèvres à ta coupe d’or ? demanda le prince en souriant. Alors goûtons ensemble à cette délicieuse boisson.
La princesse accueillit de bon cœur la proposition du prince.
- D’où viens-tu ? lui demanda-t-elle, curieuse.
- Je viens d’un pays fort, fort lointain. J’ai surmonté mille dangers, mais à présent, je suis las de toutes les peines et de toutes les privations endurcies au cours de mes longues chevauchées, richement récompensées d’ailleurs, puisque tu m’invites à vider la coupe de l’amitié à tes côtés !
Il prit Paillette d’Or par la main, et ils se mêlèrent aux elfes et aux nains qui, trouvant la chose bien singulière, hochèrent la tête et s’en amusèrent cachés dans l’enchevêtrement des fougères naissantes et des primevères.

Tous dansèrent, tournèrent, tourbillonnèrent, s’entremêlèrent, buvant dans les gaies petites coupes, jusqu’à ce que la lune se couchât et que l’ululement de Chevêchette, le tout petit hibou, leur annonçât le matin nouveau.
Alors le prince quitta brusquement Paillette d’Or, prit la coupe d’or dans laquelle ils avaient bu la boisson de l’amitié, enfourcha son cheval et s’enfuit au galop. Mais avant qu’il n’atteignît la lisière de la forêt, la magnifique coupe d’or des elfes lui échappa des mains, roula sous les sabots de son cheval qui la piétina, et de la belle jonquille il ne resta plus qu’une pauvre fleur déchiquetée dont plus rien ne rappelait sa grâce et sa magnificence.

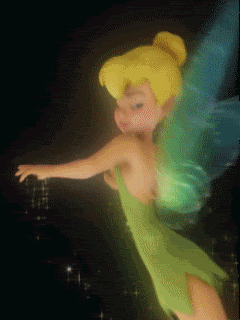 Sur un rayon de soleil, Paillette d’Or rejoignit le prince. En gémissant, elle lui dit :
Sur un rayon de soleil, Paillette d’Or rejoignit le prince. En gémissant, elle lui dit :
- Oh, comment as-tu pu agir ainsi avec notre coupe d’or de l’amitié !
Et elle ramassa la fleur, la pressa sur son cœur et tenta de lui redonner vie en l’aspergeant des gouttes d’eau fraîche d’une source proche, mais ce fut en vain. Ce qui est mort, reste mort et aucun amour ne peut y faire revenir le souffle de vie.
Tristement, la princesse retourna dans la forêt. Des larmes perlaient au coin de ses yeux et roulaient sur ses joues, et son cœur d’elfe se serrait, car elle savait que jamais le prince ne reviendrait, puisqu’il ne fut même pas capable de tenir jusqu’à l’aube, la promesse sacrée de ces quelques heures d’amitié !

Le lendemain, quand la brume crépusculaire envahit à nouveau la forêt, les elfes et les nains ressortirent de leurs maisonnettes de dessous la mousse, des creux dans les troncs d’arbres, des trous de souris, et des calices des fleurs. Entourant Paillette d’Or, ils lui dirent :
- Viens, gentille petite princesse, viens danser avec nous, sois heureuse et réjouis-toi de cette nuit secrète, car lorsqu’il commencera à faire jour, avant que le soleil ne se lève, nous devrons retourner nous cacher !
- Comment pourrais-je être enjouée et gaie, répondit Paillette d’Or en secouant tristement la tête. Comment pourrais-je danser et sauter alors qu’il a brisé ma coupe. J’entends tinter les clochettes des muguets, elles sonnent la fin de mon bonheur. Le prince a pris la fuite, pour aller courtiser une autre princesse !
Aussitôt, tous les elfes et tous les nains entourèrent doucement Paillette d’Or et cherchèrent à la consoler. Mais cela n’était pas du goût de la princesse car elle savait que la compassion ne faisait qu’adoucir la peine. Alors elle leur dit :
- Vous êtes prévenants avec moi, mais j’aimerais rester seule. On ne peut réfléchir et voir clair en soi, que lorsqu’on peut s’isoler pour se retrouver soi-même.

Sur ce, les elfes et les nains quittèrent la princesse.
« Par quoi pourrais-je commencer ? se demanda la princesse, car la décision que je vais prendre maintenant, engagera toute ma vie future. Le mieux que j’aie à faire est de ne plus penser à moi-même, alors la blessure de mon cœur se refermera ! » Sur ce, elle traversa la forêt silencieuse et atteignit une petite clairière au milieu de laquelle poussait un arum dont la haute tige verte était surmontée d’un grand calice blanc, à l’intérieur duquel se dressait un cierge d’un or éclatant. L’arum était empli de l’élixir de vie.
« J’ai trouvé ! se dit Paillette d’Or, je dois faire don de cet élixir de vie aux autres. En remplissant leurs coupes, je serai bénie par leur propre bonheur retrouvé. »

Et lorsqu’une fois encore, la nuit enveloppa de son voile de brume les forêts et les prairies, la princesse entra dans la ronde des danseurs et versa l’élixir de vie dans les coupes. Là-dessus, elle se fit vivement acclamer par les elfes qui aimaient tendrement leur petite princesse.
Sur ce, un gros triton à ventre de feu se faufila auprès de la princesse. Il était un méchant magicien ensorcelé. Jubilant, il lui chuchota à l’oreille : « Pourquoi te soucies-tu à ce point du bien-être des autres ? La vraie sagesse consiste à boire soi-même l’élixir de vie. »
« Le triton dit vrai, se dit Paillette d’Or, je suis vraiment stupide ! » Et elle saisit une jonquille et la plongea directement dans le calice de la fleur d’arum pour la remplir jusqu’au bord. Aussitôt, le lumineux flambeau d’or se rétrécit dans le cœur même de la fleur d’arum, et se fana pour devenir une vilaine et misérable chose terne. Horrifiée, Paillette d’Or, resta pétrifiée. « Oh ! Gémit-elle quand elle se fut ressaisie, comme j’ai été méchante ! Je ne dois pas boire moi-même de cet élixir de vie, mais le servir uniquement aux autres. Les êtres célestes voient tout et ils nous récompensent ou nous punissent selon nos œuvres ! »

Fatiguée et l’esprit torturé par les reproches qu’elle s’était faits, Paillette d’Or se retira à l’écart de la fête pour se coucher dans la mousse moelleuse où elle ne tarda pas à fermer les yeux. Soudain, une voix douce et aimante lui chuchota à l’oreille : « Paillette d’Or, petite tête blonde, je t’aime, me reconnais-tu ? »
 Le Prince des Contes de Fées se tenait devant elle. Se frottant les yeux, la princesse balbutia perplexe :
Le Prince des Contes de Fées se tenait devant elle. Se frottant les yeux, la princesse balbutia perplexe :
- Est-ce un rêve, ou es-tu bien réel ?
- Noble elfe, reprit le prince en embrassant Paillette d’Or sur ses cheveux aux doux reflets dorés, je suis bien réel, laisse-nous boire à nouveau dans la coupe d’or de l’amitié !
- La coupe d’or de l’amitié, eh bien, elle a été piétinée par les sabots de ton cheval, répondit Paillette d’Or mélancolique. Jamais plus nous ne boirons la boisson de l’amitié dans ma coupe. Et quand j’ai compris, à quel point ma coupe t’importait peu, du coup, elle me parut moins importante.
Sur ce, elle se leva, et le prince remarqua que son corps svelte ressemblait de plus en plus à la tige élancée de l’arum, réceptacle de l’élixir de vie.
- Sais-tu, prince, continua la princesse, il ne m’importe plus de boire de l’élixir de vie, mais d’en faire profiter les autres, parce que je suis une fée, et le droit particulier et prioritaire d’une fée, est avant tout de rendre les autres heureux, et non de rechercher son propre bonheur.
- Te souviens-tu des heures heureuses passées ensemble à vider la coupe de l’amitié ? demanda le prince.
- Bien sûr que je me souviens de ces belles heures passées ensemble, répondit la princesse en hochant la tête.
- Mais, poursuivit-elle, comme de lointains souvenirs laissés très loin derrière moi. Les ailes pourpres de l’oubli bruissaient encore dans ma tête lorsque la magie du printemps me saisit, cette douce magie qui allonge la vie, non pas à soi-même mais à ceux auxquels tu penses. Et là j’ai compris que la coupe que tu laissas si négligemment piétiner par ton cheval blanc, signifiait que tu ne souhaitais pas tenir une promesse, fût-elle sacrée.
- Non, tu te trompes, affirma le prince, transporté par le vertige de mes sentiments sacrés à ton égard, elle m’est tombée des mains !
- Non, rectifia Paillette d’Or, car ce que nous aimons vraiment, nous le tenons fermement et nous le pressons sur notre cœur, et aucun hasard, ni rien ni personne ne pourrait nous le voler.
- Accorde-moi encore une chance, petite princesse ! Remplis ce calice de jonquille fraîchement éclose d’élixir de vie, celui de ton superbe arum, et le bonheur nous sourira à nouveau.
- Une occasion perdue ne se retrouve jamais, prince !
- Tu es celle qui peut la renouveler !
- Non, pas moi. Je suis la chance – celle d’un autre !
- Ainsi nos chemins se séparent ! expliqua le Prince des Contes de Fées, amer. Puisses-tu voir refleurir un nouveau printemps !
La princesse des elfes souriait heureuse, car en vérité, le printemps est la plus belle des saisons – celle de l’altruisme.


Cependant, le petit peuple des elfes et des nains raconte que la princesse offre encore de nos jours, confiance et rafraîchissement aux miséreux et aux abandonnés qui empruntent le chemin de la profonde et mystérieuse forêt, et leur fait don du calice de la vie.
Et si lors d’une promenade, chère enfant, tu aperçois une jonquille jaune-or, alors penche-toi sur son calice et tu pourras y voir des gouttelettes translucides que tu prendras pour des larmes de confiance, mais en vérité, elles proviennent des coupes magiques de la fée des jonquilles. Depuis la nuit des temps, les elfes et les nains célèbrent les sept premières nuits du printemps, qui sont aussi le moment magique où toutes les jonquilles se transforment en coupelles de l’amitié.

Sur une fleur d’hibiscus rose, siégeait Paillette d’Or, la petite princesse des elfes. Elle représentait sa maman, la reine, engagée professionnellement ailleurs.

Dans les branches hautes des arbres, les oiseaux, ces merveilleux petits chanteurs aux plumes multicolores, entonnaient leurs gazouillis printaniers si ardemment attendus de tous.
Le vent courait sur la crête des chênes et faisait bruire les feuilles, tandis qu’au loin, retentissaient des sons de cors de chasse et des appels d’écuyers. Et dans la lumière crépusculaire, surgit un cortège haut en couleurs ; des chasseurs revêtus de costumes verts, des cavaliers à l’écu d’airain au coude et l’épée au fourreau, des garçonnets blonds sanglés dans d’étroits justaucorps de soie, le front cerclé d’or.
Et au milieu de ce cortège éblouissant, un prince, beau comme seuls peuvent l’être ceux des contes de fées, chevauchait un fier étalon blanc dont la crinière soyeuse flottait au vent.
Parvenu devant Paillette d’Or, le prince sauta à bas de sa monture, fit une profonde révérence et baisa aimablement la petite main princière.
- Tu arrives au bon moment, dit Paillette d’Or heureuse, prends place à côté de moi.
Elle tendit au prince sa propre coupe en signe de bienvenue.
- Personne n’a donc encore porté les lèvres à ta coupe d’or ? demanda le prince en souriant. Alors goûtons ensemble à cette délicieuse boisson.
La princesse accueillit de bon cœur la proposition du prince.
- D’où viens-tu ? lui demanda-t-elle, curieuse.
- Je viens d’un pays fort, fort lointain. J’ai surmonté mille dangers, mais à présent, je suis las de toutes les peines et de toutes les privations endurcies au cours de mes longues chevauchées, richement récompensées d’ailleurs, puisque tu m’invites à vider la coupe de l’amitié à tes côtés !
Il prit Paillette d’Or par la main, et ils se mêlèrent aux elfes et aux nains qui, trouvant la chose bien singulière, hochèrent la tête et s’en amusèrent cachés dans l’enchevêtrement des fougères naissantes et des primevères.

Tous dansèrent, tournèrent, tourbillonnèrent, s’entremêlèrent, buvant dans les gaies petites coupes, jusqu’à ce que la lune se couchât et que l’ululement de Chevêchette, le tout petit hibou, leur annonçât le matin nouveau.
Alors le prince quitta brusquement Paillette d’Or, prit la coupe d’or dans laquelle ils avaient bu la boisson de l’amitié, enfourcha son cheval et s’enfuit au galop. Mais avant qu’il n’atteignît la lisière de la forêt, la magnifique coupe d’or des elfes lui échappa des mains, roula sous les sabots de son cheval qui la piétina, et de la belle jonquille il ne resta plus qu’une pauvre fleur déchiquetée dont plus rien ne rappelait sa grâce et sa magnificence.

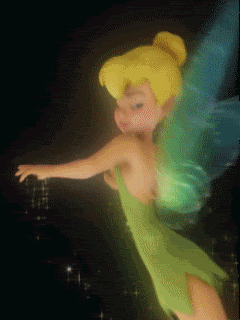
- Oh, comment as-tu pu agir ainsi avec notre coupe d’or de l’amitié !
Et elle ramassa la fleur, la pressa sur son cœur et tenta de lui redonner vie en l’aspergeant des gouttes d’eau fraîche d’une source proche, mais ce fut en vain. Ce qui est mort, reste mort et aucun amour ne peut y faire revenir le souffle de vie.
Tristement, la princesse retourna dans la forêt. Des larmes perlaient au coin de ses yeux et roulaient sur ses joues, et son cœur d’elfe se serrait, car elle savait que jamais le prince ne reviendrait, puisqu’il ne fut même pas capable de tenir jusqu’à l’aube, la promesse sacrée de ces quelques heures d’amitié !

Le lendemain, quand la brume crépusculaire envahit à nouveau la forêt, les elfes et les nains ressortirent de leurs maisonnettes de dessous la mousse, des creux dans les troncs d’arbres, des trous de souris, et des calices des fleurs. Entourant Paillette d’Or, ils lui dirent :
- Viens, gentille petite princesse, viens danser avec nous, sois heureuse et réjouis-toi de cette nuit secrète, car lorsqu’il commencera à faire jour, avant que le soleil ne se lève, nous devrons retourner nous cacher !
- Comment pourrais-je être enjouée et gaie, répondit Paillette d’Or en secouant tristement la tête. Comment pourrais-je danser et sauter alors qu’il a brisé ma coupe. J’entends tinter les clochettes des muguets, elles sonnent la fin de mon bonheur. Le prince a pris la fuite, pour aller courtiser une autre princesse !
Aussitôt, tous les elfes et tous les nains entourèrent doucement Paillette d’Or et cherchèrent à la consoler. Mais cela n’était pas du goût de la princesse car elle savait que la compassion ne faisait qu’adoucir la peine. Alors elle leur dit :
- Vous êtes prévenants avec moi, mais j’aimerais rester seule. On ne peut réfléchir et voir clair en soi, que lorsqu’on peut s’isoler pour se retrouver soi-même.

Sur ce, les elfes et les nains quittèrent la princesse.
« Par quoi pourrais-je commencer ? se demanda la princesse, car la décision que je vais prendre maintenant, engagera toute ma vie future. Le mieux que j’aie à faire est de ne plus penser à moi-même, alors la blessure de mon cœur se refermera ! » Sur ce, elle traversa la forêt silencieuse et atteignit une petite clairière au milieu de laquelle poussait un arum dont la haute tige verte était surmontée d’un grand calice blanc, à l’intérieur duquel se dressait un cierge d’un or éclatant. L’arum était empli de l’élixir de vie.
« J’ai trouvé ! se dit Paillette d’Or, je dois faire don de cet élixir de vie aux autres. En remplissant leurs coupes, je serai bénie par leur propre bonheur retrouvé. »

Et lorsqu’une fois encore, la nuit enveloppa de son voile de brume les forêts et les prairies, la princesse entra dans la ronde des danseurs et versa l’élixir de vie dans les coupes. Là-dessus, elle se fit vivement acclamer par les elfes qui aimaient tendrement leur petite princesse.
Sur ce, un gros triton à ventre de feu se faufila auprès de la princesse. Il était un méchant magicien ensorcelé. Jubilant, il lui chuchota à l’oreille : « Pourquoi te soucies-tu à ce point du bien-être des autres ? La vraie sagesse consiste à boire soi-même l’élixir de vie. »
« Le triton dit vrai, se dit Paillette d’Or, je suis vraiment stupide ! » Et elle saisit une jonquille et la plongea directement dans le calice de la fleur d’arum pour la remplir jusqu’au bord. Aussitôt, le lumineux flambeau d’or se rétrécit dans le cœur même de la fleur d’arum, et se fana pour devenir une vilaine et misérable chose terne. Horrifiée, Paillette d’Or, resta pétrifiée. « Oh ! Gémit-elle quand elle se fut ressaisie, comme j’ai été méchante ! Je ne dois pas boire moi-même de cet élixir de vie, mais le servir uniquement aux autres. Les êtres célestes voient tout et ils nous récompensent ou nous punissent selon nos œuvres ! »

Fatiguée et l’esprit torturé par les reproches qu’elle s’était faits, Paillette d’Or se retira à l’écart de la fête pour se coucher dans la mousse moelleuse où elle ne tarda pas à fermer les yeux. Soudain, une voix douce et aimante lui chuchota à l’oreille : « Paillette d’Or, petite tête blonde, je t’aime, me reconnais-tu ? »

- Est-ce un rêve, ou es-tu bien réel ?
- Noble elfe, reprit le prince en embrassant Paillette d’Or sur ses cheveux aux doux reflets dorés, je suis bien réel, laisse-nous boire à nouveau dans la coupe d’or de l’amitié !
- La coupe d’or de l’amitié, eh bien, elle a été piétinée par les sabots de ton cheval, répondit Paillette d’Or mélancolique. Jamais plus nous ne boirons la boisson de l’amitié dans ma coupe. Et quand j’ai compris, à quel point ma coupe t’importait peu, du coup, elle me parut moins importante.
Sur ce, elle se leva, et le prince remarqua que son corps svelte ressemblait de plus en plus à la tige élancée de l’arum, réceptacle de l’élixir de vie.
- Sais-tu, prince, continua la princesse, il ne m’importe plus de boire de l’élixir de vie, mais d’en faire profiter les autres, parce que je suis une fée, et le droit particulier et prioritaire d’une fée, est avant tout de rendre les autres heureux, et non de rechercher son propre bonheur.
- Te souviens-tu des heures heureuses passées ensemble à vider la coupe de l’amitié ? demanda le prince.
- Bien sûr que je me souviens de ces belles heures passées ensemble, répondit la princesse en hochant la tête.
- Mais, poursuivit-elle, comme de lointains souvenirs laissés très loin derrière moi. Les ailes pourpres de l’oubli bruissaient encore dans ma tête lorsque la magie du printemps me saisit, cette douce magie qui allonge la vie, non pas à soi-même mais à ceux auxquels tu penses. Et là j’ai compris que la coupe que tu laissas si négligemment piétiner par ton cheval blanc, signifiait que tu ne souhaitais pas tenir une promesse, fût-elle sacrée.
- Non, tu te trompes, affirma le prince, transporté par le vertige de mes sentiments sacrés à ton égard, elle m’est tombée des mains !
- Non, rectifia Paillette d’Or, car ce que nous aimons vraiment, nous le tenons fermement et nous le pressons sur notre cœur, et aucun hasard, ni rien ni personne ne pourrait nous le voler.
- Accorde-moi encore une chance, petite princesse ! Remplis ce calice de jonquille fraîchement éclose d’élixir de vie, celui de ton superbe arum, et le bonheur nous sourira à nouveau.
- Une occasion perdue ne se retrouve jamais, prince !
- Tu es celle qui peut la renouveler !
- Non, pas moi. Je suis la chance – celle d’un autre !
- Ainsi nos chemins se séparent ! expliqua le Prince des Contes de Fées, amer. Puisses-tu voir refleurir un nouveau printemps !
La princesse des elfes souriait heureuse, car en vérité, le printemps est la plus belle des saisons – celle de l’altruisme.


Cependant, le petit peuple des elfes et des nains raconte que la princesse offre encore de nos jours, confiance et rafraîchissement aux miséreux et aux abandonnés qui empruntent le chemin de la profonde et mystérieuse forêt, et leur fait don du calice de la vie.
Et si lors d’une promenade, chère enfant, tu aperçois une jonquille jaune-or, alors penche-toi sur son calice et tu pourras y voir des gouttelettes translucides que tu prendras pour des larmes de confiance, mais en vérité, elles proviennent des coupes magiques de la fée des jonquilles. Depuis la nuit des temps, les elfes et les nains célèbrent les sept premières nuits du printemps, qui sont aussi le moment magique où toutes les jonquilles se transforment en coupelles de l’amitié.

Dernière édition par Freya le Mar 12 Aoû 2014 - 18:04, édité 2 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Le Dahlia Poupre
Le Dahlia Poupre
A l’époque où le Roi Soleil, Louis XIV, régnait sur le beau pays de France, le marquis de la Rosette officiait à la cour. Grand Maître de Cérémonies, il logeait au palais de Versailles, et il n’était non seulement aimé mais encore honoré de tous. Attentif, il veillait consciencieusement à l’observation stricte du protocole particulièrement lourd en vigueur à la cour de France. Affable, fidèle, ponctuel, et zélé, il était à sa façon un courtisan modèle. Il aimait la vie et sa plus grande joie était de pouvoir servir son monarque. Le Marquis de la Rosette avait la confiance du souverain, et de tous les serviteurs et courtisans, il était probablement celui que le roi appréciait le plus, car jamais il ne lui fît de remarque pertinente, chose dont il ne se privait guère en public. Il était le roi, il était tout puissant, il pouvait tout !
 Svelte et élancé, le visage avenant, le marquis jouissait d’une excellente santé, et jour après jour, il affichait invariablement un air frais et dispos. Il ne connaissait pas le sentiment de la peur, et il n’avait d’ailleurs ni le temps ni l’occasion de se poser des questions sur la mort ou de s’en soucier. Cependant, il était convaincu que la peur était le pire ennemi de l’homme.
Svelte et élancé, le visage avenant, le marquis jouissait d’une excellente santé, et jour après jour, il affichait invariablement un air frais et dispos. Il ne connaissait pas le sentiment de la peur, et il n’avait d’ailleurs ni le temps ni l’occasion de se poser des questions sur la mort ou de s’en soucier. Cependant, il était convaincu que la peur était le pire ennemi de l’homme.
Année après année, le marquis restait semblable à lui-même. Il portait toujours le même costume de soie verte sur lequel se détachaient des bandes de couleur pourpre. Une première rosette rouge était cousue sur l’emplacement du cœur, une deuxième au-dessus du coude droit, une troisième ornait la jarretière de son genou gauche, et une quatrième le sommet de sa canne de cérémonie. Son élégance reflétait la mode de l’époque et elle était considérée comme l’exemple du bon goût. Tous les jeunes gens de la cour, imitaient ses manières, ses façons de s’exprimer, de s’habiller, et même les expressions de son visage. Le marquis n’avait nullement l’air de vieillir, et ses amis disaient qu’il devait son éternelle jeunesse à son esprit qui n’était jamais empli que de belles pensées, et à sa vie occupée à effectuer des actes nobles et bons.
Et pourtant, les courtisans ne pouvaient s’empêcher de chuchoter entre eux qu’un jour, le marquis devra payer lui aussi son tribut à la nature, et s’en aller pour un royaume dont jamais personne n’est revenu. Emus, ils se demandaient combien de temps l’étincelle de sa vie brillera encore avant de s’éteindre pour renaître dans un monde plus radieux et plus heureux.
Au cours de son long pèlerinage terrestre, le marquis avait vu beaucoup de souffrances, chez les pauvres aussi bien que chez les riches. Ces expériences ont instillé lentement mais sûrement dans son cœur, non pas la peur de la mort, mais celle de la souffrance.
Un jour, il parut pâle et fatigué à la cour.
« Le marquis se fait vieux » se chuchota-t-on à l’oreille.
Le roi et la reine s’étonnèrent de la mauvaise mine du marquis qui jouissait de leur faveur et de leur bonne grâce. Leurs majestés souhaitèrent alléger sa tâche, mais le marquis ne voulut rien entendre. Humblement, il rassura les souverains en leur disant que de les servir était sa seule et plus grande joie. Mais le marquis était terriblement malheureux car il sentait qu’il ne pourrait plus remplir longtemps ses fonctions, d’autant plus que pour lui l’amour du travail bien fait était le jeu le plus divertissant qui fût.
Il lui apparut clairement qu’à chaque coucher du soleil, ses forces déclinaient comme la lumière à la fin du jour. Alors, quelques amis maladroits, dans l’intention de le consoler ou de le rassurer, lui dirent que bientôt il connaîtra la joie de voir le visage du Créateur. Le marquis ne répondit pas, mais en son for intérieur, il se disait « Comme si je ne le connaissais pas ! Je le vois chaque jour dans les corolles des fleurs qui s’ouvrent au soleil, la majesté des arbres, l’eau claire des fontaines, et j’entends les voix célestes dans le gai gazouillis des oiseaux. »
Mais ce soir-là, le marquis songeait à sa longue vie heureuse entièrement dévouée au roi, et il se dit que s’il avait quelque chose à dire au Créateur, ce serait pour le remercier de lui avoir permis d’effectuer son service sans jamais faillir, et pour qu’Il lui accorde un départ paisible lorsque sa dernière petite heure sera venue. Il ajouta qu’il souhaitait ne jamais tomber à la charge de sa famille ou de ses amis, et leur épargner le triste et douloureux spectacle de ses derniers moments.
Quelques mois plus tard, toute la cour était en effervescence. Le marquis avait disparu sans laisser de trace. Le roi était perturbé. Son courageux et vieux Grand Maître de Cérémonies semblait avoir été soufflé, emporté comme une fleur par une rafale de vent d’orage automnal.
« Mais où peut-il bien être ? » se demandèrent ses amis.
Soucieux et craignant que le vieil homme ne fût tombé foudroyé par une apoplexie, le roi ordonna aussitôt que le palais du marquis fût fouillé de fond en comble. Toute la cour prit part aux recherches. Le moindre recoin du palais du marquis fut exploré, même les pièces de la cave et des combles, ainsi que le toit. Mais nulle part on ne trouva la moindre trace du disparu.
Les laquais et les plus grands personnages de la cour se précipitèrent ensuite dans le parc du palais du marquis où, pendant ses heures de repos, il aimait flâner entre les plates-bandes de fleurs toujours bien entretenues, et les fontaines jaillissantes. Soudain, aux yeux de tous, le marquis apparut droit devant eux, oscillant légèrement sous les bouffées d’une brise légère qui courait dans les buissons alentour, il se tenait debout, les pieds solidement enracinés dans la terre bienveillante qui avait recueilli son corps inanimé. Il portait toujours son costume vert aux bandes de couleur pourpre, mais il s’était métamorphosé en dahlia. L’une des fleurs pencha la tête vers l’endroit où, autrefois, battait le cœur fidèle ; une autre fleur poussait sur une branche latérale, le bras droit orné jadis du ruban de l’Ordre du Mérite ; la troisième bourgeonnait à la hauteur du genou, et la dernière, la plus grande et la plus merveilleuse de toutes les fleurs pourpres, couronnait le sommet de la canne de cérémonie contre laquelle la plante toute entière s’appuyait.
De nos jours encore, le dahlia pourpre, distingué et silencieux, témoigne toujours du secret de l’immortalité.
Et chaque automne, il refleurit et nous invite à nous souvenir du vieux Marquis de la Rosette qui servit fidèlement son seigneur et roi, et de son âme qui put se reposer dans la joie du royaume céleste.

Année après année, le marquis restait semblable à lui-même. Il portait toujours le même costume de soie verte sur lequel se détachaient des bandes de couleur pourpre. Une première rosette rouge était cousue sur l’emplacement du cœur, une deuxième au-dessus du coude droit, une troisième ornait la jarretière de son genou gauche, et une quatrième le sommet de sa canne de cérémonie. Son élégance reflétait la mode de l’époque et elle était considérée comme l’exemple du bon goût. Tous les jeunes gens de la cour, imitaient ses manières, ses façons de s’exprimer, de s’habiller, et même les expressions de son visage. Le marquis n’avait nullement l’air de vieillir, et ses amis disaient qu’il devait son éternelle jeunesse à son esprit qui n’était jamais empli que de belles pensées, et à sa vie occupée à effectuer des actes nobles et bons.
Et pourtant, les courtisans ne pouvaient s’empêcher de chuchoter entre eux qu’un jour, le marquis devra payer lui aussi son tribut à la nature, et s’en aller pour un royaume dont jamais personne n’est revenu. Emus, ils se demandaient combien de temps l’étincelle de sa vie brillera encore avant de s’éteindre pour renaître dans un monde plus radieux et plus heureux.
Au cours de son long pèlerinage terrestre, le marquis avait vu beaucoup de souffrances, chez les pauvres aussi bien que chez les riches. Ces expériences ont instillé lentement mais sûrement dans son cœur, non pas la peur de la mort, mais celle de la souffrance.
Un jour, il parut pâle et fatigué à la cour.
« Le marquis se fait vieux » se chuchota-t-on à l’oreille.
Le roi et la reine s’étonnèrent de la mauvaise mine du marquis qui jouissait de leur faveur et de leur bonne grâce. Leurs majestés souhaitèrent alléger sa tâche, mais le marquis ne voulut rien entendre. Humblement, il rassura les souverains en leur disant que de les servir était sa seule et plus grande joie. Mais le marquis était terriblement malheureux car il sentait qu’il ne pourrait plus remplir longtemps ses fonctions, d’autant plus que pour lui l’amour du travail bien fait était le jeu le plus divertissant qui fût.
Il lui apparut clairement qu’à chaque coucher du soleil, ses forces déclinaient comme la lumière à la fin du jour. Alors, quelques amis maladroits, dans l’intention de le consoler ou de le rassurer, lui dirent que bientôt il connaîtra la joie de voir le visage du Créateur. Le marquis ne répondit pas, mais en son for intérieur, il se disait « Comme si je ne le connaissais pas ! Je le vois chaque jour dans les corolles des fleurs qui s’ouvrent au soleil, la majesté des arbres, l’eau claire des fontaines, et j’entends les voix célestes dans le gai gazouillis des oiseaux. »
Mais ce soir-là, le marquis songeait à sa longue vie heureuse entièrement dévouée au roi, et il se dit que s’il avait quelque chose à dire au Créateur, ce serait pour le remercier de lui avoir permis d’effectuer son service sans jamais faillir, et pour qu’Il lui accorde un départ paisible lorsque sa dernière petite heure sera venue. Il ajouta qu’il souhaitait ne jamais tomber à la charge de sa famille ou de ses amis, et leur épargner le triste et douloureux spectacle de ses derniers moments.
Quelques mois plus tard, toute la cour était en effervescence. Le marquis avait disparu sans laisser de trace. Le roi était perturbé. Son courageux et vieux Grand Maître de Cérémonies semblait avoir été soufflé, emporté comme une fleur par une rafale de vent d’orage automnal.
« Mais où peut-il bien être ? » se demandèrent ses amis.
Soucieux et craignant que le vieil homme ne fût tombé foudroyé par une apoplexie, le roi ordonna aussitôt que le palais du marquis fût fouillé de fond en comble. Toute la cour prit part aux recherches. Le moindre recoin du palais du marquis fut exploré, même les pièces de la cave et des combles, ainsi que le toit. Mais nulle part on ne trouva la moindre trace du disparu.
Les laquais et les plus grands personnages de la cour se précipitèrent ensuite dans le parc du palais du marquis où, pendant ses heures de repos, il aimait flâner entre les plates-bandes de fleurs toujours bien entretenues, et les fontaines jaillissantes. Soudain, aux yeux de tous, le marquis apparut droit devant eux, oscillant légèrement sous les bouffées d’une brise légère qui courait dans les buissons alentour, il se tenait debout, les pieds solidement enracinés dans la terre bienveillante qui avait recueilli son corps inanimé. Il portait toujours son costume vert aux bandes de couleur pourpre, mais il s’était métamorphosé en dahlia. L’une des fleurs pencha la tête vers l’endroit où, autrefois, battait le cœur fidèle ; une autre fleur poussait sur une branche latérale, le bras droit orné jadis du ruban de l’Ordre du Mérite ; la troisième bourgeonnait à la hauteur du genou, et la dernière, la plus grande et la plus merveilleuse de toutes les fleurs pourpres, couronnait le sommet de la canne de cérémonie contre laquelle la plante toute entière s’appuyait.
De nos jours encore, le dahlia pourpre, distingué et silencieux, témoigne toujours du secret de l’immortalité.
Et chaque automne, il refleurit et nous invite à nous souvenir du vieux Marquis de la Rosette qui servit fidèlement son seigneur et roi, et de son âme qui put se reposer dans la joie du royaume céleste.


Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 La Fleur d'Oranger
La Fleur d'Oranger
Jadis régnait sur la Sicile, un roi puissant très aimé de son peuple. De sa première épouse, fille du roi de Grèce, qui lui fut enlevée bien trop tôt par l’omnipotente souveraine qu’est la mort, il avait deux filles, Rose et Eudora. La première avait des cheveux de couleur jais, la deuxième une chevelure d’un roux flamboyant.
Bien que le roi ait tenu sa première épouse en haute estime, il décida de convoler une nouvelle fois.
D’un voyage dans les pays nordiques, il rentra avec à son bras sa seconde épouse, une comtesse scandinave qui avait des yeux d’un bleu si clair que l’on croyait y voir le reflet des montagnes sur le miroir des eaux translucides des fjords. Ses cheveux blonds et souples comme la soie, ondulaient sur ses épaules comme les blés mûrs sous un vent chaud de juillet. Mais lors des chaleurs alanguissantes des étés siciliens, elle sombrait dans une étrange mélancolie, le regard perdu au loin, songeant à son pays natal, à la fraîcheur de ses forêts de bouleaux et de sapins, de ses fjords. Et, malheureusement, elle mourut quelques mois après avoir donné le jour à une petite princesse, Fiora ou Fleur, qui hérita de sa belle chevelure blonde et de ses grands yeux rêveurs au regard mélancolique.
Un jour que le roi vit venir à lui son enfant Fiora, il remarqua sa pimpante et lumineuse jeunesse sur le point de s’épanouir tel un bouton de fleur. Alors il songea mélancoliquement à sa défunte épouse, la belle Scandinave, qu’il avait aimé tendrement, aussi affectionna-t-il particulièrement la douce Fiora.
 Mais cette attitude du roi, éveilla la jalousie et l’envie des deux autres princesses.
Mais cette attitude du roi, éveilla la jalousie et l’envie des deux autres princesses.
Cette jalousie et cette envie furent aiguisées encore bien davantage quand elles virent tous les princes et comtes du royaume qui venaient courtiser leur père, ne prêter attention qu’à la blonde Fiora.
Fiora ressentait bien la rancune qu’éprouvaient ses belles-sœurs envers elle, mais elle n’en concevait aucun ressentiment et continuait à mener une vie tranquille et sereine, ne leur souhaitant que le meilleur.
Mais un jour, Fiora dit à son père :
- Majesté, père ! Je vois bien que je dérange mes belles-sœurs, et bien que cela me brise le cœur de me séparer de vous, je pense que la meilleure solution pour tous est que je quitte le palais pour fonder mon propre foyer. Envoie des messagers sillonner tout le pays, pour annoncer au peuple que le cœur et la main de Fiora sont à prendre. Et que ceux qui les désirent, se présentent lors des fêtes de la moisson, le jour du tournoi, dans la cour du château. Je me tiendrai alors sous le rosier grimpant de la fenêtre de ma chambre, et je lancerai une belle orange dorée au milieu des nobles, et celui qui montrera suffisamment d’adresse pour l’attraper au vol, pourra me prendre pour épouse et me faire monter en croupe derrière lui.
Le roi se sentit ému et triste à la fois, mais il ne souhaita pas rejeter la demande de la princesse. Et comme le souhaita Fiora, il envoya ses hérauts inviter nobles et gens libres à se présenter à la résidence royale, au moment de la fête des moissons.
Cependant, lors de ses promenades solitaires, Fiora remarqua un garde forestier dans lequel, en dépit de ses vêtements simples et verts, elle crut reconnaître un homme de sang noble. Secrètement, elle lui suggéra de se rendre le jour du tournoi, dans la cour du palais royal, parce que son cœur battait d’amour pour lui, et qu’elle espérait qu’il attraperait l’orange qu’elle jettera.

Le grand jour arriva.
Le soleil levant poudroyait d’or pourpre les briques des échauguettes et les ardoises du toit du château, et des rubans aux couleurs de la princesse Fiora flottaient aux hampes des drapeaux et des lances des gardes, lorsque princes et comtes passèrent devant eux pour se rassembler dans la cour du château. Le pauvre garde-forestier, se mêlant aux gens libres, réussit à se faufiler dans la cour sans se faire remarquer.
Ce fut à ce moment-là que la princesse Fiora apparut à une fenêtre du palais. Vêtue d’une robe bleue ciel brodée de blanches fleurs d’oranger, elle ressemblait à une fée. Sur sa tête, un cordon de soie argentée retenait un léger voile bleuâtre flottant sur ses boucles qui retombaient en vagues blondes sur son précieux collier d’émeraudes et de rubis ornant le décolleté de sa robe.
Au pied de la muraille du palais, la foule pleine d’entrain, levait mains et épées. Souriante, Fiora tenait dans sa main un fruit d’or.
Elle regarda en contrebas. Derrière les rangs des candidats princiers, se tenait le jeune garde-forestier qui, se faisant petit, osait à peine se montrer au milieu de cette brillante assemblée.
D’un geste gracieux la princesse leva la main et – l’orange vola loin par-dessus les têtes des nobles messieurs, et le jeune garde-forestier la saisit au vol.
Le roi qui se tenait derrière sa fille, fronça les sourcils.
- Qui est ce compagnon qui a pris le fruit doré ? Il me semble bien que c’est ce jeune garde-forestier, ce noble sauvage qui n’attendait que cela. Jamais, jamais, entends-tu, je n’accepterai d’accorder ta main à ce simple garde-forestier !
- Mais tu as promis, reprit Fiora, que celui qui attrapera l’orange aura droit à ma main, et un roi ne peut rendre sa parole.
Le roi qui était un homme consciencieux et de grande honorabilité, n’avait de toute sa vie manqué à sa parole.
Par conséquent, il ordonna que le garde-forestier lui fût amené et il lui dit :
- Avoue-le, c’est par de la magie que tu as charmé mon enfant. Vous les gardes-chasse et les gardes-forestiers, vous êtes tous d’astucieux garçons et d’audacieux casse-cous. En fait, je devrais te faire pendre. Mais comme Fiora a pris ta défense, et que j’ai accepté que ma fille épouse celui qui attrapera l’orange, je vais te rendre justice et t’accorder ma grâce ainsi que la main de ma fille. Mais, dis-moi, qu’as-tu à offrir à une femme ?
- Grand seigneur et roi, répondit le jeune garde-forestier, en regardant le souverain franchement et honnêtement dans les yeux, ce n’est pas avec de la magie que j’ai gagné le cœur de la princesse. L’amour, lui, ne sait discerner ni rang ni classe, et Eros, d’une de ses flèches, unit nos deux cœurs. Je suis en effet un pauvre garçon, mais tout ce que je possède je tiens à l’offrir à mon épouse, et cela me paraît bien plus précieux et souhaitable que la grandeur et la splendeur qu’offre une haute naissance. Je possède une maison entourée de roses et de fleurs d’orangers, et bien protégée par de puissants arbres aux branches noueuses dans lesquelles retentissent les chants d’amour des oiseaux, et sur le toit de la maison roucoule une tourterelle au bec écarlate, et ce bonheur et cette bénédiction, sont protégés par la joubarbe qui y pousse.
Le roi se tourna vers sa fille.
- Fiora, mon enfant, lui dit-il, cela te suffira-t-il ? Toi qui es habituée à vivre dans un palais de marbre, d’avoir à ta disposition chevaux et carrosses, des pages et des servantes pour te servir ?
- Père, cela me suffira ! dit la princesse rougissante de honte en rejoignant le jeune homme, car je l’aime par-dessus tout.
Le roi tenta une dernière fois de faire changer d’avis la princesse. Aimablement mais gravement, il lui dit :
- Ma fille, de l’amour seul on ne peut vivre, et là où soucis et besoins s’invitent en hôtes, la tendre petite fleur de l’amour se fane vite et meurt. C’est pourquoi, je te demande de réfléchir mûrement avant de faire ce pas décisif.
- J’ai bien réfléchi à tout cela, Majesté et papa. A mon bonheur il ne manque qu’une seule chose – ta bénédiction. Accorde-nous ta bénédiction et garde-moi en ta bonne grâce.
Finalement, le souverain accepta, et le mariage de la princesse avec le garde-forestier fut célébré dans la stricte intimité. Puis, le jeune couple monta dans une petite carriole à deux roues, tirée par un poney harnaché de courroies de cuir ornées de pompons rouges et de clochettes en laiton doré aux consonances harmonieuses.
Rose et Eudora ne purent s’empêcher de railler leur belle-sœur.
- Ses beaux yeux bleus finiront bien par s’ouvrir ! ricana Rose aux cheveux noirs.
Et sa sœur Eudora aux cheveux roux renchérit :
- Avec une soupe brûlée aux morceaux de pain d’orge trempés dedans, je lui souhaite un bon appétit ! Et peut-être aura-t-elle une douzaine de marmots pleurnichards ?


Pendant ce temps, Fiora et son époux avaient gagné leur demeure et s’y installèrent tranquillement.
Avec un plaisir d’enfant, la jeune femme épousseta la chambre poussiéreuse, examina la cuisinière, les petites fenêtres et les mignons petits bancs et chaises, et s’amusa du roucoulement de la tourterelle sur le toit qui avait fait son nid dans les combles de la maison forestière. Elle prit plaisir aux magnifiques roses et fleurs d’oranger dont le parfum se mêlait à l’odeur de la résine des sapins. De sa douce mère qui en bonne Scandinave était une ménagère admirable, elle tenait son habileté, et ainsi, préparer le repas simple de son mari, fut pour elle envie et délassement.
Une semaine plus tard déjà, les deux belles-sœurs décidèrent d’aller rendre visite à Fiora, dans le seul dessein de la dénigrer et de la tourner en dérision.
Fiora se tenait sous le porche de la porte de la maison forestière et fendait du bois lorsque les deux princesses arrivèrent au galop, montées sur leurs chevaux.
- Que fais-tu là, madame la garde-forestière ? s’écria avec mépris Rose en descendant de son cheval aidée de son page.
- Mais tu fends du bois ! dit en s’amusant Eudora. Quel beau travail pour une fille de roi ! Beurk ! Cela abime les mains !
- Entrez ! répondit doucement et poliment Fiora. Je ne puis vous offrir ni cadre somptueux ni repas riche, mais si un simple petit-déjeuner peut vous contenter, vous êtes les bienvenues.
L’air hautain, Rose et Eudora pénétrèrent dans la maison.
- Oh Bonne Mère que c’est étroit ici, dit Eudora, les coudes sont douloureux à force de se cogner.
- Regarde voir là-bas, au-dessus du fourneau, la veste d’un vagabond, dit Rose, tu peux être sûre qu’elle est infestée de vermine.
- Ceci est la veste d’intérieur de mon mari qu’il met quand il revient de la forêt, répondit Fiora. Elle est légère et propre et vous n’avez pas à en être dégoûtées.
- Juste, tu as une sorte de bécasse pour époux, se moquèrent les princesses, un homme qui sent le bois pourri et dont les mains et les cheveux sont maculés de résine.
Fiora n’écoutait pas les paroles insensées de ses belles-sœurs, mais elle leur apporta sur des assiettes d’étain propres des fruits aux parfums frais et délicieux, du pain à l’orge fraîchement cuit, et une cruche de terre cuite emplie d’hydromel.
- Nous te remercions, lui dirent-elles froidement, mais des filles de roi ne mangent pas dans des assiettes d’étain et ne boivent pas dans une cruche de terre cuite. Et, fièrement, elles sortirent de la maison, et se laissèrent mettre en selle par leurs écuyers. Elles s’éloignèrent au galop avec de retentissants rires moqueurs.

Lorsqu’au coucher du soleil le mari de Fiora revint de la forêt, sa jeune épouse lui raconta ce qui s’était passé.
Le garde-forestier fronça les sourcils, caressa les boucles d’or de sa douce épouse et en conclut :
- Elles jalousent notre bonheur, c’est tout.
Le lendemain matin quand la jeune femme fut à nouveau seule dans son jardin à s’occuper de ses fleurs, apparut soudain dans le feuillage d’un oranger un petit personnage.
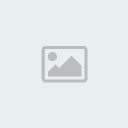 Malheureusement, et depuis toujours, il est des personnes et de méchantes fées qui ne peuvent souffrir de voir des gens heureux, et ne pensent qu’à leur faire du mal, et le Malin pourrait bien, lui aussi, être tenté de s’en mêler. Cependant, il existe de petits êtres rusés qui ne souffrent pas l’injustice et qui sont capables de piper les dés aux méchants. L’innocente Fiora, toujours seule du matin au soir dans sa maisonnette au milieu des bois, n’est-elle pas une proie facile pour les méchants ? Nous connaîtrons la suite de cette histoire la semaine prochaine.
Malheureusement, et depuis toujours, il est des personnes et de méchantes fées qui ne peuvent souffrir de voir des gens heureux, et ne pensent qu’à leur faire du mal, et le Malin pourrait bien, lui aussi, être tenté de s’en mêler. Cependant, il existe de petits êtres rusés qui ne souffrent pas l’injustice et qui sont capables de piper les dés aux méchants. L’innocente Fiora, toujours seule du matin au soir dans sa maisonnette au milieu des bois, n’est-elle pas une proie facile pour les méchants ? Nous connaîtrons la suite de cette histoire la semaine prochaine.
Bien que le roi ait tenu sa première épouse en haute estime, il décida de convoler une nouvelle fois.
D’un voyage dans les pays nordiques, il rentra avec à son bras sa seconde épouse, une comtesse scandinave qui avait des yeux d’un bleu si clair que l’on croyait y voir le reflet des montagnes sur le miroir des eaux translucides des fjords. Ses cheveux blonds et souples comme la soie, ondulaient sur ses épaules comme les blés mûrs sous un vent chaud de juillet. Mais lors des chaleurs alanguissantes des étés siciliens, elle sombrait dans une étrange mélancolie, le regard perdu au loin, songeant à son pays natal, à la fraîcheur de ses forêts de bouleaux et de sapins, de ses fjords. Et, malheureusement, elle mourut quelques mois après avoir donné le jour à une petite princesse, Fiora ou Fleur, qui hérita de sa belle chevelure blonde et de ses grands yeux rêveurs au regard mélancolique.
Un jour que le roi vit venir à lui son enfant Fiora, il remarqua sa pimpante et lumineuse jeunesse sur le point de s’épanouir tel un bouton de fleur. Alors il songea mélancoliquement à sa défunte épouse, la belle Scandinave, qu’il avait aimé tendrement, aussi affectionna-t-il particulièrement la douce Fiora.

Cette jalousie et cette envie furent aiguisées encore bien davantage quand elles virent tous les princes et comtes du royaume qui venaient courtiser leur père, ne prêter attention qu’à la blonde Fiora.
Fiora ressentait bien la rancune qu’éprouvaient ses belles-sœurs envers elle, mais elle n’en concevait aucun ressentiment et continuait à mener une vie tranquille et sereine, ne leur souhaitant que le meilleur.
Mais un jour, Fiora dit à son père :
- Majesté, père ! Je vois bien que je dérange mes belles-sœurs, et bien que cela me brise le cœur de me séparer de vous, je pense que la meilleure solution pour tous est que je quitte le palais pour fonder mon propre foyer. Envoie des messagers sillonner tout le pays, pour annoncer au peuple que le cœur et la main de Fiora sont à prendre. Et que ceux qui les désirent, se présentent lors des fêtes de la moisson, le jour du tournoi, dans la cour du château. Je me tiendrai alors sous le rosier grimpant de la fenêtre de ma chambre, et je lancerai une belle orange dorée au milieu des nobles, et celui qui montrera suffisamment d’adresse pour l’attraper au vol, pourra me prendre pour épouse et me faire monter en croupe derrière lui.
Le roi se sentit ému et triste à la fois, mais il ne souhaita pas rejeter la demande de la princesse. Et comme le souhaita Fiora, il envoya ses hérauts inviter nobles et gens libres à se présenter à la résidence royale, au moment de la fête des moissons.
Cependant, lors de ses promenades solitaires, Fiora remarqua un garde forestier dans lequel, en dépit de ses vêtements simples et verts, elle crut reconnaître un homme de sang noble. Secrètement, elle lui suggéra de se rendre le jour du tournoi, dans la cour du palais royal, parce que son cœur battait d’amour pour lui, et qu’elle espérait qu’il attraperait l’orange qu’elle jettera.

Le grand jour arriva.
Le soleil levant poudroyait d’or pourpre les briques des échauguettes et les ardoises du toit du château, et des rubans aux couleurs de la princesse Fiora flottaient aux hampes des drapeaux et des lances des gardes, lorsque princes et comtes passèrent devant eux pour se rassembler dans la cour du château. Le pauvre garde-forestier, se mêlant aux gens libres, réussit à se faufiler dans la cour sans se faire remarquer.
Ce fut à ce moment-là que la princesse Fiora apparut à une fenêtre du palais. Vêtue d’une robe bleue ciel brodée de blanches fleurs d’oranger, elle ressemblait à une fée. Sur sa tête, un cordon de soie argentée retenait un léger voile bleuâtre flottant sur ses boucles qui retombaient en vagues blondes sur son précieux collier d’émeraudes et de rubis ornant le décolleté de sa robe.
Au pied de la muraille du palais, la foule pleine d’entrain, levait mains et épées. Souriante, Fiora tenait dans sa main un fruit d’or.
Elle regarda en contrebas. Derrière les rangs des candidats princiers, se tenait le jeune garde-forestier qui, se faisant petit, osait à peine se montrer au milieu de cette brillante assemblée.
D’un geste gracieux la princesse leva la main et – l’orange vola loin par-dessus les têtes des nobles messieurs, et le jeune garde-forestier la saisit au vol.
Le roi qui se tenait derrière sa fille, fronça les sourcils.
- Qui est ce compagnon qui a pris le fruit doré ? Il me semble bien que c’est ce jeune garde-forestier, ce noble sauvage qui n’attendait que cela. Jamais, jamais, entends-tu, je n’accepterai d’accorder ta main à ce simple garde-forestier !
- Mais tu as promis, reprit Fiora, que celui qui attrapera l’orange aura droit à ma main, et un roi ne peut rendre sa parole.
Le roi qui était un homme consciencieux et de grande honorabilité, n’avait de toute sa vie manqué à sa parole.
Par conséquent, il ordonna que le garde-forestier lui fût amené et il lui dit :
- Avoue-le, c’est par de la magie que tu as charmé mon enfant. Vous les gardes-chasse et les gardes-forestiers, vous êtes tous d’astucieux garçons et d’audacieux casse-cous. En fait, je devrais te faire pendre. Mais comme Fiora a pris ta défense, et que j’ai accepté que ma fille épouse celui qui attrapera l’orange, je vais te rendre justice et t’accorder ma grâce ainsi que la main de ma fille. Mais, dis-moi, qu’as-tu à offrir à une femme ?
- Grand seigneur et roi, répondit le jeune garde-forestier, en regardant le souverain franchement et honnêtement dans les yeux, ce n’est pas avec de la magie que j’ai gagné le cœur de la princesse. L’amour, lui, ne sait discerner ni rang ni classe, et Eros, d’une de ses flèches, unit nos deux cœurs. Je suis en effet un pauvre garçon, mais tout ce que je possède je tiens à l’offrir à mon épouse, et cela me paraît bien plus précieux et souhaitable que la grandeur et la splendeur qu’offre une haute naissance. Je possède une maison entourée de roses et de fleurs d’orangers, et bien protégée par de puissants arbres aux branches noueuses dans lesquelles retentissent les chants d’amour des oiseaux, et sur le toit de la maison roucoule une tourterelle au bec écarlate, et ce bonheur et cette bénédiction, sont protégés par la joubarbe qui y pousse.
Le roi se tourna vers sa fille.
- Fiora, mon enfant, lui dit-il, cela te suffira-t-il ? Toi qui es habituée à vivre dans un palais de marbre, d’avoir à ta disposition chevaux et carrosses, des pages et des servantes pour te servir ?
- Père, cela me suffira ! dit la princesse rougissante de honte en rejoignant le jeune homme, car je l’aime par-dessus tout.
Le roi tenta une dernière fois de faire changer d’avis la princesse. Aimablement mais gravement, il lui dit :
- Ma fille, de l’amour seul on ne peut vivre, et là où soucis et besoins s’invitent en hôtes, la tendre petite fleur de l’amour se fane vite et meurt. C’est pourquoi, je te demande de réfléchir mûrement avant de faire ce pas décisif.
- J’ai bien réfléchi à tout cela, Majesté et papa. A mon bonheur il ne manque qu’une seule chose – ta bénédiction. Accorde-nous ta bénédiction et garde-moi en ta bonne grâce.
Finalement, le souverain accepta, et le mariage de la princesse avec le garde-forestier fut célébré dans la stricte intimité. Puis, le jeune couple monta dans une petite carriole à deux roues, tirée par un poney harnaché de courroies de cuir ornées de pompons rouges et de clochettes en laiton doré aux consonances harmonieuses.
Rose et Eudora ne purent s’empêcher de railler leur belle-sœur.
- Ses beaux yeux bleus finiront bien par s’ouvrir ! ricana Rose aux cheveux noirs.
Et sa sœur Eudora aux cheveux roux renchérit :
- Avec une soupe brûlée aux morceaux de pain d’orge trempés dedans, je lui souhaite un bon appétit ! Et peut-être aura-t-elle une douzaine de marmots pleurnichards ?


Pendant ce temps, Fiora et son époux avaient gagné leur demeure et s’y installèrent tranquillement.
Avec un plaisir d’enfant, la jeune femme épousseta la chambre poussiéreuse, examina la cuisinière, les petites fenêtres et les mignons petits bancs et chaises, et s’amusa du roucoulement de la tourterelle sur le toit qui avait fait son nid dans les combles de la maison forestière. Elle prit plaisir aux magnifiques roses et fleurs d’oranger dont le parfum se mêlait à l’odeur de la résine des sapins. De sa douce mère qui en bonne Scandinave était une ménagère admirable, elle tenait son habileté, et ainsi, préparer le repas simple de son mari, fut pour elle envie et délassement.
Une semaine plus tard déjà, les deux belles-sœurs décidèrent d’aller rendre visite à Fiora, dans le seul dessein de la dénigrer et de la tourner en dérision.
Fiora se tenait sous le porche de la porte de la maison forestière et fendait du bois lorsque les deux princesses arrivèrent au galop, montées sur leurs chevaux.
- Que fais-tu là, madame la garde-forestière ? s’écria avec mépris Rose en descendant de son cheval aidée de son page.
- Mais tu fends du bois ! dit en s’amusant Eudora. Quel beau travail pour une fille de roi ! Beurk ! Cela abime les mains !
- Entrez ! répondit doucement et poliment Fiora. Je ne puis vous offrir ni cadre somptueux ni repas riche, mais si un simple petit-déjeuner peut vous contenter, vous êtes les bienvenues.
L’air hautain, Rose et Eudora pénétrèrent dans la maison.
- Oh Bonne Mère que c’est étroit ici, dit Eudora, les coudes sont douloureux à force de se cogner.
- Regarde voir là-bas, au-dessus du fourneau, la veste d’un vagabond, dit Rose, tu peux être sûre qu’elle est infestée de vermine.
- Ceci est la veste d’intérieur de mon mari qu’il met quand il revient de la forêt, répondit Fiora. Elle est légère et propre et vous n’avez pas à en être dégoûtées.
- Juste, tu as une sorte de bécasse pour époux, se moquèrent les princesses, un homme qui sent le bois pourri et dont les mains et les cheveux sont maculés de résine.
Fiora n’écoutait pas les paroles insensées de ses belles-sœurs, mais elle leur apporta sur des assiettes d’étain propres des fruits aux parfums frais et délicieux, du pain à l’orge fraîchement cuit, et une cruche de terre cuite emplie d’hydromel.
- Nous te remercions, lui dirent-elles froidement, mais des filles de roi ne mangent pas dans des assiettes d’étain et ne boivent pas dans une cruche de terre cuite. Et, fièrement, elles sortirent de la maison, et se laissèrent mettre en selle par leurs écuyers. Elles s’éloignèrent au galop avec de retentissants rires moqueurs.

Le garde-forestier fronça les sourcils, caressa les boucles d’or de sa douce épouse et en conclut :
- Elles jalousent notre bonheur, c’est tout.
Le lendemain matin quand la jeune femme fut à nouveau seule dans son jardin à s’occuper de ses fleurs, apparut soudain dans le feuillage d’un oranger un petit personnage.
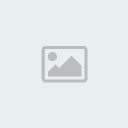

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 Re: Contes Floraux du Jardin des Elfes
Re: Contes Floraux du Jardin des Elfes
La Fleur d'Oranger (suite et fin)
C’était un petit homme portant une longue barbe blanche et un bonnet rouge sur des cheveux poivre et sel.
- Qui es-tu ? demanda Fiora étonnée.
D’une petite voix cristalline, le nain répondit :
- Je m’appelle Pierre. Je sais tout. Je suis si gris, je suis si vieux, j’ai vu la résine des arbres des forêts de Bohême, neuf fois les prairies, neuf fois les forêts. J’ai quitté mon pays natal où je creusais la montagne au sommet de laquelle niche l’aigle, pour extraire de l’or en compagnie des miens, le peuple heureux des nains. Je suis ton bon génie. Je t’offre ce peigne, sers-toi en et coiffe tes cheveux soyeux, bouclette après bouclette, souples et gracieux ils se transformeront en or. Aie confiance en moi.
Et le petit homme présenta à la jeune garde-forestière un peigne sculpté dans une corne de bouquetin.
- Comment puis-je te remercier de ce précieux cadeau ? demanda Fiora toute joyeuse. Jamais je n’ai mérité pareil don.
Souriant, Pierre lui dit :
- Inutile de me remercier, toutes les dames aiment les jolies choses, et ceci est une façon de récompenser la noblesse de tes pensées. Je fus envoyé ici comme ambassadeur du lointain pays des elfes.
Et soudain, le gnome disparut.
 Fiora attendit avec impatience le retour de son mari.
Fiora attendit avec impatience le retour de son mari.
Quand enfin il pénétra dans la maison, elle se porta à sa rencontre pour lui montrer le cadeau du nain et lui rapporter ses paroles.
Et, quand avant d’aller se coucher, elle peigna ses longs cheveux blonds, de minuscules fils d’or ruisselèrent de ses boucles pour aller couvrir le sol de leur éclat.
Cependant, Fiora et son mari étaient des personnes raisonnables. Avec l’argent de la vente des fils d’or, ils ne s’achetèrent que l’indispensable ; Fiora s’acheta une jolie robe et pour son mari elle choisit de confortables habits verts, ainsi que quelques meubles qui leur faisaient défaut depuis bien longtemps.
Après un certain temps, les deux princesses s’invitèrent à nouveau chez leur belle-sœur et s’étonnèrent de sa belle robe neuve, des confortables fauteuils et bancs neufs.
- Regarde cela ! s’écria Eudora. Ton mari a dû tuer un bien gros ours pour que vous ayez pu vous procurer toutes ces choses-là !
Mordante, Rose remarqua :
- Peut-être a-t-il seulement volé cet argent ?
- Vous vous trompez, répondit Fiora. Et elle alla chercher le peigne que lui avait remis le nain. Nous devons tout cela à ce cadeau des elfes !
Les princesses la regardèrent incrédules peigner ses longs et blonds cheveux, et le sol se recouvrir de brillants fils d’or.
Rose lui arracha le peigne des mains.
- Laisse-moi tester la puissance magique de ce peigne ! dit-elle. Et elle commença aussitôt à coiffer ses longs cheveux noirs. Mais pas le moindre fil d’or ne tomba de sa chevelure sombre, mais de détestables scarabées noirs vinrent recouvrir le sol.
Eudora hurla d’effroi. Mais elle saisit le peigne des mains de sa sœur et le fit passer dans sa longue chevelure rouge-flamme et – des araignées rouges se mirent à pleuvoir de ses boucles sur le sol.
- Les elfes qui te firent cadeau de ce peigne sont peut-être tes amis, mais ils sont sûrement nos ennemis. Garde cet horrible cadeau magique loin de nous ! dirent les filles du roi, et elles quittèrent rapidement la maison forestière.
De retour au château, les princesses racontèrent leur mésaventure à leur ancienne gouvernante, et ne manquèrent pas d’accuser Fiora d’être devenue une terrible sorcière, et elles lui apprirent qu’elle tenait des elfes un peigne qui transformait tout en or. Elles conclurent :
- Elle nous ruinera toutes pour se venger des torts que nous lui avons causés.
- N’ayez crainte, ricana la vielle gouvernante, car moi aussi j’ai mes relations dans le monde des esprits, et je vais lui envoyer mon ami Belzebuth !
Deux jours plus tard, Fiora aperçut devant le portillon de son jardin, un beau jeune homme qui vendait de la mercerie : des rubans, des tabliers, des fils multicolores, de la lingerie, des colliers de perles.
- Belle dame ! dit le marchand ambulant – qui n’était autre que le diable déguisé – ne voudriez-vous pas m’acheter un beau collier de perles pour orner votre beau cou ?
- Non, répondit Fiora, je ne porte pas de bijou.
- Deux rubans de soie pour retenir vos beaux cheveux alors ?
- Non, je ne porte pas de parure dans mes cheveux.
- Mais ce tablier-là, blanc aux larges bretelles peut-être !
Fiora réfléchit. Pour protéger sa nouvelle robe, ce tablier conviendrait bien à vrai dire, se dit-elle.
- Venez, entrez ! dit-elle à l’inconnu.
Le diable grimaça car dans le jardin les orangers étaient en train de fleurir, et l’éclat de leur blancheur pure, symbole de noblesse et d’innocence, l’empêchèrent de traverser l’enclos.
- Venez plutôt vers moi, poursuivit-il traîtreusement. Dans votre jardin, les orangers fleurissent et je ne supporte pas leur parfum.
L’ingénue Fiora s’avança vers le portillon du jardin et Belzebuth lui mit le tablier et tira si fort sur les rubans de la ceinture que la pauvre femme prise de peur et d’anxiété s’écria :
- Pas si fort, pas si fort ! Mais j’étouffe !
Mais plus elle se débattait et gémissait, et plus Belzébuth serrait les rubans du tablier jusqu’à ce que Fiora perdit connaissance et tomba à terre.
Et quand le soir, le garde-forestier rentrant de la forêt vit son épouse couchée sur le sol visiblement inerte, il fut pris d’une terrible frayeur. Il saisit son couteau forestier et trancha les rubans du tablier puis il porta Fiora à l’intérieur de la maison pour la déposer sur son lit.
Lentement, elle reprit connaissance. Si son mari était rentré dix minutes plus tard, elle n’aurait plus été en vie.
Lorsqu’elle lui raconta son aventure, il la gronda pour s’être laissée entraîner dans une conversation avec un parfait inconnu.
Mais Belzébuth observait la scène de loin.
Ennuyé et frustré que son mauvais coup n’ait pas réussi, il décida de provoquer une énorme tempête, rassembla les elfes noirs et leur ordonna :
- Soufflez-moi cette maison et qu’elle disparaisse à jamais de la surface de la terre !
Avec des hurlements de joie les esprits des ténèbres se ruèrent au travers de la forêt, et le son de leur cor fit frémir les arbres.
Une terrible tempête se leva et des arbres millénaires furent déracinés ; le tonnerre gronda, les torrents grossis par la pluie, arrachèrent dans leur chute terre et rochers, les roulant jusque dans les vallées, et le vent brassa sans répit champs et forêts.
Tremblante de peur, Fiora sortit de la maison. Son mari passa son bras autour de ses frêles épaules et tenta de la calmer.
Au même moment, la maison s’effondra derrière eux dans le vacarme des éléments déchaînés.
- Où allons-nous aller à présent ? gémit Fiora.
- Aie confiance ma chérie, dit le garde-forestier, les elfes de lumière nous protègeront.
A peine eut-il terminé sa phrase, que Pierre le nain se présenta devant eux.
- Suivez-moi, jeunes amis, dit-il, j’ai pris avec moi une énorme bulle de savon qui nous emportera tous.
- Que voici un moyen de transport bien fragile, remarqua le garde-forestier.
- Suivez-moi en toute confiance, répondit le nain sourire aux lèvres.
Ils grimpèrent alors tous les trois dans la bulle de savon irisée qui s’éleva aussitôt dans les airs en tourbillonnant et qui les mena jusque devant l’entrée d’une merveilleuse grotte bleue, comme il en existe tant autour du littoral méditerranéen.
- Ceci sera votre nouvelle demeure ! Vous plaît-elle ? demanda Pierre
Comment la grotte aurait-elle pu leur déplaire ? Le sol et les murs de la grotte étaient recouverts de stalactites, la table, les fauteuils et les bancs étaient taillés dans du jade néphrite vert sombre. Un lit magnifique aux colonnes de cristal et à la literie moelleuse, recouverte d’une étoffe semblant avoir été tissée avec des fleurs d’oranger, et dans la cuisine, s’entassaient de grandes et petites casseroles, des poêles, et des tasses en argent pur et en or. La douce lumière irisée qui brillait dans toutes les pièces, faisait penser à celle qui embrase les montagnes nordiques.

Mais Belzébuth dévoila le lieu de refuge de Fiora aux deux princesses.
Et le matin suivant elles firent leur apparition à proximité de la grotte.
Pierre les vit arriver et vint à leur rencontre.
- Savez-vous où mène ce chemin, grandes dames ?
- Comment se fait-il que tu connaisses ce chemin ? demanda Rose hargneuse.
- Ceci est sans importance, expliqua le nain.
- Nous voulons rendre visite à notre belle-sœur qui habite par ici ! dit Eudora.
- Ah, voici autre chose, dit en souriant le nain. Venez, suivez-moi.
Les deux sœurs furent prises d’angoisse quand, cheminant derrière leur petit guide, il fit de plus en plus sombre, et elles souhaitèrent retourner sur leurs pas lorsque le nain ouvrit une porte de bois et leur dit :
- Je vous en prie mesdames, entrez !
Mais cette porte n’était autre que le couvercle d’un énorme fût qu’il referma en le claquant aussitôt que les princesses y eurent pénétrées.
Lorsque les filles de roi comprirent qu’elles étaient tombées dans un piège, elles commencèrent aussitôt à gémir, à crier et pour finir à trépigner de rage.

Pierre appela ses amis les nains et les kobolds, et avec des rires joyeux, ils poussèrent le fût dans lequel se trouvaient les deux sœurs, jusqu’à ce qu’il se mit à rouler et à dévaler la pente jusqu’au pied de la montagne où il heurta un gros rocher, craqua et se brisa. Les deux princesses en piteux état, toutes courbaturées et sérieusement égratignées réussirent à se dégager.
Furieuses et fermement décidées à surprendre Fiora et le garde-forestier dans leur grotte bleue pour les capturer, elles se hâtèrent de rentrer au château pour échafauder le plan de leur vengeance.
Mais échaudées par leur dernière mésaventure, les princesses préférèrent envoyer leurs hommes de main enlever Fiora et son époux, mais ceux-ci eurent la désagréable surprise de trouver l’entrée de la grotte bleue protégée par une haie de puissants orangers qui, de leurs épines acérées, en interdisaient l’accès à tout ennemi.

Depuis ces temps lointains, la fleur d’oranger est considérée comme le symbole des sentiments nobles et purs, et ses épines comme les protectrices de l’innocence persécutée. Et comme Fiora, portait une couronne de fleurs d’oranger sur ses cheveux blonds le jour où elle suivit son bien-aimé à l’autel, les mariées de nos jours, ceignent encore leurs fronts d’une parure de fleurs d’oranger odorantes et blanches comme la neige, et leurs épines protègent la délicate douceur de la fleur des elfes.
C’était un petit homme portant une longue barbe blanche et un bonnet rouge sur des cheveux poivre et sel.
- Qui es-tu ? demanda Fiora étonnée.
D’une petite voix cristalline, le nain répondit :
- Je m’appelle Pierre. Je sais tout. Je suis si gris, je suis si vieux, j’ai vu la résine des arbres des forêts de Bohême, neuf fois les prairies, neuf fois les forêts. J’ai quitté mon pays natal où je creusais la montagne au sommet de laquelle niche l’aigle, pour extraire de l’or en compagnie des miens, le peuple heureux des nains. Je suis ton bon génie. Je t’offre ce peigne, sers-toi en et coiffe tes cheveux soyeux, bouclette après bouclette, souples et gracieux ils se transformeront en or. Aie confiance en moi.
Et le petit homme présenta à la jeune garde-forestière un peigne sculpté dans une corne de bouquetin.
- Comment puis-je te remercier de ce précieux cadeau ? demanda Fiora toute joyeuse. Jamais je n’ai mérité pareil don.
Souriant, Pierre lui dit :
- Inutile de me remercier, toutes les dames aiment les jolies choses, et ceci est une façon de récompenser la noblesse de tes pensées. Je fus envoyé ici comme ambassadeur du lointain pays des elfes.
Et soudain, le gnome disparut.

Quand enfin il pénétra dans la maison, elle se porta à sa rencontre pour lui montrer le cadeau du nain et lui rapporter ses paroles.
Et, quand avant d’aller se coucher, elle peigna ses longs cheveux blonds, de minuscules fils d’or ruisselèrent de ses boucles pour aller couvrir le sol de leur éclat.
Cependant, Fiora et son mari étaient des personnes raisonnables. Avec l’argent de la vente des fils d’or, ils ne s’achetèrent que l’indispensable ; Fiora s’acheta une jolie robe et pour son mari elle choisit de confortables habits verts, ainsi que quelques meubles qui leur faisaient défaut depuis bien longtemps.
Après un certain temps, les deux princesses s’invitèrent à nouveau chez leur belle-sœur et s’étonnèrent de sa belle robe neuve, des confortables fauteuils et bancs neufs.
- Regarde cela ! s’écria Eudora. Ton mari a dû tuer un bien gros ours pour que vous ayez pu vous procurer toutes ces choses-là !
Mordante, Rose remarqua :
- Peut-être a-t-il seulement volé cet argent ?
- Vous vous trompez, répondit Fiora. Et elle alla chercher le peigne que lui avait remis le nain. Nous devons tout cela à ce cadeau des elfes !
Les princesses la regardèrent incrédules peigner ses longs et blonds cheveux, et le sol se recouvrir de brillants fils d’or.
Rose lui arracha le peigne des mains.
- Laisse-moi tester la puissance magique de ce peigne ! dit-elle. Et elle commença aussitôt à coiffer ses longs cheveux noirs. Mais pas le moindre fil d’or ne tomba de sa chevelure sombre, mais de détestables scarabées noirs vinrent recouvrir le sol.
Eudora hurla d’effroi. Mais elle saisit le peigne des mains de sa sœur et le fit passer dans sa longue chevelure rouge-flamme et – des araignées rouges se mirent à pleuvoir de ses boucles sur le sol.
- Les elfes qui te firent cadeau de ce peigne sont peut-être tes amis, mais ils sont sûrement nos ennemis. Garde cet horrible cadeau magique loin de nous ! dirent les filles du roi, et elles quittèrent rapidement la maison forestière.
De retour au château, les princesses racontèrent leur mésaventure à leur ancienne gouvernante, et ne manquèrent pas d’accuser Fiora d’être devenue une terrible sorcière, et elles lui apprirent qu’elle tenait des elfes un peigne qui transformait tout en or. Elles conclurent :
- Elle nous ruinera toutes pour se venger des torts que nous lui avons causés.
- N’ayez crainte, ricana la vielle gouvernante, car moi aussi j’ai mes relations dans le monde des esprits, et je vais lui envoyer mon ami Belzebuth !
Deux jours plus tard, Fiora aperçut devant le portillon de son jardin, un beau jeune homme qui vendait de la mercerie : des rubans, des tabliers, des fils multicolores, de la lingerie, des colliers de perles.
- Belle dame ! dit le marchand ambulant – qui n’était autre que le diable déguisé – ne voudriez-vous pas m’acheter un beau collier de perles pour orner votre beau cou ?
- Non, répondit Fiora, je ne porte pas de bijou.
- Deux rubans de soie pour retenir vos beaux cheveux alors ?
- Non, je ne porte pas de parure dans mes cheveux.
- Mais ce tablier-là, blanc aux larges bretelles peut-être !
Fiora réfléchit. Pour protéger sa nouvelle robe, ce tablier conviendrait bien à vrai dire, se dit-elle.
- Venez, entrez ! dit-elle à l’inconnu.
Le diable grimaça car dans le jardin les orangers étaient en train de fleurir, et l’éclat de leur blancheur pure, symbole de noblesse et d’innocence, l’empêchèrent de traverser l’enclos.
- Venez plutôt vers moi, poursuivit-il traîtreusement. Dans votre jardin, les orangers fleurissent et je ne supporte pas leur parfum.
L’ingénue Fiora s’avança vers le portillon du jardin et Belzebuth lui mit le tablier et tira si fort sur les rubans de la ceinture que la pauvre femme prise de peur et d’anxiété s’écria :
- Pas si fort, pas si fort ! Mais j’étouffe !
Mais plus elle se débattait et gémissait, et plus Belzébuth serrait les rubans du tablier jusqu’à ce que Fiora perdit connaissance et tomba à terre.
Et quand le soir, le garde-forestier rentrant de la forêt vit son épouse couchée sur le sol visiblement inerte, il fut pris d’une terrible frayeur. Il saisit son couteau forestier et trancha les rubans du tablier puis il porta Fiora à l’intérieur de la maison pour la déposer sur son lit.
Lentement, elle reprit connaissance. Si son mari était rentré dix minutes plus tard, elle n’aurait plus été en vie.
Lorsqu’elle lui raconta son aventure, il la gronda pour s’être laissée entraîner dans une conversation avec un parfait inconnu.
Mais Belzébuth observait la scène de loin.
Ennuyé et frustré que son mauvais coup n’ait pas réussi, il décida de provoquer une énorme tempête, rassembla les elfes noirs et leur ordonna :
- Soufflez-moi cette maison et qu’elle disparaisse à jamais de la surface de la terre !
Avec des hurlements de joie les esprits des ténèbres se ruèrent au travers de la forêt, et le son de leur cor fit frémir les arbres.
Une terrible tempête se leva et des arbres millénaires furent déracinés ; le tonnerre gronda, les torrents grossis par la pluie, arrachèrent dans leur chute terre et rochers, les roulant jusque dans les vallées, et le vent brassa sans répit champs et forêts.
Tremblante de peur, Fiora sortit de la maison. Son mari passa son bras autour de ses frêles épaules et tenta de la calmer.
Au même moment, la maison s’effondra derrière eux dans le vacarme des éléments déchaînés.
- Où allons-nous aller à présent ? gémit Fiora.
- Aie confiance ma chérie, dit le garde-forestier, les elfes de lumière nous protègeront.
A peine eut-il terminé sa phrase, que Pierre le nain se présenta devant eux.
- Suivez-moi, jeunes amis, dit-il, j’ai pris avec moi une énorme bulle de savon qui nous emportera tous.
- Que voici un moyen de transport bien fragile, remarqua le garde-forestier.
- Suivez-moi en toute confiance, répondit le nain sourire aux lèvres.
Ils grimpèrent alors tous les trois dans la bulle de savon irisée qui s’éleva aussitôt dans les airs en tourbillonnant et qui les mena jusque devant l’entrée d’une merveilleuse grotte bleue, comme il en existe tant autour du littoral méditerranéen.
- Ceci sera votre nouvelle demeure ! Vous plaît-elle ? demanda Pierre
Comment la grotte aurait-elle pu leur déplaire ? Le sol et les murs de la grotte étaient recouverts de stalactites, la table, les fauteuils et les bancs étaient taillés dans du jade néphrite vert sombre. Un lit magnifique aux colonnes de cristal et à la literie moelleuse, recouverte d’une étoffe semblant avoir été tissée avec des fleurs d’oranger, et dans la cuisine, s’entassaient de grandes et petites casseroles, des poêles, et des tasses en argent pur et en or. La douce lumière irisée qui brillait dans toutes les pièces, faisait penser à celle qui embrase les montagnes nordiques.

Mais Belzébuth dévoila le lieu de refuge de Fiora aux deux princesses.
Et le matin suivant elles firent leur apparition à proximité de la grotte.
Pierre les vit arriver et vint à leur rencontre.
- Savez-vous où mène ce chemin, grandes dames ?
- Comment se fait-il que tu connaisses ce chemin ? demanda Rose hargneuse.
- Ceci est sans importance, expliqua le nain.
- Nous voulons rendre visite à notre belle-sœur qui habite par ici ! dit Eudora.
- Ah, voici autre chose, dit en souriant le nain. Venez, suivez-moi.
Les deux sœurs furent prises d’angoisse quand, cheminant derrière leur petit guide, il fit de plus en plus sombre, et elles souhaitèrent retourner sur leurs pas lorsque le nain ouvrit une porte de bois et leur dit :
- Je vous en prie mesdames, entrez !
Mais cette porte n’était autre que le couvercle d’un énorme fût qu’il referma en le claquant aussitôt que les princesses y eurent pénétrées.
Lorsque les filles de roi comprirent qu’elles étaient tombées dans un piège, elles commencèrent aussitôt à gémir, à crier et pour finir à trépigner de rage.

Pierre appela ses amis les nains et les kobolds, et avec des rires joyeux, ils poussèrent le fût dans lequel se trouvaient les deux sœurs, jusqu’à ce qu’il se mit à rouler et à dévaler la pente jusqu’au pied de la montagne où il heurta un gros rocher, craqua et se brisa. Les deux princesses en piteux état, toutes courbaturées et sérieusement égratignées réussirent à se dégager.
Furieuses et fermement décidées à surprendre Fiora et le garde-forestier dans leur grotte bleue pour les capturer, elles se hâtèrent de rentrer au château pour échafauder le plan de leur vengeance.
Mais échaudées par leur dernière mésaventure, les princesses préférèrent envoyer leurs hommes de main enlever Fiora et son époux, mais ceux-ci eurent la désagréable surprise de trouver l’entrée de la grotte bleue protégée par une haie de puissants orangers qui, de leurs épines acérées, en interdisaient l’accès à tout ennemi.

Depuis ces temps lointains, la fleur d’oranger est considérée comme le symbole des sentiments nobles et purs, et ses épines comme les protectrices de l’innocence persécutée. Et comme Fiora, portait une couronne de fleurs d’oranger sur ses cheveux blonds le jour où elle suivit son bien-aimé à l’autel, les mariées de nos jours, ceignent encore leurs fronts d’une parure de fleurs d’oranger odorantes et blanches comme la neige, et leurs épines protègent la délicate douceur de la fleur des elfes.
Dernière édition par Freya le Mer 4 Juin 2014 - 14:29, édité 1 fois

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
 La Petite Violette
La Petite Violette
Une demoiselle violette était si modeste, fidèle et affectueuse, qu’elle ne nourrissait qu’un seul rêve, celui de pouvoir vivre à jamais dans la forêt silencieuse où elle pouvait écouter le doux et clair murmure des sources et le joyeux gazouillis des oiseaux.
- Oh, comme j’aimerais passer ma vie entière en ce lieu si paisible, se disait-elle souvent.
Mais l’humilité, la modestie et la douceur étaient déjà en ces temps-là, des qualités aussi rares que de nos jours, au point que l’on admirait la jeune violette tout en se posant bien des questions à son sujet.
Et par un beau matin de printemps, mademoiselle Violette vit en s’éveillant, le visage du chevalier de la Goutte de Rosée se pencher sur son front.
- Ah ! Te voici ! dit le chevalier heureux. Je t’ai cherchée partout, parce que tu es si douce, humble et aimante.
Très pudiquement, mademoiselle Violette répondit :
- Je suis si petite et si laide…Mais vous par contre, vous ressemblez à un diamant scintillant qui, peu s’en faut, m’aveuglerait par leur éclat.
- Ne sois donc pas si modeste en parlant de toi-même ! reprit le chevalier, tu es une petite fleur qui m’est particulièrement chère ! Prends cette pierre précieuse, presse la sur ton cœur et, en fondant, elle ornera ta beauté et rehaussera encore son éclat.
- Oh, noble seigneur, je n’ai pas le droit de porter un tel joyau. Je ne souhaite pas paraître plus noble que je ne le suis, et si je suis vraiment aussi belle que vous le prétendez, je préfère rester silencieuse et discrète, attitude qui m’offre la protection la plus efficace.
- Ta modestie sera toujours ta meilleure protection.
- Mais je veux passer inaperçue, et ne pas être recherchée.
- Cela est possible, dit en souriant le chevalier, mais mes frères, le Rayon de Soleil et le Vent d’Orage, finiront bien par te trouver et alors…
- Alors mes frères l’Herbe et le Feuillage sauront me protéger ! Comme tu parlais justement de tes frères… tiens regarde ! Voici les miens qui arrivent !
- Hm ! fit le brave chevalier, il faut que je m’en aille rapidement, car le Rayon de Soleil, bien qu’il soit mon frère, n’est pas mon ami. Mais quand le crépuscule tombera à nouveau, je reviendrai !
Et, le chevalier de la Goutte de Rosée, se retira pour disparaître rapidement dans une mer de nuages.
- Regarde, quelle mignonne petite demoiselle ! dit le Rayon de Soleil.
- S’il vous plaît grand seigneur, je vous en supplie, ne me prenez pas le joyau qui m’a été donné par votre frère, le chevalier de la Goutte de Rosée, supplia mademoiselle Violette.
- Tiens-tu donc en si haute estime le cadeau de mon frère ? demanda le Rayon de Soleil morose.
- Certainement, parce qu’il est un cadeau d’amour, expliqua la jeune Violette. Cette pierre scintille comme le cristal et rehausse la pureté et la beauté du cœur.
- Mon frère, le chevalier de la Goutte de Rosée, est une mauviette ! fit en grimaçant le Rayon de Soleil. Je vais te prendre cette bulle d’eau et te donner en échange une petite bague d’or que tu pourras toujours porter.
- Mais ce serait offenser ton frère !
- Peut-être bien… bien que nous soyons frères, nos points de vue diffèrent énormément. Et puis, n’est-ce pas moi qui permets à une fleur de déployer sa corolle en toute beauté ?
- Mais du chevalier de la Goutte de Rosée, les belles fleurs nouvellement nées reçoivent la consécration de leur premier baptême. Son œuvre est grande et noble.
- Quel non-sens ! répliqua le Rayon de Soleil. Il vous arrose si peu. De mon éclat doré vous vient votre beauté. Alors du balai avec cette chose aqueuse, là ! et il aspira la goutte de rosée et disparut.
- Si seulement il pouvait ne jamais revenir, ce baron voleur ! soupira la violette.

Des nuages couvrirent le ciel. Apeurée, la fleur leva son regard vers les arbres et vit à quel point les feuilles des bouleaux et des peupliers tremblaient, et les herbes qui, de terreur, se balançaient d’avant en arrière.
- L’orage arrive ! crièrent les fleurs et les bourgeons. Cachez-vous, afin qu’il ne puisse vous plier pour mieux vous casser !
Rapidement, la violette passa la tête sous ses feuilles. Mais l’orage avec rudesse et violence, tira et tira jusqu’à ce que la petite plante fût complètement déracinée.
- Viens timide jeune fille, dit-il en sifflant. Viens avec moi ! Nous allons ensemble voler par monts et par vaux, fleuves et ruisseaux. Je veux te porter dans mes bras.
- Non, non ! cria la petite fleur choquée, je veux rester ici, chez moi, dans mon confortable et paisible coin de forêt.
- Qu’est-ce qui te prend ? hurla le vent. Toi et tes sœurs vous êtes bien trop mignonnes pour rester là à dépérir inaperçues. Vous devez aller en ville ! Là-bas, dans certains palais, dans un beau parc ou encore de riches vitrines, vous pourrez prolonger votre beauté et la valoriser.
- Mais c’est ici que je me sens à l’aise !
- Ridicule ! Précisément parce que tu ne connais rien de mieux. Comme dans ta folle modestie tu refuses de connaître le bonheur, je te dis adieu !
- De ces troubles éternels j’en ai plus qu’assez ! répondit la demoiselle en colère. Je ne demande qu’à vivre en paix et comme bon me semble. Accourez mes frères, entourez-moi et protégez-moi de tous ces chercheurs de beauté qui ne tarderont pas à nous envahir.
Les frères de la violette se pressèrent pour l’entourer. Les tiges avec leurs épaisses feuilles, se rapprochèrent de leur petite sœur et la cachèrent du hardi rayon de soleil, et du vent d’orage.
Et quand le soleil disparut comme avalé par l’horizon, le chevalier de la Goutte de Rosée descendit des nuages comblant la violette, et tiges et feuilles s’écartèrent afin qu’elle pût recevoir le nouveau joyau étincelant du chevalier.
- Comment, mon doux amour ? s’étonna le chevalier de la Goutte de Rosée, tu portes un autre joyau à présent ? un petit anneau d’or ?
- Ton frère le Rayon de Soleil me l’a donné, répondit la violette, mais je préfère ton brillant joyau.
- Ne crains pas de te faire voler ma goutte par mes frères, le Rayon de Soleil et le Vent d’Orage. Dans le doux crépuscule du jour, tu la recevras toujours de mes mains. Et tes frères peuvent continuer à te protéger comme auparavant.
Quand le jour se leva, deux enfants, un frère et une sœur, passèrent par la forêt.
- Regarde cette jolie petite fleur, là-bas ! s’écria le garçonnet en désignant la violette. Nous allons la cueillir pour l’offrir à maman !
- Non, ce serait vraiment dommage, répondit la judicieuse petite sœur. Nous allons la déterrer avec ses racines et la transplanter dans notre jardin où elle fleurira tout comme ici.
Et, doucement, ils déterrèrent la violette en prenant soin de prendre un peu de terre de son sol natal avec eux. De retour chez eux, à l’ombre des grands arbres de leur jardin, ils creusèrent un trou dans de la mousse et l’y plantèrent. Puis, ils appelèrent leur gentille maman afin qu’elle puisse admirer la petite merveille.
- Jamais nous n’avons accueilli dans notre jardin une fleur aussi adorable ! dit la maman. Mais elle penche la tête, et elle paraît bien triste ! Peut-être a-t-elle le mal du pays, ou peut-être lui manque-t-il quelque chose ?
- Tu as bien raison ! pensa la violette. Il me manque le climat de confiance du petit coin de terre où je suis née. Ce jardin est beau et même magnifique avec ses plates-bandes de roses toutes merveilleuses, mais toute cette gloire ne remplace pas ce que j’ai perdu. La seule chose qui me console est que mon ami le chevalier de la Goutte de Rosée me retrouvera chaque soir pour me rafraîchir et m’orner.
Mais les deux frères du chevalier de la Goutte de Rosée, retrouvèrent également la trace de la petite violette. Et le Rayon de Soleil honora la modeste petite demoiselle-fleur en lui offrant une bague en or, et le Vent d’Orage fit connaître au monde entier la beauté et la grâce délicate de la violette, la douceur de son parfum, de sorte que depuis lors, on la rencontre aussi bien dans les palais des personnes importantes et riches que dans les chaumières et les maisons des petites et pauvres gens.
Il ne pousse pas de fleur plus douce dans les forêts et les jardins qui soit courtisée par le vent d’orage et le soleil, embrassée par la rosée rafraîchissante, que cette calme fleur cachée, embaumant l’air autour d’elle, et poussant à l’abri des arbres, des feuilles et des chemins détrempés de pluie. Cette douce fleur des elfes est la tendre violette, transplantée du paradis sur terre par le Jardinier Céleste.
- Oh, comme j’aimerais passer ma vie entière en ce lieu si paisible, se disait-elle souvent.
Mais l’humilité, la modestie et la douceur étaient déjà en ces temps-là, des qualités aussi rares que de nos jours, au point que l’on admirait la jeune violette tout en se posant bien des questions à son sujet.
Et par un beau matin de printemps, mademoiselle Violette vit en s’éveillant, le visage du chevalier de la Goutte de Rosée se pencher sur son front.
- Ah ! Te voici ! dit le chevalier heureux. Je t’ai cherchée partout, parce que tu es si douce, humble et aimante.
Très pudiquement, mademoiselle Violette répondit :
- Je suis si petite et si laide…Mais vous par contre, vous ressemblez à un diamant scintillant qui, peu s’en faut, m’aveuglerait par leur éclat.
- Ne sois donc pas si modeste en parlant de toi-même ! reprit le chevalier, tu es une petite fleur qui m’est particulièrement chère ! Prends cette pierre précieuse, presse la sur ton cœur et, en fondant, elle ornera ta beauté et rehaussera encore son éclat.
- Oh, noble seigneur, je n’ai pas le droit de porter un tel joyau. Je ne souhaite pas paraître plus noble que je ne le suis, et si je suis vraiment aussi belle que vous le prétendez, je préfère rester silencieuse et discrète, attitude qui m’offre la protection la plus efficace.
- Ta modestie sera toujours ta meilleure protection.
- Mais je veux passer inaperçue, et ne pas être recherchée.
- Cela est possible, dit en souriant le chevalier, mais mes frères, le Rayon de Soleil et le Vent d’Orage, finiront bien par te trouver et alors…
- Alors mes frères l’Herbe et le Feuillage sauront me protéger ! Comme tu parlais justement de tes frères… tiens regarde ! Voici les miens qui arrivent !
- Hm ! fit le brave chevalier, il faut que je m’en aille rapidement, car le Rayon de Soleil, bien qu’il soit mon frère, n’est pas mon ami. Mais quand le crépuscule tombera à nouveau, je reviendrai !
Et, le chevalier de la Goutte de Rosée, se retira pour disparaître rapidement dans une mer de nuages.
- Regarde, quelle mignonne petite demoiselle ! dit le Rayon de Soleil.
- S’il vous plaît grand seigneur, je vous en supplie, ne me prenez pas le joyau qui m’a été donné par votre frère, le chevalier de la Goutte de Rosée, supplia mademoiselle Violette.
- Tiens-tu donc en si haute estime le cadeau de mon frère ? demanda le Rayon de Soleil morose.
- Certainement, parce qu’il est un cadeau d’amour, expliqua la jeune Violette. Cette pierre scintille comme le cristal et rehausse la pureté et la beauté du cœur.
- Mon frère, le chevalier de la Goutte de Rosée, est une mauviette ! fit en grimaçant le Rayon de Soleil. Je vais te prendre cette bulle d’eau et te donner en échange une petite bague d’or que tu pourras toujours porter.
- Mais ce serait offenser ton frère !
- Peut-être bien… bien que nous soyons frères, nos points de vue diffèrent énormément. Et puis, n’est-ce pas moi qui permets à une fleur de déployer sa corolle en toute beauté ?
- Mais du chevalier de la Goutte de Rosée, les belles fleurs nouvellement nées reçoivent la consécration de leur premier baptême. Son œuvre est grande et noble.
- Quel non-sens ! répliqua le Rayon de Soleil. Il vous arrose si peu. De mon éclat doré vous vient votre beauté. Alors du balai avec cette chose aqueuse, là ! et il aspira la goutte de rosée et disparut.
- Si seulement il pouvait ne jamais revenir, ce baron voleur ! soupira la violette.

Des nuages couvrirent le ciel. Apeurée, la fleur leva son regard vers les arbres et vit à quel point les feuilles des bouleaux et des peupliers tremblaient, et les herbes qui, de terreur, se balançaient d’avant en arrière.
- L’orage arrive ! crièrent les fleurs et les bourgeons. Cachez-vous, afin qu’il ne puisse vous plier pour mieux vous casser !
Rapidement, la violette passa la tête sous ses feuilles. Mais l’orage avec rudesse et violence, tira et tira jusqu’à ce que la petite plante fût complètement déracinée.
- Viens timide jeune fille, dit-il en sifflant. Viens avec moi ! Nous allons ensemble voler par monts et par vaux, fleuves et ruisseaux. Je veux te porter dans mes bras.
- Non, non ! cria la petite fleur choquée, je veux rester ici, chez moi, dans mon confortable et paisible coin de forêt.
- Qu’est-ce qui te prend ? hurla le vent. Toi et tes sœurs vous êtes bien trop mignonnes pour rester là à dépérir inaperçues. Vous devez aller en ville ! Là-bas, dans certains palais, dans un beau parc ou encore de riches vitrines, vous pourrez prolonger votre beauté et la valoriser.
- Mais c’est ici que je me sens à l’aise !
- Ridicule ! Précisément parce que tu ne connais rien de mieux. Comme dans ta folle modestie tu refuses de connaître le bonheur, je te dis adieu !
- De ces troubles éternels j’en ai plus qu’assez ! répondit la demoiselle en colère. Je ne demande qu’à vivre en paix et comme bon me semble. Accourez mes frères, entourez-moi et protégez-moi de tous ces chercheurs de beauté qui ne tarderont pas à nous envahir.
Les frères de la violette se pressèrent pour l’entourer. Les tiges avec leurs épaisses feuilles, se rapprochèrent de leur petite sœur et la cachèrent du hardi rayon de soleil, et du vent d’orage.
Et quand le soleil disparut comme avalé par l’horizon, le chevalier de la Goutte de Rosée descendit des nuages comblant la violette, et tiges et feuilles s’écartèrent afin qu’elle pût recevoir le nouveau joyau étincelant du chevalier.
- Comment, mon doux amour ? s’étonna le chevalier de la Goutte de Rosée, tu portes un autre joyau à présent ? un petit anneau d’or ?
- Ton frère le Rayon de Soleil me l’a donné, répondit la violette, mais je préfère ton brillant joyau.
- Ne crains pas de te faire voler ma goutte par mes frères, le Rayon de Soleil et le Vent d’Orage. Dans le doux crépuscule du jour, tu la recevras toujours de mes mains. Et tes frères peuvent continuer à te protéger comme auparavant.
Quand le jour se leva, deux enfants, un frère et une sœur, passèrent par la forêt.
- Regarde cette jolie petite fleur, là-bas ! s’écria le garçonnet en désignant la violette. Nous allons la cueillir pour l’offrir à maman !
- Non, ce serait vraiment dommage, répondit la judicieuse petite sœur. Nous allons la déterrer avec ses racines et la transplanter dans notre jardin où elle fleurira tout comme ici.
Et, doucement, ils déterrèrent la violette en prenant soin de prendre un peu de terre de son sol natal avec eux. De retour chez eux, à l’ombre des grands arbres de leur jardin, ils creusèrent un trou dans de la mousse et l’y plantèrent. Puis, ils appelèrent leur gentille maman afin qu’elle puisse admirer la petite merveille.
- Jamais nous n’avons accueilli dans notre jardin une fleur aussi adorable ! dit la maman. Mais elle penche la tête, et elle paraît bien triste ! Peut-être a-t-elle le mal du pays, ou peut-être lui manque-t-il quelque chose ?
- Tu as bien raison ! pensa la violette. Il me manque le climat de confiance du petit coin de terre où je suis née. Ce jardin est beau et même magnifique avec ses plates-bandes de roses toutes merveilleuses, mais toute cette gloire ne remplace pas ce que j’ai perdu. La seule chose qui me console est que mon ami le chevalier de la Goutte de Rosée me retrouvera chaque soir pour me rafraîchir et m’orner.
Il ne pousse pas de fleur plus douce dans les forêts et les jardins qui soit courtisée par le vent d’orage et le soleil, embrassée par la rosée rafraîchissante, que cette calme fleur cachée, embaumant l’air autour d’elle, et poussant à l’abri des arbres, des feuilles et des chemins détrempés de pluie. Cette douce fleur des elfes est la tendre violette, transplantée du paradis sur terre par le Jardinier Céleste.

Freya- Messages : 1336
Date d'inscription : 24/08/2012
Localisation : Vosges
Page 1 sur 2 • 1, 2 
Page 1 sur 2
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|